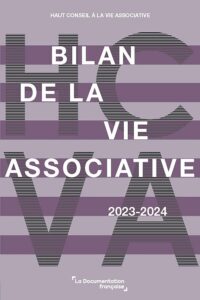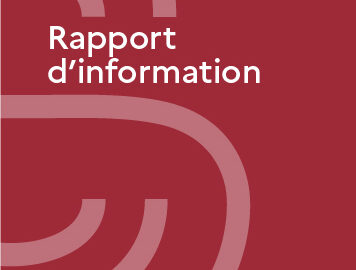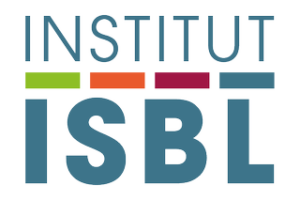Le bilan de la vie associative 2023 – 2024, disponible à la Documentation française, se concentre sur la situation économique des associations durant cette période. Il analyse comment, après la crise sanitaire, face à l’inflation et à la diminution des soutiens publics, les associations parviennent à répondre aux besoins des populations, prouvant ainsi leur résilience, leur capacité d’innovation et leur présence active sur les territoires.
Pendant la pandémie, les associations ont fait preuve de grande réactivité, malgré l’absence de contact direct avec leurs membres. Elles ont utilisé des outils numériques pour maintenir des liens, surtout auprès des populations isolées, comme les personnes âgées et les jeunes qui ne pouvaient plus aller à l’école. Cependant, l’arrêt des activités a eu des conséquences financières lourdes, notamment pour le secteur culturel, où les événements ont dû être annulés.
En 2022, bien que la situation ait semblé se stabiliser, deux événements ont aggravé la situation : l’inflation liée à la hausse des coûts de l’énergie et des produits de première nécessité (en partie à cause de la guerre en Ukraine). Les associations caritatives (Restos du cœur, Secours populaire, etc.) ont vu leurs demandes exploser, nécessitant des dépenses supplémentaires. De plus, le Ségur de la santé, avec l’augmentation des salaires des intervenants sociaux, a ajouté des coûts sans un soutien public suffisant.
Les associations, même les plus petites, ont dû faire face à des charges fixes, mettant en évidence des difficultés économiques généralisées. Par ailleurs, la relation avec les pouvoirs publics s’est tendue, notamment avec le contrat d’engagement républicain (CER) qui a créé un climat de méfiance et de suspicion, réduisant souvent les soutiens publics.
Face à cette situation, des observateurs ont appelé à un soutien renforcé pour les associations. Le Conseil économique, social et environnemental a d’ailleurs alerté sur cette urgence, soulignant que les associations jouent un rôle clé dans la cohésion sociale et le vivre-ensemble, au-delà des services qu’elles fournissent. Leur vitalité doit être soutenue par des financements accrus, mais aussi par des simplifications administratives.
Enfin, les modes d’engagement des bénévoles ont évolué. Depuis la pandémie, de plus en plus de jeunes s’engagent, tandis que les formes de bénévolat changent, marquant une évolution importante dans l’implication sociale.
Plus d’information ICI
source : https://www.vie-publique.fr/
En savoir plus :
- Replay : Journées de l’Economie Autrement 2025 à Dijon - 5 décembre 2025
- Un rapport du Sénat appelle à repenser la croissance - 26 novembre 2025
- Ozé Le Podcast : Quel stratégie pour reprendre la terre au capital ? - 26 novembre 2025