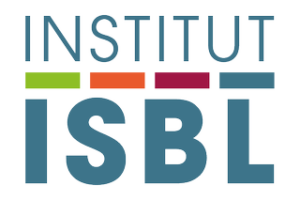Le transport est une question centrale de la transition écologique. Pour y répondre, Adrien Aumont, autodidacte co-fondateur du site de financement participatif KissKissBankBank a revendu ses parts à la Banque postale en 2017 et créé Midnight Train. Le projet vise à relier en train Paris et les grandes villes européennes dans un rayon d’action de 800 à 1500 kms. Les pays du Nord étant déjà plus ou moins couverts, Midnight train vise plutôt l’Espagne, le Portugal, l’Italie. Pour couvrir au moins 800 kms, il faudra rouler la nuit, d’où le nom Midnight Train avec l’objectif de réinventer un plaisir identique à celui qu’apportaient l’Orient Express ou le Train Bleu.
L’alternative du train
Pour redonner ce plaisir, Midnight Train mise sur la qualité du service avec des compartiments privatifs, un bar, un restaurant avec des chefs étoilés. Cible visée : ceux qui prennent l’avion sur ces distances moyennes, c’est-à-dire des cadres, des dirigeants, business men (& women), retraités qui ont le temps et l’argent de voyager dans un cadre confortable. L’idée est bonne puisque ces personnes sont celles qui prennent le plus l’avion et donc polluent le plus. Il y a donc un enjeu. Pour relever cet enjeu, Midnight Train a déjà réussi à lever des fonds auprès d’une quarantaine d’investisseurs et business angels dont l’inévitable Xavier Niel (fondateur de Free). Le projet a séduit la planète French tech et les business angels. Mais l’idée de relancer le ferroviaire n’est pas nouvelle. En 2019, une poignée de citoyens a lancé Railcoop avec un objectif plus audacieux que Midnight train : relancer les lignes secondaires provinciales abandonnées par la SNCF qui a tout misé sur le TGV. Midnight Train propose une alternative à l’avion. Railcoop propose une alternative à la route qui consomme 12 fois plus d’énergie à masse égale que la voiture (selon les experts).
Segments rentables
Mais, alors que Midnight Train se concentre sur des segments potentiellement rentables auprès d’une clientèle professionnelle et/ou aisée, Railcoop veut recréer une dynamique territoriale entre Lyon et Bordeaux au service du plus grand nombre et des villes moyennes oubliées des transports publics. Railcoop veut rendre service à ceux qui bougent pour leurs affaires ou pour le plaisir, mais aussi changer le quotidien de ceux qui ont besoin d’aller travailler ou voir leur famille : 90% des Français habitent à moins de 10 kilomètres d’une gare, mais un tiers d’entre elles ne sont plus desservies. Longue de 630 kilomètres, la ligne Bordeaux-Lyon est aussi compliquée à exploiter car peu électrifiée et parsemée d’itinéraires pouvant traverser la montagne. Autant de facteurs qui font de Railcoop un projet économiquement plus risqué que Midnight Train et expliquent le scepticisme et les freins rencontrés malgré la réponse évidente à un besoin autrefois couvert par le service public.
Loin du monde des Fintech et du capital-risque, les promoteurs de Railcoop (un collectif et pas un entrepreneur isolé), vont moins vite qu’Adrien Aumont pour réunir les moyens de développer leur projet. Mais le temps consacré à convaincre tous les décideurs est aussi un temps permettant de mieux maturer le projet pour le rendre viable et pérenne.
Mobilisation citoyenne
Une émission sur France 2 en janvier a tout changé : le bien-fondé du projet était tellement évident que Railcoop a suscité un engouement de milliers de personnes se déclarant prêtes à contribuer à son démarrage, par de l’apport au capital, des prêts, du soutien technique et toutes formes de propositions. Et ce bien au-delà de nos frontières et même jusqu’au Japon. De fait, Railcoop est un projet d’intérêt collectif – et même d’intérêt général – qui concerne tous les acteurs des régions concernées : usagers, contribuables, habitants, entreprises, commerçants, artisans, collectivités territoriales, etc. C’est sur ce constat que Railcoop s’est constitué en coopérative, permettant précisément d’impliquer tous les acteurs concernés dans le projet au démarrage et par suite avec un contrat clair : vous nous aidez en capital ou avec d’autres moyens, on peut développer pour vous un service de transport alternatif à la voiture, qui pollue moins, évite de faire croître l’emprise au sol de la route et mutualise les coûts. Et plutôt que de rechercher quelques business angels qui vont biaiser le projet parce qu’il y aura l’enjeu financier de valoriser leur apport, mieux vaut miser sur une mutualisation de milliers de petites contributions et permettre surtout au collectif fondateur de réaliser son objectif de service aux habitants et aux territoires.
Deux logiques
Dans sa première étape, le pari est réussi puisqu’aujourd’hui, Railcoop réunit 7 500 sociétaires et a dépassé 1,5 million d’euros de capital social, le seuil fatidique pour être éligible à la licence ferroviaire auprès de l’Autorité de régulation des transports (ART). Parmi ces sociétaires, des particuliers, mais aussi une douzaine de collectivités qui ont compris leur intérêt. Parmi elles le département de la Creuse, la ville de Vichy, la communauté d’agglomération du Libournais ou encore la communauté de communes de Figeac qui a souscrit 225 parts sociales pour un montant de 22 500 euros, soit une contribution de 50 centimes par habitant. Malgré une dynamique positive, les écueils et inconnues restent nombreux. Le parcours sera long pour faire partir les premiers trains Railcoop. La coopérative doit déposer son dossier auprès du ministère des Transports pour obtenir son certificat de sécurité ferroviaire. Impératif administratif oblige, il faut attendre 6 mois pour obtenir le droit de faire circuler le train et devenir entreprise ferroviaire. Railcoop devra aussi se plier à des centaines d’autres procédures pour se conformer à la législation.
On voit donc que sur un même enjeu de mobilité douce, l’initiative privée peut se développer avec deux logiques distinctes. La première s’inscrit dans un modèle entrepreneurial classique basé sur le capitalisme à l’anglo-saxonne avec une idée dont la forme sera nécessairement orientée par les impératifs financiers. Avantage : capacité de lancement et de changement d’échelle rapide. Inconvénient : le financement en capital-risque oriente le projet vers ce qui peut être rentable et limite l’accès au service à ceux qui en auront les moyens. La seconde s’inscrit dans une logique d’économie sociale (ESS) avec une priorité au service rendu et par conséquent une gouvernance en phase avec cet objectif. Avantage : en coopérative, c’est le service qui prime et l’impératif financier est second. Inconvénient : un besoin de temps et d’énergie plus longs pour mobiliser les moyens du succès.
Licornes et valorisation boursière
Cette dualité d’approche se retrouve dans beaucoup d’autres secteurs et notamment tous les nouveaux métiers relatifs à la transition écologique et à la numérisation de l’économie. En 2013, un américain, Aileen Lee, a donné un nom à toutes ces start-up positionnées sur ces enjeux : les Licornes, parce qu’elles sont aussi rares et extraordinaires que l’animal mythique du même nom. Le nom Licornes s’est répandu et désigne aujourd’hui les start-up dont la valorisation atteint au moins un milliard de dollars avec un potentiel de croissance important. Exemples types : Bla-Bla Car, Air BnB, Uber, Spotify… Le modèle économique est pratiquement toujours le même : un geek ou deux ont une idée innovante de rupture, un esprit entrepreneurial ; ils créent une société pour lever les fonds et déployer leur service à l’échelle la plus large possible, même gratuitement. Le modèle économique repose moins sur le chiffre d’affaires que sur l’apport en fonds propres et la promesse de valorisation future pour les investisseurs. La logique est d’entrer rapidement en Bourse pour accroître encore cette valorisation et rapporter vite et beaucoup à leurs investisseurs. Le projet part d’une idée de réponse à un besoin. Mais la logique est financière.
Les limites du privé lucratif
On peut s’interroger pourquoi les financeurs apportent autant d’argent sur des projets aussi risqués économiquement. Primo, ces entrepreneurs et les financeurs sont issus du même moule et partagent le même goût du risque, de l’innovation, de l’excitation de l’inconnu, l’envie d’entreprendre et l’envie de gagner beaucoup d’argent. Secundo, pour les business angels et autres capitaux-risqueurs, le risque est élevé, mais en répartissant leurs investissements sur plusieurs projets, ils savent que certains projets échoueront et d’autres réussiront. Le système a prouvé son efficacité économique, mais il n’est pas adapté aux marchés moins rentables, aux activités d’intérêt général ou trop coûteuses dans le temps. Si Amazon n’avait pas sa filiale d’hébergement informatique AWS ultra-rentable, son activité d’hypermarché en ligne n’aurait jamais pu se déployer durablement sur la planète. Bon nombre de ces projets financièrement peu attractifs pour le privé lucratif sont gérés par le secteur public ou des organisations para-publiques (syndicats d’économie mixte, institutions public-privé, etc). Sauf que dans le cas de la transition énergétique et de la révolution numérique, l’innovation suppose beaucoup de flexibilité, de réactivité, de capacité de décision et de mobilisation rapide, ce que la gestion publique ne sait pas faire compte tenu de son cadre administratif.
La réponse ESS
D’où l’intérêt de l’initiative privée sous forme d’économie sociale plus souple pour les projets en lancement ou en croissance. De plus en plus, on voit aussi émerger des projets sociaux et environnementaux qui se lancent en société commerciale ordinaire. Mais pour être cohérents avec eux-mêmes, ces projets se trouvent vite obligés d’organiser leur financement et leur gouvernance comme l’ESS. C’est pour favoriser ce pluralisme que la loi ESS française de 2014 a inclus les entreprises à statut commercial classique dans l’ESS pour peu qu’elles respectent les bornes de gestion démocratique et d’affectation des résultats au service du projet. C’est ainsi qu’on voit germer des projets comme Time for the Planet dont l’ambition est de réunir 1 milliard d’€ pour créer 100 entreprises luttant contre le réchauffement climatique. La promesse aux actionnaires : « vous souscrivez des actions, vous avez droit préférentiel pour en souscrire d’autres si vous êtes déjà actionnaire, on vous informe de l’avancement des projets et vous avez le droit à la parole, mais vous ne gagnez rien, vous contribuez à réaliser des projets utiles pour la planète ». Pourquoi ne pas appeler part sociale un titre uniquement remboursable au nominal ? Dans le cas de Time for the Planet, la communication peut même laisser croire que l’apport en « action » est en fait un simple don. Quel besoin en ce cas du statut de société commerciale ? Mais l’association loi 1901, ça fait vieux jeu. Par contre, l’entrepreneuriat commercial, ça fait moderne. Time for the Planet est l’archétype de tous ces projets intéressants qui pour de simples raisons de culture et de jeunisme, n’ont pas mis en cohérence leur projet avec une organisation et des statuts qui y répondent. L’avenir dira si Time for the Planet continue à réussir sa mobilisation comme ils l’ont fait depuis leur lancement.
Licoornes et intérêt collectif
Le monde coopératif foisonne de jeunes pousses conciliant un projet lié à la transition et une forme ESS. Elles se sont regroupées en prenant le nom de Licoornes, en référence aux Licornes de la Silicon Valley et de la French Tech dont elles se revendiquent comme « l’alternative coopérative et engagée ». Pour faire connaître leur initiative et la pertinence des projets qu’elles développent dans tous les secteurs de l’écologie et des besoins sociaux de demain, ces Licoornes se sont ouvertes au public dans le cadre d’un Festival qui s’est tenu à Pantin, en banlieue parisienne, du 18 au 20 juin. Près de 60 coopératives ont répondu à l’appel avec en chefs de files une dizaine d’entreprises positionnées sur les secteurs clefs de la transition écologique : électricité renouvelable en circuit court (Enercoop), service de téléphonie qui responsabilise la consommation de données (Telecoop), location longue durée d’ordinateurs et de smartphones (Commown), covoiturage et mobilité solidaire (Mobicoop), commerce en ligne d’objets d’occasion (Emmaüs), mise en relation de producteurs et clients en circuit court (Coopcircuits), auto-partage (Citiz), solutions d’épargne pour les projets ESS et bien sûr Railcoop évoqué plus haut dans ces lignes.
Culture ESS
Leur point commun : proposer une réponse innovante aux enjeux de la transition sans être prisonnières de la logique financière et en s’appuyant sur la mobilisation du plus grand nombre de leurs parties prenantes. Outre l’ambition commune de promouvoir ce modèle d’économie coopérative chacune dans leur métier, les Licoornes travaillent aussi en commun au plan opérationnel en utilisant des outils communs comme la comptabilité Care, un triple bilan comptable qui internalise les conséquences économiques, sociales et écologiques des décisions des coopératives. Pour séduisants et prometteurs qu’ils soient, tous ces projets pèsent économiquement encore bien peu comparés à la French tech qui revendique d’avoir créé 163 000 emplois en 2020 dont 26 000 emplois directs et 137 000 emplois indirects avec des services utilisés par 1 français sur deux. La seule entreprise Spotify pèse à elle seule 43 milliards de $ de valorisation boursière. La logique capitaliste et financière va très vite et très fort à l’échelle mondiale. Côté ESS, Enercoop avec moins de 250 salariés, est l’une des plus grandes entreprises positionnées sur la transition. C’est toute la question du changement d’échelle des projets d’ESS et aussi de leur financement. Autre exemple : Biocoop. Pour arriver à son niveau de croissance d’aujourd’hui (pour lequel il est aujourd’hui injustement critiqué), l’enseigne a patiemment maillé son réseau et créé son expertise de la distribution bio pendant 35 ans. La culture coopérative s’accommode rarement de la logique start-up et d’une grosse levée de fonds en quelques mois. D’une part pour des raisons statutaires car par définition, la logique n’est pas de rechercher la valorisation d’un capital. Et d’autre part en raison d’un état d’esprit entrepreneurial tourné vers une gestion des risques mesurés et la croissance à long terme sans oublier un temps important consacré à l’humain et aux démarches participatives actives.
Taille humaine
L’objectif de grossir et de grossir vite n’est pas une fin en soi et n’est pas dans l’ADN des entreprises ESS, comme l’ont montré les échanges de la table ronde consacrée à ce sujet lors du Festival Ondes de Coop. « On ne voulait pas faire plus de chiffre d’affaires sur la laine car notre projet était de revivifier le territoire » se rappelle Béatrice Barras d’Ardelaine. « On pourrait doubler de volume, mais on a préféré choisir pour maîtriser notre développement » explique François-Xavier Ferrari, dirigeant de MU, une Scop d’éco-conseil qui réunit… 15 salariés alors même que l’objectif de départ était de ne pas dépasser 10. « Une organisation qui devient trop importante perd le sens de sa vocation initiale et ne vise plus qu’à s’auto-reproduire » analyse Patrick Behm, co-fondateur d’Enercoop. « En auto-partage, on est condamnés à la croissance, car plus on est gros, plus on fait des économies d’échelle sur les dépenses logistiques » tempère Jean-Baptiste Schmider, dirigeant de Citiz. Mais comme Enercoop, Citiz appuie son développement sur l’essaimage dans les territoires à partir de volontés entrepreneuriales locales. Citiz est donc tributaire de l’envie ou non de proposer ce service dans telle ou telle ville et tributaire de l’envie et les capacités de développement des entrepreneurs locaux. Et tributaire enfin des spécificités de son métier qui vise à changer le comportement des personnes pour qu’elles prennent moins leur voiture. Ce qui se fait forcément sur le temps long, voire très long. Pour autant, Citiz se développe à un bon rythme d’une croissance de 15 à 20% de chiffre d’affaires par an. Mais parti de rien en 2002, l’entreprise n’a « encore que » 63 000 utilisateurs clients.
Des financements abondants
A de rares exceptions près comme Biocoop, la culture ESS est donc pour les entreprises récentes de l’ESS très largement une culture TPE/PME, voire artisanale. Mais même en TPE ou PME, on a besoin de moyens et donc de financement pour se développer, c’est-à-dire pas forcément grandir vite, mais développer ses projets, innover, se professionnaliser, etc. Or, sur cette question du financement, l’offre et la demande ne parviennent visiblement pas à se trouver si l’on en croit Valérie Vitton, responsable des financements et conseils spécialisés au Crédit Coopératif, partenaire bancaire historique et incontournable de l’ESS, et qui témoignait au Festival Ondes de Coop : « Les investisseurs institutionnels ont des difficultés pour identifier des projets. Et les projets sont en demande d’argent. On essaie de faire le lien ». De fait, jamais dans l’histoire les entreprises n’ont eu autant d’outils et de solutions de financement à leur disposition, aussi bien généralistes que spécialisés ou territoriaux. L’ESS a aujourd’hui un éco-système bien rôdé avec des acteurs qui travaillent souvent ensemble comme le Crédit Coopératif, la NEF, France Active, Finansol, Paris Initiatives Entreprises avec des appuis institutionnels comme la Banque des territoires ou les différents appels à projets périodiquement proposés à l’échelon local, national ou européen. Dernier exemple en date : le lancement du fonds Coop Venture lancé à l’initiative et avec le soutien des Scop, de leur Mouvement, deux collectivités et le Crédit Coopératif. Coop Venture se positionne comme l’alternative ESS du financement des start-up à haute intensité technologique. Le fonds démarre sa phase pilote avec 4,42 millions d’€ pour des investissements unitaires qui peuvent aller de 150 à 300 000 €, ce qui est à la fois très peu et beaucoup. Les acteurs de l’ESS travaillent aussi avec les grandes banques nationales, dont bien sûr les banques mutualistes, dont l’identité actuelle résulte de positionnements historiques : Banques Populaires sur les artisans et commerçants, les Caisses d’épargnes sur le logement, le Crédit Agricole pour l’agriculture ou le Crédit Mutuel rural également, mais hors agriculture (cf politiques publiques des gouvernements dans les années 50 et 60).
Investissement et fonctionnement
Alors comment se fait-il avec toute cette offre qu’on ne trouve pas de solution pour soulager la myriade d’acteurs locaux ou spécialisés de l’ESS qui structurellement, se lamentent des baisses de subventions, peinent à payer correctement leurs équipes et peuvent assurer leur service grâce à une forte implication bénévole de leurs élus et de leurs membres ? Le basculement de la subvention ou de financements pérennes au système d’appels à projets a doublement compliqué la tâche des acteurs ESS : d’une part, le temps administratif s’est accru au détriment du temps pour rendre le service (comme partout ailleurs). Le programme européen FSE est l’archétype de cette dérive qui oblige à recruter une personne à mi-temps voire à plein temps uniquement pour assurer l’interface administrative de ce programme qui par surcroît, ne paie ses bénéficiaires au mieux que 2 ans après. Et d’autre part l’offre de financement disponible est foisonnante sur la logique d’investissement et de projets ponctuels, mais plus rare sur le fonctionnement habituel des structures et notamment la masse salariale. Or c’est bien dans le fonctionnement que beaucoup de structures rencontrent des difficultés. Et en particulier les grandes associations, coopératives et mutuelles positionnées sur des métiers nécessitant beaucoup de main d’œuvre ou qui ont du mal à fidéliser compte tenu de l’inadéquation offre/demande ou du profil insuffisamment qualifié des candidat(e)s. Répondre à ce défi supposerait de mieux calibrer les offres de financement dans un sens plus adapté aux besoins récurrents et dans la logique la moins administrative possible. Elle suppose aussi de ne pas raisonner que financement et de mieux travailler collectivement à démultiplier l’efficacité des solutions de soutien humain disponibles : mécénat de compétences, bénévolat, meilleure reconnaissance du temps engagé par les membres d’organisations ESS et encouragement pour que ce soit durable, clarification et massification d’une offre simple et lisible pour mieux former les équipes à commencer par leurs dirigeants et ce dans la durée également via accompagnement, mentorat, tutorat et autres solutions que la loi de la formation professionnelle de 2018 a fait germer, mais que peu mettent en œuvre, tels le Compte Engagement Citoyen (CEC) ou l’AFEST (formation en situation de travail). Les bons projets ESS innovants ne manquent pas, que ce soit dans les jeunes pousses ou même les structures institutionnalisées. Mais les solutions pour les faire grandir sans les faire souffrir restent grandement à améliorer et à faire connaître. Et notamment auprès des équipes et élus des grandes Régions fraîchement élues.
Pierre Liret
Entrepreneur à Coopaname et expert en économie coopérative
- Sociétés à mission : enjeux pour l’ESS - 23 février 2026
- Duralex, symbole du deux poids deux mesures - 24 novembre 2025
- L’arlésienne du financement des Scic - 28 mai 2025