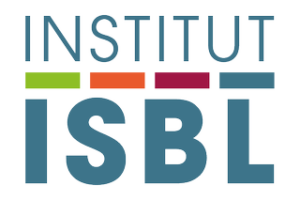Le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire doit être présenté le 10 juillet 2013 en Conseil des ministres, pour un examen au Parlement en septembre. Le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS) a examiné, jeudi 25 avril, une version de travail. Entretien avec Benoit Hamon, ministre de l’Economie sociale et solidaire et de la consommation.
Pourquoi élaborer un projet de loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS) ?
Il s’agit d’abord de reconnaître l’ESS et d’en toiletter l’environnement législatif et réglementaire. Ce texte va accompagner la stratégie gouvernementale de croissance du secteur.
Il comportera un premier chapitre définissant le champ de l’ESS, qui permettra d’ailleurs d’y faire entrer de nouveaux acteurs, c’est-à-dire des entreprises qui s’en approprient les principes sans pour autant faire partie des familles historiques du secteur.
Un deuxième chapitre portera sur la structuration du secteur. C’est une démarche nécessaire, car l’ESS s’incarne à travers une multitude d’initiatives présentant une telle variété de tailles, de statuts, d’activités qu’elle perd beaucoup d’énergie et de capacité de développement.
Enfin, un troisième chapitre abordera les modes de financement. Autant de points essentiels pour élaborer une loi efficace en faveur du développement de l’ESS.
Pourquoi ?
Il existe un paradoxe à voir des acteurs économiques représentant 10 % du PIB et 2,4 millions d’emplois ne bénéficier d’aucune reconnaissance. La loi va enfin mettre fin à cette situation et reconnaître la biodiversité économique que représente l’ESS.
Dans la mesure où l’ESS est désormais intégrée aux politiques économiques du ministère de l’Economie et des finances, cette loi sera une loi économique, fondée sur la promotion d’un modèle entrepreneurial spécifique. Cette vision économique de l’ESS bouleverse un peu certains acteurs du secteur, qui se considèrent avant tout comme promoteurs de valeurs telles que la gouvernance et la lucrativité limitée.
Pour autant, j’ai la volonté politique de montrer que ce modèle économique peut concilier gouvernance démocratique, utilité sociale et performance économique. Les entreprises de l’ESS ont créé davantage d’emplois ces dernières années et sont plus résilientes face à la crise que les structures de l’économie traditionnelle.
Il faut toutefois que ce modèle soit fidèle aux principes qui l’animent et qui le distinguent de l’économie capitaliste classique. Prenons l’exemple de la révision coopérative.
Ce principe permet aux acteurs coopératifs de s’assurer que leurs structures restent fidèles aux principes historiques de l’ESS. Or j’ai pu constater des dysfonctionnements dans certaines structures, ce que les acteurs concernés reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes.
Si nous voulons mener une stratégie de croissance pour ce secteur, nous devons nous doter d’instruments de révision et d’évaluation pour crédibiliser le modèle de développement alternatif qu’il propose.
Quelle définition de l’économie sociale et solidaire avez-vous retenue ?
C’est une définition inclusive de l’économie sociale et solidaire qui a été retenue. Je salue d’ailleurs les acteurs « historiques », qui au départ souhaitaient rester sur le seul périmètre des statuts, à leurs yeux seuls garants des principes de l’ESS, d’avoir fait évoluer leur position pour inclure de « nouveaux entrants ».
La loi va donc intégrer dans le périmètre de l’ESS, les entreprises qui s’en revendiquent bien qu’ayant été créées sous un statut capitalistique classique. Cette inclusion dans l’ESS ne sera pas automatique et il sera demandé à ces nouveaux entrants d’avoir inscrit dans leurs statuts des principes inspirés des acteurs historiques de l’ESS.
Leurs pratiques seront encadrées par la loi et les décrets, non pas sous la forme d’une labellisation, mais comme un nouveau modèle d’entreprise.
En effet, on constate depuis quelques années un véritable engouement de la part de jeunes créateurs d’entreprise pour un modèle dont l’objectif principal n’est pas l’accumulation de bénéfices et leur distribution.
Ils veulent encadrer la distribution des dividendes selon les principes de l’ESS, constituer des réserves impartageables, appliquer des échelles de salaires vertueuses…
En même temps, ces créateurs doivent faire face à obstacles considérables, notamment pour des questions juridiques : par exemple, comment créer une petite start-up de l’ESS ? Le modèle coopératif, même en SCOP, et l’association ne constituent pas toujours des formes adaptées pour les créateurs d’entreprises sociales, notamment lorsqu’il s’agit de chercher des financements.
Or, nous voulons donner la possibilité à tous les entrepreneurs de fonder des entreprises appartenant à l’ESS.
Quelles seront les modalités pratiques de la reconnaissance de l’appartenance à l’ESS ?
D’une part, il y aura la déclaration : toute entreprise qui entend fonctionner selon les principes de l’économie sociale se déclarera « entreprise de l’ESS » au moment de sa création auprès du greffier du tribunal du commerce, ou du centre de formalité des entreprises. L’entreprise s’exposera ensuite à la vérification des financeurs et au contrôle par le fisc de la conformité à ce qui aura été déclaré.
D’autre part, il y aura l’agrément solidaire, qui existe déjà et que nous allons refondre. Nous l’appellerons « agrément solidaire d’utilité sociale » et il sera délivré par les DIRRECTE.
Sur ces deux sujets, je ne veux pas d’instruction trop longue qui recréerait une usine à gaz. Je préfère qu’on parte du déclaratif pour aller ensuite vers le contrôle.
Une définition inclusive de l’ESS implique-t-elle une définition élargie de l’utilité sociale ?
Non, en principe, l’article 1 du projet de loi va rappeler les principes de l’ESS. Mais le seul principe qu’il ne nous semblait pas possible d’inscrire dans la loi, dès lors qu’il s’agit d’une SA ou d’une SARL, c’est la gouvernance démocratique.
Le principe « une personne-une voix » sera rappelé dans l’exposé des motifs de la loi pour les familles historiques. Mais pour la nouvelle famille, étant donné les statuts juridiques des structures qui la composent, il faudra trouver d’autres formes de gouvernance démocratique.
Cela dit, la loi va aussi demander au Conseil supérieur de l’ESS (CSESS) d’élaborer une charte de l’ESS, qui sera proposée à la signature des entreprises. Cette charte devra porter sur des sujets sur lesquels l’ESS doit redevenir une locomotive – ce qu’elle n’est plus vraiment – sur la démocratie sociale, l’égalité homme-femme, les échelles de salaires, etc. Nous avons besoin d’une exemplarité renouvelée.
Pourquoi la signature de la charte serait-elle volontaire ?
C’est au CSESS de dire si elle sera volontaire ou obligatoire, le débat est ouvert et les acteurs peuvent s’en saisir. S’il s’agit de réenclencher une dynamique de promotion et de progrès social dans l’ESS, et plus généralement au-delà même de l’ESS, je pense que toutes ne pourront pas la signer du jour au lendemain.
Mais ce point sera renvoyé à la discussion entre les acteurs de l’ESS.
La loi va-t-elle prévoir l’encadrement des salaires au sein des structures qui se revendiquent de l’ESS ?
L’encadrement des salaires ne constitue pas un principe historique de l’économie sociale et solidaire. Je renvoie donc ce po
int à la discussion entre les acteurs, notamment au CSESS, dans le cadre de l’élaboration de la charte.
Il faut de toute façon reconnaître que cette question des salaires n’est pas un problème pour l’immense majorité des structures de l’ESS, dont les échelles varient de 1 à 5, voire de 1 à 3, même si les mutuelles et les banques connaissent des échelles de salaires notoirement plus étendues.
L’un des leviers de développement de l’économie sociale et solidaire est l’accès à la commande publique. Comment allez-vous faciliter l’accès de ces acteurs aux achats publics ?
Nous avons décidé d’anticiper la transposition de la directive marché de l’Union européenne en permettant aux structures d’insertion de bénéficier d’un accès réservé à une part des achats de l’Etat, des collectivités et des établissements à participation publique. Toutes les structures qui concourent par leur action ou leurs statuts à l’insertion de personnes en difficulté dans l’emploi, comme les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), ou les structures de l’insertion par l’activité économique (IAE), seront concernées.
Pour cela, nous allons également demander à toutes les collectivités d’avoir une stratégie d’achat responsable. Aujourd’hui, la part des marchés incluant une clause sociale ne dépasse pas 3 %. Nous devons organiser l’écosystème de telle sorte que cette part augmente.
Allez-vous rester sur la notion de clauses sociales d’insertion ou opter pour une acception plus large de la clause sociale ?
C’est un point difficile et, pour l’instant, nous voulons une approche centrée sur les missions d’utilité sociale dans l’insertion des publics en difficulté dans l’emploi, le Conseil d’Etat venant d’en donner une approche plus élargie. Le défi est déjà important car il faut que le secteur se structure et s’organise pour répondre à cette demande.
La réforme de l’IAE (insertion par l’activité économique, ndlr) doit intervenir en ce sens.
Les associations demandent avec insistance la sécurisation des subventions : prévoyez-vous de donner un cadre législatif, et non plus réglementaire, aux subventions ?
Oui, la loi donnera pour la première fois un cadre légal à la subvention, afin de favoriser l’initiative associative en ne faisant pas reposer son financement uniquement sur la mise en concurrence. Il s’agit de pouvoir financer l’initiative associative, fondée sur un diagnostic d’un besoin social et qui n’a pas forcément été bien identifié par l’Etat ou les collectivités locales.
Quelle sera l’articulation entre votre projet de loi et les futures lois de décentralisation ?
En matière d’ESS, je trouve l’idée de chef-de-filat inappropriée. Pourquoi ? D’abord, je constate que là où l’ESS se développe, c’est parce qu’on l’a inscrite dans les schémas régionaux de développement économique (SRDE) – et donc la loi va encourager à le faire.
Ensuite, il est évident que les conseils généraux, à travers l’action sociale et le financement de l’insertion par l’activité économique, sont des acteurs majeurs de l’ESS.
Enfin, au niveau local, les agglomérations et les villes, à travers le financement des associations, le sont aussi.
Et nous voulons non seulement favoriser l’inscription de l’ESS dans les SRDE, mais nous souhaitons aussi une contractualisation collectivités-Etat-acteurs de l’ESS au niveau des territoires. Par exemple, au niveau d’une région, on peut développer une filière – service à la personne, recyclage, économie verte.
Au niveau d’une agglomération, on partira plutôt d’un diagnostic des besoins – service public de la petite enfance, etc. Il s’agit d’avoir une approche plus fine, ce qui suppose une contractualisation au niveau des différents échelons sans nécessairement désigner de chef de file.
Le chiffre de 500 millions d’euros que la Banque publique d’investissement (BPI) réserverait à l’ESS est évoqué ici et là. Le confirmez-vous ?
Je le confirme. La BPI a beaucoup travaillé sur le sujet, d’autant que pour un banquier public, financer l’ESS ce n’est pas forcément son cœur de métier. Sur les deux métiers de la BPI – d’une part l’investissement, les fonds propres, la participation, et d’autre part, les activités de prêt – j’ai eu de la part de son directeur général, Nicolas Dufourcq, des engagements.
Ils concernent d’abord l’organisation de la banque, pour qu’elle soit, en matière d’ESS, proche des territoires et des besoins des acteurs. Ces engagements portent ensuite sur la programmation de produits dédiés au financement de l’ESS, qui tiennent compte de la variété des structures, des besoins et des tailles.
Cela est loin d’être un défi facile. Car ce n’est pas la même chose, selon qu’il s’agit d’une petite structure qui démarre et qui a besoin d’un peu de trésorerie pour amorcer la pompe, ou d’une grosse structure mutualiste qui ouvre des centres de soins en milieu rural, ce qui demande des apports en fonds propres à hauteur de plusieurs millions d’euros. <br /> La BPI nous a proposé un éventail très complet de produits matérialisant cet engagement sur 500 millions d’euros.
Pouvez-vous préciser les aspects organisationnels de la BPI auxquels vous venez de faire allusion ?
Le conseil d’orientation de la BPI comptera un représentant de l’ESS en la personne de Jean-Louis Bancel, du Groupe coopératif et, par ailleurs, un membre de la direction générale se consacrera à l’ESS. Par ailleurs, il y aura des représentants de l’ESS dans les comités régionaux. Il ne faut pas se contenter de dire « 500 millions d’euros seront disponibles ». Il faut aussi introduire la culture de l’ESS au sein de la BPI.
Cette dernière ne regardera pas avec de grands yeux stupéfaits le plan d’affaires d’une association qui, bien que non lucrative, gagne de l’argent. Globalement, la BPI s’est engagée à ce que 90 % des dossiers soient examinés au niveau local. De façon naturelle, pour l’ESS, ce taux sera dépassé, car ce sont majoritairement de projets très ancrés dans les territoires.
Comment la BPI prendra-t-elle en compte les spécificités de l’ESS – notamment la lenteur des retours sur investissements par rapport à d’autres secteurs économiques – quand il s’agira d’évaluer l’efficacité économique de la banque ?
Le rendement d’un investissement dans l’ESS n’est pas celui que l’on attend dans un autre secteur : nous sommes sur du capital patient et les objectifs ne sont pas seulement économiques et financiers. L’impact en termes d’utilité sociale et de création d’emplois est assez considérable. La BPI a parfaitement intégré ces spécificités. Je veux que soit inscrite dans la loi l’obligation pour la BPI de suivre les structures de l’ESS qu’elle aura financées. Comme ce sera le cas pour les banques privées qui gèrent les crédits décentralisés d’épargne réglementée.
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) sont encore peu nombreuses. Faut-il les développer ?
Oui. Nous sommes là sur des formes de coopération très originales qui associent usagers, salariés, coll
ectivités. Pour cela, nous allons augmenter la part qui peut être prise par les collectivités au capital initial de SCIC. Aujourd’hui limitée à 20 %, la part maximale pourrait être de 50 %. L’idée est de favoriser l’augmentation du nombre de ces structures, qui ne sont que 217 aujourd’hui.
Quel bilan faites-vous des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) ?
C’est une très belle idée. Certes, les résultats sont assez inégaux, car l’expérience est encore jeune. Avec Cécile Duflot, Arnaud Montebourg et François Lamy, nous allons lancer un nouvel appel d’offres pour le financement de clusters de l’ESS, qui s’appuiera sur cette première expérience de PTCE. Ceux que j’ai pu voir, à Saint-Etienne, Romans, ou dans le Nord, fonctionnent bien et ont créé une vraie dynamique locale. Les relations qu’ils ont réussi à nouer avec l’économie dite classique donnent des résultats tangibles, par exemple en délocalisations évitées. Nous voulons multiplier les expériences et développer celles qui existent déjà.
Quel est le défi majeur pour l’économie sociale et solidaire ?
Il est paradoxal : il s’agit à la fois de sa banalisation et de sa reconnaissance. Il faut la banaliser, car je souhaite que l’ESS n’ait plus systémiquement à faire la preuve de sa performance. Pour preuve la durée de vie des SCOP qui est plus longue que celle des entreprises classiques.
Je veux que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire soient reconnues comme étant des acteurs économiques à part entière, que les chambres de commerce et d’industrie intègrent la biodiversité économique, que les tribunaux de commerce n’aient plus une approche biaisée de l’ESS, notamment sur la possibilité de reprise des entreprises par les salariés. C’est un travail important qui passera par la loi, la Banque publique d’investissement, le rôle de procureurs dans la reprise et la liquidation d’entreprises, etc.
La banalisation passera aussi par l’enseignement et l’inscription dans les manuels et programmes scolaires des différentes manières d’entreprendre. Il faut sensibiliser sur le fait qu’il existe, certes, une manière d’entreprendre qui domine, c’est la société de capitaux, mais qu’il y en a une autre, c’est l’économie sociale et solidaire, issue des traditions ouvrières et chrétiennes sociales. Nous avons besoin que ce modèle cesse d’être réduit à une économie de la réparation, où la non-lucrativité est assimilée à une économie subventionnée. Banaliser l’ESS, c’est la développer afin qu’elle soit plus intégrée au monde économique.
Mais il faut aussi que l’ESS soit reconnue dans sa spécificité. C’est l’objectif de la loi, qui va permettre d’exposer davantage ce mouvement à la lumière. Un vrai mouvement d’entreprendre autrement, qu’il revient au ministère d’organiser, ordonner, valoriser.
Vous êtes-vous fixé quelques objectifs chiffrés, en termes d’emplois ou de seuils à dépasser ?
Cela serait difficile à faire. Car, en fait, l’estimation du poids de l’ESS dépend du périmètre qu’on lui donne. De plus, la particularité de l’ESS, c’est que son poids ne se résume pas à la richesse qu’elle créée : elle évite aussi des coûts à la collectivité, et elle a un impact social, environnemental. J’ai d’ailleurs chargé Philippe Frémeaux, ex-dirigeant d’Alternatives Economiques, de rédiger un rapport sur la façon dont on peut évaluer le poids de l’ESS, à travers des critères d’appréciation qui intègrent la contribution de l’ESS à la cohésion sociale notamment.
L’ESS ne peut être appréhendée uniquement à travers les indicateurs économiques classiques que sont les parts de PIB et le nombre d’emplois rattachés. En matière de développement, le seul objectif chiffré que je me suis fixé concerne les SCOP : j’espère en doubler le nombre d’ici à la fin du quinquennat. C’est très ambitieux.
source : www.lagazettedescommunes.com
- Dossier THEMA – Réforme de la taxe sur les salaires : un enjeu systémique pour l’ESS - 26 février 2026
- Avis du CSESS sur les pistes de développement de l’ ESS – février 2026 - 23 février 2026
- Rapport du HCVA sur la gouvernance des associations en 2026. Propositions pour une nouvelle approche - 23 février 2026