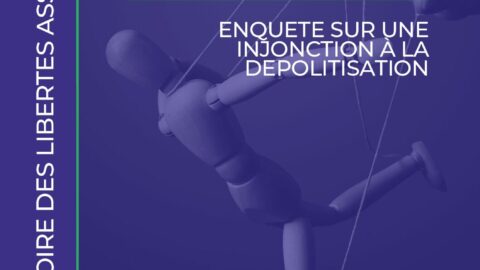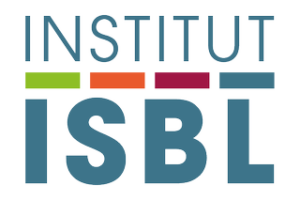On l’aurait presque oublié en raison de la crise sanitaire, mais il y a un an a été votée la loi PACTE pour encourager les entreprises à s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale et se donner une finalité autre que le profit. Vertueuse dans son intention, encourageante quant à la prise en compte des priorités sociales et environnementales par les décideurs politiques et économiques, la loi questionne aussi les organisations de l’ESS quant à leur identité et leur spécificité dans ce nouveau contexte.
Le 22 mai 2019 a été votée en France la loi PACTE, loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Destinée à « libérer les entreprises » et à «mieux récompenser le travail » pour stimuler l’activité et l’emploi, la loi fixait aussi un cap : « rénover le capitalisme du XXIe siècle, bâtir une économie responsable qui redonne confiance à nos compatriotes ». Lors du vote de la loi, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des finances, a posé le contexte : « une entreprise doit faire des profits ; mais elle ne peut pas faire que cela. Le capitalisme du XXe siècle est dans une impasse. Il a conduit à la destruction des ressources naturelles, à la croissance des inégalités et à la montée des régimes autoritaires.” D’où son souhait que cette loi puisse “redéfinir la place de l’entreprise dans la société” car “si une entreprise demain veut être profitable, reconnue par nos concitoyens, la raison d’être va devenir un passage obligé, pour mobiliser les salariés, les fournisseurs, les clients, les actionnaires autour d’un objectif commun”. Ainsi, la loi PACTE comporte de nombreuses mesures centrées sur l’efficacité économique des entreprises (simplification des seuils sociaux, facilitation des démarches en ligne, aide aux dirigeants des entreprises en redressement ou liquidation, assouplissement de la transmission des entreprises familiales, privatisations ….). Mais elle comporte aussi plusieurs mesures sociales pour les salariés (encouragement à l’épargne salariale, présence accrue au conseil d’administration) et introduit un volet tout à fait nouveau et structurant dans la législation française avec la redéfinition au sein même du Code Civil de la définition juridique de l’entreprise : la société.
Montée des revendications écologiques et sociales
Jusqu’à la loi Pacte, une société, c’était « deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (art 1832 Code Civil). En clair, une société avait pour but unique de partager un bénéfice ou de faire des économies ; sa finalité était 100% lucrative. Cette définition a structuré l’économie depuis le Second Empire et le vote en 1867 de la première loi instituant les sociétés anonymes pour encourager l’essor industriel jusqu’à aujourd’hui. Le cadre juridique n’a jamais changé depuis, façonnant une culture dominante privilégiant la « création de valeur » et la rémunération des actionnaires, considérés encore aujourd’hui comme les propriétaires et donc les décideurs ultimes légitimes dans une entreprise. Or au fil du temps, plus le capitalisme s’est mondialisé, financiarisé et exacerbé, plus la société civile en a souligné sa nocivité en termes sociaux et environnementaux.
Dès 1972, à la demande du Club de Rome réunissant décideurs et experts européens, un rapport intitulé « Limites à la croissance » a mis en évidence l’impasse sociale et écologique du modèle 100% capitaliste. Le rapport a été médiatisé, mais sans aucun effet sur la trajectoire politique, soutenue par une forte aspiration des consommateurs à accéder aux mêmes biens et services que les classes les plus riches. Puis est venu le rapport Bruntland en 1987 posant la définition du développement durable ; puis le premier Sommet à Rio en 1992 sur l’environnement. Et les Sommets s’enchaînent depuis avec l’introduction à petites touches de contraintes et obligations sociales et environnementales pour les entreprises. A l’échelon mondial et hors cadres sectoriels, la norme ISO 26000 fait désormais référence depuis 2010 et guide toutes les organisations vers une meilleure prise en compte des effets de leur activité sur l’environnement et leurs parties prenantes. En France, différentes lois et normes environnementales sont venues peu à peu responsabiliser les plus grandes entreprises : loi NRE en 2001 introduisant l’obligation d’un reporting social et environnemental, Grenelle 2 de 2009 pour favoriser les économies d’énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion des énergies renouvelables, instauration en 2017 d’un devoir de vigilance à l’égard des sous-traitants et pour respecter les droits humains ainsi que différentes mesures pour mieux associer les salariés au partage des richesses et du pouvoir dans l’entreprise… En résumé, la loi a introduit petit à petit des obligations sociales et environnementales, mais le cadre juridique du capitalisme est toujours resté le même sans être jamais remis en cause. Au point que ce référentiel de la finalité du profit est resté dominant dans les têtes et la culture pendant près de 200 ans, incitant ainsi les organisations privées fonctionnant sur d’autres buts, principalement l’ESS, soit à s’y conformer, soit à se marginaliser.
Une finalité élargie pour l’entreprise
2019 marque en France une rupture structurelle en élargissant le concept de société dans le Code Civil (datant de 1804). L’article 1832 reste inchangé : des associés créent toujours une société pour faire du profit ou des économies. Mais l’article 1833 qui définit l’objet d’une société (objet licite et dans l’intérêt commun des associés) est complété par l’alinéa : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité». Autrement dit, une société est à ce stade toujours créée par des personnes dans un intérêt économique, mais elle a désormais l’obligation de prendre en compte l’impact de son activité sur l’environnement et toutes ses parties prenantes. La mission première reste économique, mais un entrepreneur est désormais comptable de l’impact des externalités négatives de ce qu’il fait et juridiquement responsabilisé et donc attaquable sur les effets collatéraux de son activité. C’est la dimension RSE de la loi PACTE : la responsabilité environnementale et sociale au sens littéral du terme.
Cette première étape est importante puisque la RSE devient désormais obligatoire pour toutes les sociétés. Autrement dit, elle concerne les entreprises privées patrimoniales, mais aussi les entreprises publiques, para-publiques…. Et toutes les entreprises de l’ESS qui ne sont pas des associations loi 1901 ou des fondations. Ce qui représente – selon l’Observatoire national de l’ESS – 37 000 structures mutualistes et coopératives réunissant 550 000 salariés, soit 17% du total des structures et 23% des salariés sur le périmètre ESS auquel il faut ajouter les sociétés commerciales respectant les critères ESS. Juridiquement parlant, les associations loi 1901 ne sont donc pas concernées puisqu’elles ne sont pas des sociétés. Elles n’en restent pas moins soumises à leurs différentes lois et normes sectorielles ou particulières. Qui plus est, l’inscription de la RSE dans le Code Civil est aussi le reflet d’un changement de culture avec une attention plus forte de l’opinion pour le respect de l’environnement, la qualité de vie au travail, le respect du territoire, etc. Ce basculement de culture fera de plus en plus pression sur toutes les organisations économiques quelle que soit leur taille. La démarche RSE est plutôt nouvelle pour le monde associatif. Toutes les associations à but non lucratif employeuses ou presque servent de grandes causes d’intérêt général ou pallient un manque social non rempli par le marché ou la puissance publique. C’est ce qui donne sens à la mission que remplissent les bénévoles et salariés et les unit autour d’un but commun. Mais intégrer dans la gestion de la structure la qualité de vie au travail des salariés, le respect des fournisseurs, des territoires sur lesquels on agit, sur sa communauté et son environnement naturel en minimisant sa consommation de ressources, d’énergie, en gérant ses déchets, etc. est loin d’être évident quand on consacre depuis des décennies toute son énergie à servir sa cause d’intérêt collectif ou général… Et que les moyens manquent, notamment financiers, pour y faire face.
Raison d’être et société à mission
Au-delà de la prise en compte des impacts d’un métier sur l’environnement, la loi PACTE va plus loin. Elle permet désormais à une société de se doter si elle le souhaite d’une raison d’être, inscrite cette fois au cœur de son métier et qui en exprime la finalité. L’article 1835 du Code Civil qui définit les mentions à prévoir dans les statuts précise désormais qu’une société peut y inclure « une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité». Ici, pas d’obligation, pas de contrainte, mais une option ouverte aux entreprises qui veulent graver dans leurs statuts le fait que le profit n’est pas pour elles une finalité, mais un moyen au service d’un intérêt supérieur, social, sociétal ou environnemental. Autrement dit, une entreprise commerciale ordinaire peut désormais garder ses statuts de société à but lucratif, garder les mêmes mécanismes de création de valeur, mais s’inscrire dans une démarche analogue à celles des ISBL dans lesquelles l’argent est un moyen mais pas une fin.
La loi PACTE va plus loin encore. Dans son article 176, elle introduit dans le titre 1er du livre II du Code de Commerce la qualité de « société à mission » (articles L. 210-10 à L. 210-12) qui définit non seulement une raison d’être – sociale, sociétale, environnementale ou les trois – mais aussi les moyens de mettre en pratique cette raison d’être et d’en évaluer régulièrement la mise en œuvre. Concrètement, une entreprise qui veut être société à mission doit mettre en place un « comité de mission », distinct des autres instances de direction et chargé de présenter annuellement un rapport dédié à l’assemblée générale sur la mise en œuvre de la raison d’être. La loi ajoute que « L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI), selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat. ». Un décret d’application du 2 janvier 2020 est venu préciser les modalités de désignation de l’OTI, ses pouvoirs et la fréquence de ses vérifications qui auront lieu au moins tous les deux ans.
Contraintes propres à l’ESS
Dès lors, si toutes les entreprises peuvent se définir désormais une finalité d’intérêt général ou collectif comme les organisations ESS et inscrire cette finalité dans le marbre avec des contraintes pour en suivre la mise en œuvre, comment désormais différencier l’ESS et le privé lucratif, surtout dans le cas de grandes organisations, notamment mutualistes ou coopératives ? Ce changement annonce t-il une convergence progressive à venir du droit régissant les unes et les autres? Et comment peut-on raisonnablement penser qu’une entreprise à but lucratif puisse raisonnablement prioriser sa mission tout en conservant un statut qui privilégie la finalité de profit ? La réponse à ces questions est analysée et explorée dans l’excellent guide « loi PACTE, comment passer à la pratique » produit par l’ORSE, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en janvier 2020 et qui est à date l’outil de référence pour tout comprendre de la loi PACTE, ses enjeux, ses conséquences et ses modalités possibles de mise en œuvre concrètes. Très complet, le guide a quatre objectifs principaux : décrypter et faire comprendre la loi, éclaircir les nombreux débats que la loi a suscités et suscite encore, démontrer l’intérêt de cette loi et accompagner les entreprises qui veulent passer à l’acte.
Concernant l’ESS, le guide explique que l’objectif du gouvernement n’est pas de créer des confusions ou de la remettre en cause, mais « de créer une quatrième voie : l’économie responsable (à côté de l’action publique, de l’Économie Sociale et Solidaire, et l’économie de marché), parvenant à concilier le but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux ». L’ORSE et son partenaire le C3D (Collège des Directeurs du Développement Durable) expliquent que les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) peuvent opter pour le statut de “société à mission” en toute cohérence avec leur identité ESS. Le rapport rappelle que le cadre d’une organisation ESS tel que prévu par la loi de 2014 est plus contraignant que celui d’une société à mission puisqu’il implique une gouvernance démocratique, une lucrativité limitée, des titres de capital non négociables et lorsqu’on a un agrément ESUS, d’avoir un lien entre l’utilité sociale et le compte de résultat ainsi qu’une politique de rémunération encadrée. Le respect de toutes ces conditions peut donner droit qui plus est à des spécificités, voire avantages fiscaux. Dans la loi, rien n’est prévu en ce sens pour les sociétés à mission, mais d’autres mesures pourraient survenir par décret ou autres dispositifs. Dans une interview du 13 avril au quotidien économique La Tribune, Olivia Grégoire, députée LREM, vice-présidente de la Commission des Finances et Pascal Demurger, directeur général de la mutuelle MAIF qui est devenue elle-même société à mission, affichent leur priorité de vouloir encourager l’essor rapide des sociétés à mission en France et en Europe, et pour ce faire à proposer des avantages dont pourraient bénéficier les sociétés à mission : accès facilité aux marchés publics, emprunts à taux d’intérêt adoucis, moindre imposition …. Le cadre n’est donc pas figé, mais à ce jour, il y a bien des différences précises entre organisation ESS et société à mission.
Concilier lucrativité et raison d’être
Second aspect de la question: comment peut-on imaginer qu’une entreprise à but lucratif – notamment si elle est cotée en Bourse – puisse raisonnablement changer son logiciel pour ne plus être guidée par l’EBITDA ou le dividende à verser en fin d’année et prioriser l’affectation de ses ressources vers son objet social contre l’intérêt de ses actionnaires ? Ne serait-ce pas une utopie vaine et naïve? La crise sanitaire du Coronavirus et le choc de récession économique qu’elle a engendré donne quelques indications. Au 22 avril, une vingtaine de groupes cotés avaient annoncé qu’ils ne verseraient aucun dividende en 2020 (Accor, Airbus, ADP, Atos, Bureau Veritas, Coface, CNP Assurances, EDF, Eiffage, Elis, Engie , Essilor, FNAC Darty, JC Decaux, Maisons du Monde, M6, Safran, TF1, Thalès, Vallourec et toutes les banques et leurs filiales : source Boursorama et Capital). Chez LVMH, Kering ; Schneider Electric, Sodexho de même que Michelin, ce sont les rémunérations des dirigeants qui sont revues à la baisse pour 2020. Un constat à première vue rassurant car totalement inédit, mais à tempérer compte tenu du cadre posé par l’Etat : d’accord pour des aides exceptionnelles (report d’échéances fiscales et sociales, prêts garantis) mais à condition de ne pas verser de dividendes et ne pas procéder à des rachats d’actions en 2020. On comprend mieux ces annonces vertueuses alors qu’en temps ordinaire, difficultés ou pas, les grands groupes continuent de rémunérer leurs actionnaires et de verser des primes et indemnités considérables à leurs dirigeants en plus de salaires déjà substantiels voire démesurés. Par-delà ces quelques cas de suppression de dividendes, quelques autres groupes annoncent des dividendes réduits, parfois symboliquement, certains s’interrogent, d’autres comme Danone annoncent le report de versement et tous les autres continuent comme avant à chouchouter leurs actionnaires. Autrement dit, pandémie mondiale ou pas, pour l’essentiel, les sociétés à actionnaires gardent la même politique de priorité aux actionnaires. Business as usual. Conclusion : à première vue, difficile d’imaginer que société à mission ou pas, une entreprise à but lucratif inverse réellement ses finalités.
Suivi et contrôle obligatoires
Pourtant, c’est bien la voie qu’ont ouverte en France quelques entreprises qui se sont transformées en sociétés à mission et ont fondé la Communauté des Entreprises à Mission, réunissant aujourd’hui plus ou moins 70 membres.
Certains de ces membres sont des grandes entreprises comme Danone, Camif, Bjorg, Nature & découvertes… Et la MAIF, Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France et entreprise d’économie sociale. Bon nombre des membres de cette Communauté sont des entreprises qui, de longue date, sans attendre l’évolution du Droit, se sont préoccupées des enjeux éthiques de leur activité quand ce n’était pas leur activité elle-même qui avait une visée éthique (par exemple Science & Nature). En décidant de se transformer en société à mission et de rejoindre d’autres sociétés à mission, toutes ces entreprises espèrent pouvoir essaimer au-delà de leur propre entreprise pour engager plus largement la société dans une démarche d’entrepreneuriat socialement et écologiquement responsable. Avec la loi PACTE, l’ambition est de limiter les risques de green washing : d’une part, l’inscription de la raison d’être dans les statuts engage nécessairement les actionnaires qui, s’ils souscrivent des titres, le font donc en connaissance de cause ; et d’autre part, le statut de Société à mission oblige donc à mettre en place un Comité de suivi, à tenir les administrateurs et actionnaires informés et à être suivis par un OTI, organisme tiers indépendant. Certes, mais malgré ce nouveau dispositif, va t-on vraiment réussir à ce que les dirigeants et administrateurs mettent le profit comme moyen et non comme but dans une entreprise qui a des actionnaires à satisfaire ? Dans le cas de PME familiales ou de petites sociétés avec actionnariat fermé, on peut le concevoir. Mais quid des grandes entreprises confrontées à d’énormes enjeux financiers et à la pression d’un large actionnariat et/ou engagé en Bourse ? Même un dirigeant volontariste et engagé ne peut pas tout.
Contenir la demande des actionnaires
Ce sont les Etats-Unis qui les premiers ont impulsé des réponses à cette question et largement inspiré les chercheurs et le législateur français. Selon Wikipédia : « Les premières formes de sociétés à mission ont été introduites en droit aux USA en 2010. Ces formes exigent l’introduction d’une finalité (purpose) dans les statuts des sociétés… Trois formes d’entreprise à mission existent aux États-Unis : la Benefit Corporation, adoptée dans plus de 30 états, la Social Purpose Corporation, adoptée dans 3 états et la Public Benefit Corporation, adoptée en 2015 au Delaware ». A ces lois sont venues s’ajouter le label B Corp (Benefit Corporation). Créé en 2006, le label repose sur un cahier des charges strict : un premier questionnaire pour être éligible, puis la démarche de certification moyennant prestation de 500 à 50 000 $. B Corp a réussi un petit tour de force : 80 000 entreprises auraient postulé dans 60 pays, avec 2 800 entreprises certifiées dans 150 métiers et de toutes tailles. Parmi les plus connues figurent en France Patagonia, Nature et Découvertes, Blédina (filiale de Danone), Ben & Jerry’s et donc une entreprise de l’ESS, la MAIF. Aux yeux de ceux pour qui l’ESS doit être une force de transformation sociale systémique et remplacer le capitalisme, la société à mission ne change pas la donne. Dans la réalité, les entreprises qui ont fait ce choix sont bel et bien dans une démarche qui engage leurs actionnaires et forcément, n’attireront que des actionnaires convaincus. Difficile de faire pression pour prioriser le versement de dividendes quand les statuts acceptés par les mêmes actionnaires prévoient une autre priorité ainsi que le résume le guide PACTE de l’ORSE : « La raison d’être est une protection pour les dirigeants afin qu’ils protègent les engagements sociaux et environnementaux de l’entreprise qu’ils puissent s’autoriser d’autres objectifs que la rentabilité à tout prix ». En revanche, toute la difficulté est de savoir si la démarche peut être durable dans le temps au fil des changements d’actionnaires et de dirigeants. La question est aussi de savoir si d’autres entreprises vont suivre, lesquelles, combien, quand et en combien de temps.
Une option pour l’ESS
Pour l’ESS, la loi PACTE est l’occasion de repenser son projet, ses pratiques (et peut-être son périmètre), mais ne remet pas en cause ses fondamentaux. D’un point de vue général, l’ESS ne peut que se réjouir de cette prise de conscience croissante des décideurs de la nécessité de promouvoir un capitalisme plus responsable au plan social et environnemental et qui rend moins pressante la priorité au rendement financier. L’enjeu pour l’ESS est de savoir plutôt si ses spécificités et besoins propres sont suffisamment reconnus et si la loi PACTE peut être d’un apport bénéfique pour servir son propre projet et améliorer ses pratiques. Sur la reconnaissance de ses spécificités, l’ESS française peut se satisfaire d’être encadrée par une loi dédiée depuis 2014. Mais sur les moyens de mettre en œuvre et développer son utilité sociale, beaucoup reste à faire comme l’illustre encore la crise sanitaire du Coronavirus dans le secteur de la santé, du sanitaire et social ou comme l’illustre la difficulté à rendre de bons services sur les publics qui n’intéressent pas le privé traditionnel faute de rentabilité.
Redéfinir son rôle dans un monde complexe
Sur la loi PACTE, toutes les organisations ESS relevant du Code Civil sont donc impactées par l’article 1833 incluant l’obligation de prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux et a contrario, les associations loi 1901 et les fondations ne le sont pas. Concernant l’ajout d’une raison d’être, l’intérêt pour l’ESS peut paraître mineur puisque ses entreprises ont déjà par nature une finalité de service. La réalité est plus nuancée. Les statuts d’une organisation ESS définissent leur objet social tourné vers les membres (service d’un intérêt collectif) et/ou plus largement vers des besoins sociaux ou environnementaux (service d’un intérêt général). Si les statuts contiennent un préambule précisant le projet et les valeurs qui sous-tendent le projet, inclure une raison d’être peut sembler superflu. Si au contraire, les statuts sont plus juridiques, techniques, factuels, il peut être utile d’y ajouter une formulation plus contextuelle avec une raison d’être. Au-delà de la rédaction des statuts, se définir une raison d’être peut être particulièrement important pour les grandes organisations fédérant et mettant en jeu un très grand nombre d’acteurs, clients, sociétaires, membres, salariés, bénévoles, partenaires, etc. Il peut être tout à fait important de se doter d’un cap formellement rédigé auquel toutes les parties prenantes d’une organisation puissent se référer. Traditionnellement, les grandes organisations revisitent périodiquement leur projet stratégique et/ou formalisent une Charte, un Projet d’entreprise ou tout autre document équivalent. La raison d’être s’inscrit dans cette logique de projet d’entreprise, mais dans un cadre légal plus engageant et plus pérenne. Ainsi le groupe coopératif agricole In Vivo, le plus gros en France, qui fédère un agrégat d’entreprises coopératives de second voire troisième niveau, a choisi pour raison d’être : « fédérer les coopératives pour transformer durablement l’agriculture et assurer la qualité alimentaire en France et dans le monde». Toujours dans le monde coopératif, Arkéa, entité du groupe Crédit Mutuel, s’est donné pour cap d’être « un acteur d’un monde qui se conçoit sur le long terme et prend en compte les grands enjeux sociaux et environnementaux pour les prochaines générations. .. En pratiquant une finance au service des territoires et de leurs acteurs qui s’inscrit dans la durée et aide chacun à se réaliser... ». Se définir une raison d’être n’est pas redondant avec la mission d’utilité sociale des organisations ESS et peut même la renforcer. Même quand on est une entreprise publique avec par définition une mission d’intérêt général, il peut être pertinent de se définir une raison d’être. C’est le processus qui est en cours actuellement par exemple chez EDF ou à la SNCF.
Renforcer son reporting extra-financier
Concernant le troisième étage de la loi PACTE et l’option de devenir une société à mission, l’enjeu principal porte sur l’intérêt de pouvoir mettre en place un dispositif de mise en œuvre, suivi interne et contrôle périodique par un OTI (organisme tiers indépendant). Pour les entreprises de l’ESS, cette obligation est à mettre en perspective des obligations d’évaluation extra-financière auxquelles elles sont déjà assujetties ou non. Côté associations (et fondations), rien d’obligatoire sinon le bilan social à partir de 300 salariés. Logique : par nature tournée vers une finalité non lucrative, on suppose que le rapport annuel de l’association rend effectivement compte de son activité issue de l’objet social et c’est donc plutôt sur sa gestion qu’elle est attendue par le législateur. D’où l’obligation de tenir des comptes et d’avoir un suivi financier : l’obligation des associations est le miroir inversé de celles de l’entreprise lucrative contrôlée sur sa responsabilité extra-comptable. Dans le cas des fondations, seules celles reconnues d’utilité publique ont aussi une obligation de rapport annuel non seulement envers ses administrateurs et membres, mais aussi envers l’Etat via la préfecture.
Pour les organismes ESS ayant statut juridique de société (coopératives, mutuelles, SA ou SARL d’utilité sociale), il existe des obligations de reporting extra-financier. Les coopératives doivent tous les 5 ans faire une Révision coopérative quinquennale concentrée sur le respect des principes de fonctionnement coopératif. Les mutuelles ont des obligations inscrites dans le Code de la Mutualité sur le respect de la priorité du service aux adhérents et de leur fonctionnement démocratique en tant que sociétés de personnes (et non de capitaux). Les mutuelles sont aussi fortement contraintes sur leurs règles de prudence financière à l’échelon européen et international. Enfin, les SA et SARL d’utilité sociale disposant d’un agrément ESUS ont un certain nombre de règles à respecter et doivent renouveler cet agrément tous les 5 ans. Dans les trois cas, ces obligations sont concentrées sur les domaines et principes de fonctionnement spécifiques à leur appartenance à l’ESS, mais ne portent pas sur toutes les dimensions de suivi des externalités liées à leur mission et sont distinctes de l’esprit de suivi de la raison d’être inscrit dans la société à mission. De ce point de vue, la société à mission peut selon les cas apporter un cadre de reconnaissance externe et interne de la validité de la démarche ESS grâce justement à ce dispositif de suivi et de contrôle externe reconnu par la loi. C’est le choix qu’a fait par exemple la MAIF.
Une option cohérente pour la MAIF
Celle-ci s’est définie une raison d’être qui peut paraître surprenante : « Convaincus que seule une attention sincère portée à l’autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions». Très général, très flou, cet intitulé démontre que raison d’être et objet social sont deux choses distinctes. D’autant que l’objet social de la MAIF est clairement défini dans l’article 7 de ses statuts : « établir entre ses membres une assurance mutuelle contre tous les risques dont la législation autorise la garantie et de pratiquer, dans les limites de la réglementation applicable à la société, des opérations de toute nature se rattachant directement ou indirectement à l’activité d’assurance. Elle peut notamment mener des actions de prévention ». Cet article 7 est indissociable de l’article 1er sur le contrat associatif mutualiste : « il est formé entre toutes les personnes physiques ou morales adhérant aux présents statuts une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances ». Ces deux articles définissent d’une part le métier de la MAIF et par ailleurs le fait que ce soit une mutuelle propriété de l’association des adhérents mutualistes. De ces deux articles découlent ensuite les mécanismes de pouvoir, d’organisation interne, de gouvernance, de financement. Tout est dit. Donc pas besoin d’ajouter une raison d’être paraphrasant l’objet social et l’organisation mutualiste : on comprend mieux que celle de la MAIF soit si générale : il s’agit moins de redéfinir une mission déjà définie par les statuts que de donner à cette mission un chapeau correspondant à des valeurs, à une culture que l’entreprise veut pérenniser. La MAIF n’avait pas forcément besoin de se redéfinir une raison d’être au sens du métier, mais elle ressentait le besoin de l’inscrire dans une perspective et des valeurs. Et elle voulait devenir société à mission pour donner ainsi une portée pratique à la mise en œuvre de ses engagements RSE dans toutes ses dimensions. En faisant ce choix, la MAIF décide de s’obliger à mettre en place un suivi et le contrôle de sa démarche, visibles de l’extérieur et sous le contrôle de la loi. En devenant société à mission, la MAIF donne à son statut de mutuelle une dimension supplémentaire inscrite dans le monde complexe et exigeant d’aujourd’hui, dans lequel il faut non seulement rendre service à ses membres avec partage et solidarité, mais aussi en étant responsable avec tout son éco-système : d’abord ses salariés qui rendent service aux adhérents, ainsi que les fournisseurs, les partenaires, les territoires et communautés où l’on agit et la société toute entière. L’exemple de la MAIF montre qu’appartenir à l’ESS et devenir une entreprise à mission n’est pas forcément redondant, voire renforce sa mission d’économie sociale en lui donnant une portée adaptée aux enjeux RSE de demain.
Loi PACTE, un progrès qui ne résout pas tout
En synthèse, un an après le vote de la loi et dans le contexte de crise sanitaire qui réinterroge nos sociétés sur le rôle et les priorités à donner à l’économie, la loi PACTE témoigne surtout de la traduction dans le droit de pratiques amorcées par quelques entreprises pionnières. Elle fait un pas décisif sur la RSE en inscrivant dans le droit l’obligation pour une entreprise d’être responsable à l’égard de toutes ses parties prenantes et de l’environnement. Pour le reste, elle trace un chemin avec des options qui visent essentiellement à faire modifier le comportement des entreprises engluées aujourd’hui dans la course au profit et la rémunération des actionnaires. Rien ne dit aujourd’hui que la loi atteindra son but. Ce qui est sûr, c’est que raison d’être ou pas, aucune loi ne fera disparaître les contraintes et aléas propres à toute organisation humaine : tensions, conflits de pouvoir, d’egos ou d’ambitions, vie au travail assujettie à la qualité du management, pressions concurrentielles, éloignement ressenti entre la base et le sommet et bien sûr contraintes gestionnaires, etc.
Concernant l’ESS, la loi PACTE interpelle surtout les plus grandes organisations, celles qui sont confrontées aux enjeux économiques, financiers, sociaux, humains les plus importants et qui sont souvent mises en cause dans leurs pratiques et ne seraient de fait pas en conformité avec leur appartenance ESS. Les critiques sont justifiées quand on dénonce les rémunérations faramineuses de tel ou tel dirigeant ou que telle décision stratégique est prise avec une transparence démocratique de façade ou de complaisance. Elles ne le sont pas quand on dénonce un mal-être au travail ou une mauvaise gestion RH. Certes, on peut attendre d’une Scop, coopérative de travailleurs, qu’une attention toute particulière soit portée à la relation entre les membres travailleurs et la coopérative, d’où l’importance de la RH. Mais dans toute autre structure de l’ESS dans laquelle les membres sont des bénéficiaires extérieurs (clients, usagers, entreprises…), la gestion RH – si on peut espérer qu’elle soit de qualité bien sûr compte tenu des valeurs humaines revendiquées par l’ESS – n’est pas du tout inscrite dans la mission première de l’organisation.
De même, aucune loi, dispositif d’évaluation ou de contrôle n’évitera jamais les risques de défaillance, velléité de contournement, tricheries, erreurs ou mauvaises pratiques. De ce point de vue, l’ESS a connu certaines dérives, mais force est de reconnaître que les scandales les plus nombreux et les plus retentissants résultent du capitalisme financier (Crédit Lyonnais, Enron, Lehman & Brothers, Société générale, crise des subprimes, etc. La liste est longue). Les lois permettent de faire avancer le Droit et donc de progresser. Mais elles ne sont jamais infaillibles et donc il ne faut pas attendre de la loi PACTE ce qu’elle ne peut pas changer.
Les premières entreprises engagées dans le processus de raison d’être ou de sociétés à mission sont des organisations déjà engagées dans la RSE ou une mission d’intérêt social, public ou intérêt général. La question est de savoir maintenant si toutes les autres entreprises moins pionnières vont ou non leur emboîter le pas. Le risque n’est pas nul que la loi PACTE finalement, ne soit particulièrement utile aux entreprises de l’ESS et entreprises publiques et ne touche pas sa cible initiale des entreprises tournées aujourd’hui sur le 100% lucratif.
Pierre LIRET
Expert coopératif, consultant, enseignant
En savoir plus :
Gouvernement : Que sont les sociétés à mission ?
« Loi PACTE et raison d’être : si on passait à la pratique » guide ORSE / C3D (janvier 2020)
Rapport méthodologique du Comité IMPACT de suivi et d’évaluation de la loi PACTE (déc. 2019)
Communauté des Entreprises à Mission
Ecole Mines ParisTech : Chaire Théorie de l’Entreprise – Modèles de Gouvernance et Création Collective
Rapport 2018 mission « Entreprise et intérêt général » Jean-Dominique Senard et Nicole Notat
- Sociétés à mission : enjeux pour l’ESS - 23 février 2026
- Duralex, symbole du deux poids deux mesures - 24 novembre 2025
- L’arlésienne du financement des Scic - 28 mai 2025