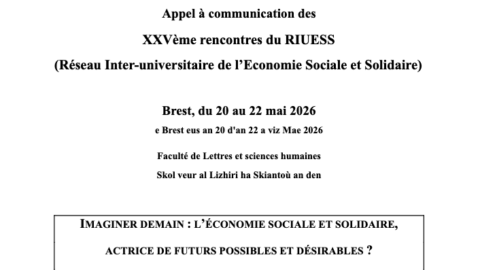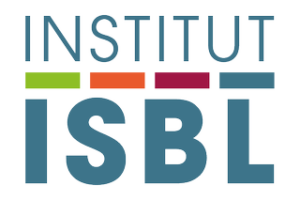Timothée Duverger, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux et directeur de la Chaire TerrESS, a récemment publié Utopies locales, les solutions écologiques et solidaires de demain (Les Petits Matins, 2021). Dans son ouvrage, il dépeint le foisonnement des solutions locales expérimentées par l’économie sociale et solidaire, qui esquissent le « monde d’après ». Nous lui avons posé trois questions.
Timothée Duverger, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux et directeur de la Chaire TerrESS, a récemment publié Utopies locales, les solutions écologiques et solidaires de demain (Les Petits Matins, 2021). Dans son ouvrage, il dépeint le foisonnement des solutions locales expérimentées par l’économie sociale et solidaire, qui esquissent le « monde d’après ». Nous lui avons posé trois questions.
C.D. – Comment voyez-vous le monde de demain ?
T.D. – Schématiquement, nous pouvons écrire deux scénarios pour anticiper le monde de demain. Le premier, dystopique, est fait de guerres pour l’accès aux ressources, de migrations climatiques, d’États autoritaires… Je ne m’y attarderai pas. A la différence des collapsologues, qui nous annoncent l’effondrement prochain, je crois davantage dans la force mobilisatrice des récits positifs.
Le second se fonde sur la résilience des territoires face aux crises, correspondant à ce que j’ai proposé de nommer des « utopies locales ». Cette notion est un oxymore bien sûr. Etymologiquement, l’utopie – qui vient du grec « topos » (lieu) précédé du préfixe « u » – c’est l’absence de lieu. Lui accoler le « local » est contre-intuitif. L’utopie appartient au domaine de l’imagination. Mais ce sont des expériences bien réelles que je retrace.
L’observation des tendances à l’œuvre laisse entrevoir un scénario où ces utopies locales, se multipliant, atteindraient une masse critique suffisante pour devenir le levier d’un basculement. Historien de formation, je ne me risquerais pas à faire des prédictions sur l’avenir. Mais j’insiste sur son caractère ouvert. Les bifurcations sont toujours possibles quoique jamais évidentes. Rappelons le célèbre aphorisme de Marx : « Les hommes font l’histoire, mais ils ne savent pas qu’ils la font ».
Bref, si une montée en généralité des utopies locales devait advenir, nous aurions réussi la transition vers une démocratie permanente où les citoyens sont invités à prendre une part active dans les décisions qui les concernent, de nouvelles solidarités à la fois redistributives et développant le lien social, une sobriété dans l’usage des ressources pour plus de soutenabilité, et la liberté des initiatives et des créativités de la société civile.
C.D. – En quoi la crise du Covid-19 peut-elle aussi générer des opportunités ?
T.D. – La crise du Covid-19 comporte d’abord des risques. Risque sanitaire bien sûr avec la propagation du virus et de ses variants. Mais aussi risques économiques et sociaux avec le ralentissement voire l’arrêt de l’activité économique, l’essor non cadré du télétravail porteur de risques psychosociaux, l’isolement notamment des personnes âgées…
Comme toute crise, elle peut aussi amener de nouvelles protections, parce qu’elle révèle ce qui n’était auparavant que des fragilités silencieuses pour lesquelles il est maintenant nécessaire de construire des solutions.
Il en va ainsi en particulier des jeunes de 18-25 ans dont la situation, déjà précaire, est aujourd’hui très lourde avec l’arrêt des petits boulots et le développement des cours à distance. Pressé, le gouvernement a déjà répondu par des aides d’urgence, mais aussi des dispositifs comme le plan « un jeune, une solution » ou l’élargissement de la garantie jeunes. Mais j’ai le sentiment – et si j’en juge les files d’attente d’étudiants pour l’aide alimentaire à Paris, c’est plus qu’un sentiment – que ces évolutions restent largement insuffisantes.
Ce sont les collectivités locales qui se montrent les plus offensives. Une vingtaine de départements ont eu l’intuition de déposer dès 2018 une proposition de loi d’expérimentation d’un revenu de base, dont l’une des principales caractéristiques est de couvrir les jeunes de 18-25 ans, quelle que soit leur situation. Quel dommage qu’elle ait été rejetée sans débat par l’Assemblée nationale ! Nous aurions eu là un dispositif précieux pour amortir les effets de la crise. Pire, bien que la proposition de loi ait été de nouveau déposée par Boris Vallaud et Hervé Saulignac ces dernières semaines, elle a de nouveau été bloquée. Dans ces conditions, on ne peut que saluer l’initiative du Grand Lyon qui vient de voter l’expérimentation d’un revenu de solidarité jeunes.
Parmi les « nouveaux » pauvres révélés par la crise, il y a également les indépendants, dont les activités ont été directement impactées, soit par la fermeture des commerces dits « non essentiels » soit par le ralentissement de la consommation, et les femmes, que notre système socio-fiscal familialiste pénalise.
Quand on pointe le problème que représente l’exclusion des jeunes des minimas sociaux, et notamment de ceux qui habitent chez leurs parents, on soulève la question de l’individualisation du dispositif. Concrètement il s’agit de détacher les jeunes du foyer. Pourquoi n’en ferait pas autant pour tous les individus, et en particulier les femmes qui en seraient majoritairement gagnantes ? Le sujet de fond, c’est l’autonomie. Il ne s’agit pas seulement d’assurer un revenu de survie, mais bien de changer la vie.
C.D. – Comment l’économie sociale et solidaire peut-elle contribuer à la construction d’un futur désirable ?
T.D. – L’économie sociale et solidaire (ESS), c’est le « monde d’après » déjà là. Il n’y a pas besoin d’attendre les lendemains qui chantent, pas davantage une intervention providentielle. Elle agit ici et maintenant en fournissant des cadres d’action aux citoyens qui veulent concevoir et mettre en œuvre des solutions couplant l’urgence écologique et les nouvelles solidarités.
Une foule d’expérimentations locales défrichent les possibles, innovent socialement et construisent des partenariats public-ESS, privé-ESS ou public-privé-ESS, comme dans les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) qui mettent en synergie les initiatives pour dynamiser les territoires. Energies citoyennes, mobilités alternatives, foncières solidaires, résilience alimentaire, économie circulaire… autant d’utopies locales, d’idées transformatrices qui trouvent à s’expérimenter sur les territoires pour changer de référentiel.
L’enjeu, c’est d’inventer une société post-croissance. L’injonction du « toujours plus » est sans cesse remise en cause à l’épreuve des faits. Elle aboutit à pressurer les ressources humaines et naturelles pour des résultats limités. Nous vivons dans une société de croissance… sans croissance ! Et on y perd le sens. L’économie prime sur la vie, on crée des besoins artificiels pour faire tourner un système qui dysfonctionne de plus en plus et produit des dégâts écologiques et sociaux.
Il est urgent de revoir notre modèle de développement dans le sens d’une quête du bien-être partagé. Pour cela, l’économie sociale et solidaire doit définir son projet politique et s’ouvrir. C’est pourquoi j’ai été très sensible à l’appel pour une République de l’ESS de Jérôme Saddier. L’économie sociale et solidaire doit décider des causes pour lesquelles elle s’engage : la lutte contre le réchauffement climatique, contre les inégalités… Elle doit forger des alliances, avec les acteurs publics comme avec les acteurs privés qui veulent s’impliquer dans les transitions. Emmanuel Faber, alors PDG de Danone, a récemment été évincé par des fonds d’investissement en raison de ses engagements pour l’entreprise à mission. On ne peut pas rester sur ce constat d’échec de la responsabilité sociale des entreprises ! Si le « monde d’après » n’est pas qu’un slogan, il revient à l’économie sociale et solidaire de trouver un chemin en montrant l’exemple et en fédérant autour de son projet.
Interview réalisée par Camille DORIVAL, consultante et journaliste
En savoir plus :
AGORA – Webinaire : Changer de cap avec l’ESS, des utopies aux réalisations
- Communs et économie solidaire. Récit d’expériences citoyennes pour un autre monde - 27 octobre 2023
- Communs et économie solidaire au cœur des enjeux de transition écologique et sociale : à la rencontre de Fanélie Carrey-Conte et Philippe Eynaud - 27 octobre 2023
- Réinventer le mutualisme, de Christian Oyarbide - 26 mai 2023