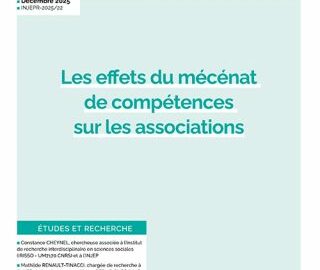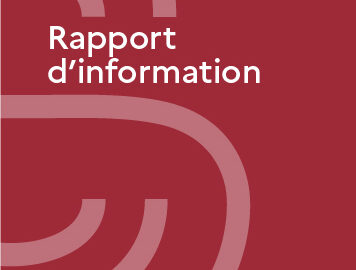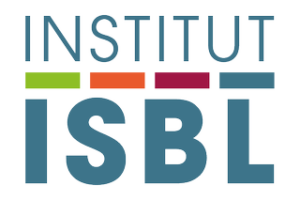Adoptée par la Commission européenne en septembre 2023 et soutenue par le Parlement européen en mars 2024, la proposition de directive relative à l’association transfrontalière européenne (ATE) constitue une avancée historique pour la liberté d’association et l’économie sociale et solidaire (ESS). Mais, sous l’influence de certains États – dont la France – le texte est aujourd’hui menacé. Refuser cette directive, c’est prolonger une vision défensive et nationaliste du secteur associatif, à rebours de l’Europe du lien et de la confiance.
L’essentiel
L’Europe a reconnu juridiquement les sociétés anonymes, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Il manquait encore le maillon essentiel : un statut européen pour les associations à but non lucratif agissant dans plusieurs États membres.
L’ATE comble ce vide.
Elle donnerait aux acteurs de la société civile un cadre stable, démocratique et reconnu à l’échelle du continent, leur permettant d’exercer librement leurs missions sociales, éducatives, environnementales ou culturelles.
Ce texte n’est pas un simple ajustement technique : il est un instrument de liberté, d’unité et de transition démocratique.
Le parcours européen : une avancée en suspens
Présentée par la Commission européenne le 5 septembre 2023, la proposition COM(2023) 516 a été approuvée par le Parlement européen le 13 mars 2024. Le texte prévoit la création d’une Association transfrontalière européenne (ATE) reconnue dans tous les États membres, dotée de règles minimales de gouvernance démocratique et de transparence financière. Mais le Conseil de l’Union, où siègent les gouvernements nationaux, tarde à se prononcer. Parmi les pays qui freinent, figure la France – paradoxalement, la patrie historique de la liberté d’association (loi 1901). Ce blocage n’est pas juridique ; il est politique.
Les freins français : la crainte de l’autonomie associative
Le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a rendu en décembre 2023 un avis favorable, estimant que la directive « ne fait pas obstacle au droit français ». Mais, en mai 2024, une proposition de résolution parlementaire n° 2656 et un rapport n° 2694 ont demandé son abandon pur et simple. Son auteur y voit une « atteinte à la souveraineté associative » et une « complexification inutile ». Cette initiative, purement politique et non contraignante, a entretenu un doute dommageable sans modifier la position officielle de l’exécutif.
Résultat : la France – pourtant patrie de la liberté d’association (Loi 1901) – ralentit un texte qui incarne précisément cet esprit à l’échelle européenne.
Cette initiative traduit une méfiance persistante envers la société civile organisée. Derrière ce repli se cache une autre logique : celle du contrôle idéologique des associations, déjà expérimentée en France à travers le contrat d’engagement républicain (CER) issu de la loi « séparatisme » de 2021.
Quand le modèle français devient un repoussoir européen
Dans un article du Journal du Dimanche (« Financement d’associations islamistes : la France, l’Autriche et les Pays-Bas font pression sur Ursula von der Leyen », 2025), on apprend que ces trois États plaident pour que la directive européenne intègre des clauses de contrôle idéologique proches du CER français. Cette tentative inquiète nombre d’acteurs européens : elle revient à transposer à l’échelle de l’Union une logique nationale de suspicion préventive, contraire à l’esprit même de la Charte des droits fondamentaux.
En France, cette logique a déjà produit des effets délétères :
- Retrait ou suspension de subventions sur la base de formules imprécises (« atteinte aux valeurs républicaines »),
- Auto-censure des associations critiques des politiques publiques,
- Insécurité juridique accrue pour les structures œuvrant dans les champs de la solidarité, de la défense des droits ou de la culture.
Comme le rappelait l’Institut ISBL dans sa tribune « Loi confortant le respect des principes de la République : une histoire de détournement de pouvoir » (2023), la liberté associative ne saurait être conditionnée à l’allégeance à un discours politique officiel ; elle n’est pas une concession de l’État, mais un droit fondamental.
Transposer cette logique au niveau européen serait un contre-sens démocratique majeur.
Les effets bénéfiques de la directive pour l’économie sociale et solidaire
L’adoption de la directive ATE représenterait une opportunité stratégique pour le développement de l’ESS dans toute l’Union.
Elle faciliterait :
- L’intégration économique du tiers secteur européen
- Harmonisation partielle des cadres juridiques nationaux : plus de reconnaissance mutuelle des associations agissant sur plusieurs territoires.
- Simplification des coopérations transnationales dans les champs de l’insertion, de la santé, de la transition écologique, de l’éducation populaire.
- Meilleur accès aux fonds européens (ESF+, Horizon Europe, Erasmus+, LIFE) pour les structures locales ou régionales.
- L’innovation sociale et territoriale
- Mutualisation de projets inclusifs et socialement innovants : circuits courts, recycleries, énergies citoyennes, logement partagé.
- Création de consortium européens de l’ESS, dotés d’une personnalité juridique reconnue.
- Circulation facilitée des bonnes pratiques entre acteurs associatifs, coopératifs et publics.
- La cohésion sociale et démocratique
- L’ATE consacrerait la société civile comme acteur à part entière de la construction européenne, au même titre que l’entreprise ou la collectivité.
- Elle renforcerait la citoyenneté active européenne, aujourd’hui en déficit, en permettant aux citoyens de s’organiser librement au-delà des frontières.
- En rendant les associations plus visibles et plus sûres juridiquement, elle favoriserait la confiance dans la démocratie représentative et participative.
- La transition écologique
- Nombre de projets climatiques et environnementaux dépassent les frontières administratives : bassins fluviaux, zones côtières, réseaux d’énergie citoyenne.
- La directive offrirait un cadre stable pour ces coopérations locales-globales, en cohérence avec le Green Deal européen.
Les apports concrets pour le droit français
-
- Reconnaissance automatique de la personnalité morale en Europe pour les associations françaises à vocation transnationale.
- Mobilité du siège et continuité juridique en cas de transfert.
- Encadrement commun des principes de non-lucrativité, de transparence et de gouvernance démocratique.
- Modernisation indirecte du droit 1901 : valorisation internationale du modèle français d’engagement civique, plutôt que repli administratif.
Un manifeste pour l’adoption du texte
L’Union européenne ne peut prétendre défendre la démocratie sans reconnaître les acteurs qui la font vivre.
La liberté d’association n’est pas une variable de sécurité, mais le fondement même de la citoyenneté européenne.
Nous appelons le Conseil de l’Union européenne à :
- Adopter sans délai la directive ATE,
- Refuser toute dérive sécuritaire ou idéologique qui transformerait la société civile en suspect permanent,
- Reconnaître la contribution économique, sociale, démocratique et écologique des associations à la construction européenne.
Parce que les frontières ne devraient jamais limiter la solidarité,
Parce qu’une Europe sans société civile n’est qu’un marché sans âme,
Parce que la liberté d’association est la condition première de toute démocratie,
Parce que la confiance est plus forte que la peur.
Nous appelons à l’adoption définitive et sans altération de la directive sur l’Association transfrontalière européenne.
Institut ISBL
En savoir plus :
- Mutualisation : pourquoi l’enjeu fiscal conditionne l’avenir de l’action collective de l’ESS ? - 26 janvier 2026
- Sortir de la sidération - 26 janvier 2026
- Les assises de la démocratie en organisations 3ème édition : Outiller la démocratie - 20 janvier 2026