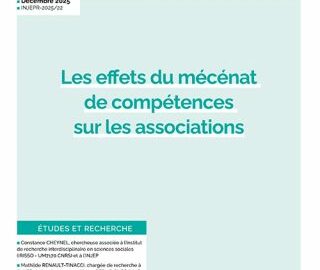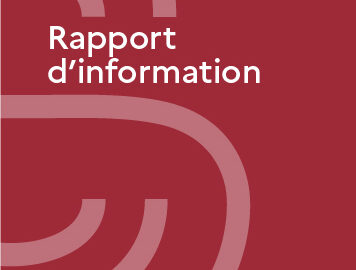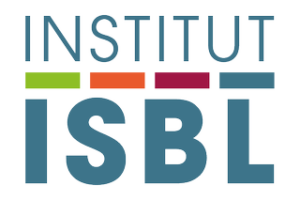Dans un contexte marqué par des tensions budgétaires accrues et des incertitudes institutionnelles, les associations se trouvent de plus en plus fréquemment confrontées à des difficultés financières majeures. Par conséquent, il est impératif pour les dirigeants de ces organismes à but non lucratif d’anticiper ces difficultés, avant qu’elles ne deviennent irréversibles.
Possibilité d’obtention de délais de paiement auprès des administrations fiscales et sociales
Les dettes fiscales et sociales, en raison de leur nature particulière, ne peuvent bénéficier de délais de paiement que par la seule autorité des organismes publics compétents, notamment la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) pour les impôts et l’URSSAF pour les cotisations sociales. En effet, contrairement aux dettes civiles ou commerciales, la loi réserve à ces administrations la faculté exclusive d’accorder des reports, échéanciers ou remises.
Lorsqu’une association rencontre des difficultés financières, elle doit donc formuler une demande motivée auprès des services concernés, en justifiant de sa situation et en proposant un échéancier réaliste. L’administration peut alors accorder des délais, suspendre temporairement les pénalités et intérêts de retard, voire consentir des remises partielles dans des cas exceptionnels, conformément aux articles L. 247-1 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF) et aux règles du recouvrement social.
Sur le plan jurisprudentiel, la Cour de cassation a confirmé que l’octroi des délais de paiement en matière fiscale relève de la compétence exclusive de l’administration, qui exerce un pouvoir discrétionnaire apprécié souverainement (Cass. civ. 1re, 22 juin 2006, n°05-16.618). De plus, la jurisprudence administrative reconnaît que l’administration peut refuser un délai de paiement si les conditions ne sont pas réunies, notamment si l’organisme ne démontre pas de difficultés sérieuses (CE, 21 juin 2013, n°354580, consultable sur Légifrance).
S’agissant des dettes fiscales et sociales, la Cour de cassation a rappelé que seuls les organismes publics compétents peuvent accorder des délais de paiement pour les cotisations, et qu’en cas de litige, les recours s’exercent devant les juridictions administratives ou sociales (Cass. soc., 3 mars 1994, n°90-15.524). Cette décision établit clairement que les juges judiciaires n’ont pas compétence pour substituer leur décision à celle de l’URSSAF en matière de délai.
Enfin, les associations doivent veiller à saisir rapidement ces organismes afin de bénéficier de ces dispositifs préventifs, évitant ainsi le risque d’engagement de procédures coercitives (saisie, pénalités aggravées) ou collectives. Le refus d’un échéancier peut faire l’objet d’un recours gracieux, puis contentieux devant le tribunal administratif, comme l’illustre la décision CE, 28 février 2017, n°398109.
Prévention et règlement des difficultés financières des associations
Face à cette réalité, le droit français prévoit plusieurs dispositifs destinés à accompagner les structures associatives dans la prévention et la gestion de ces difficultés, avant qu’elles ne deviennent irréversibles. Ce cadre juridique relevant principalement du Code de commerce, bien que souvent méconnu, offre des outils diversifiés – délais de grâce, mandat ad hoc, conciliation, procédures collectives – permettant aux associations de négocier avec leurs créanciers, de lisser leur passif, ou encore d’envisager une restructuration encadrée. Leur mise en œuvre dépend de la compétence, soit du Tribunal judiciaire, soit du Tribunal des affaires économiques dans le cadre de l’expérimentation en cours.
- Les délais de grâce : un aménagement judiciaire des obligations
L’article 1343-5 du Code civil autorise les associations en difficulté à solliciter auprès du juge un report ou un échelonnement de leurs dettes, dans la limite de deux années, sous réserve de la situation financière de l’association et des intérêts des créanciers. Cette demande est recevable y compris en appel (Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 20-12.598). Toutefois, l’octroi de ce délai relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. 1re civ., 5 juill. 1988, n° 86-17.768 ; Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, n° 05-16.517). Il est néanmoins exclu pour les dettes relevant d’une procédure collective, pour les créances salariales (Cass. soc., 18 nov. 1992, n° 91-40.596), ou pour les effets de commerce (C. com., art. L. 511-81 et L. 512-3).
- Le mandat ad hoc : une négociation assistée
Prévu à l’article L. 611-3 du Code de commerce, le mandat ad hoc permet à une association, par décision du président du tribunal territorialement compétent, de bénéficier de l’appui d’un mandataire chargé de négocier avec ses principaux créanciers. Cette procédure confidentielle n’interrompt pas les actions individuelles (Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17.377), n’oblige pas les créanciers à accepter l’accord proposé et ne dispense pas l’association de déclarer son éventuelle cessation des paiements (Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-11.554). Elle peut cependant servir de levier pour obtenir des échéanciers viables et éviter l’engagement d’une procédure collective.
- La conciliation : un cadre temporaire de négociation
La procédure de conciliation (C. com., art. L. 611-4 et s.) vise à favoriser un accord amiable entre l’association et ses créanciers. Pendant cette phase, les poursuites individuelles ne sont pas automatiquement suspendues, mais l’association peut demander des délais de paiement au Juge. En revanche, tant que la conciliation est en cours, aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être engagée par un créancier (C. com., art. L. 631-5 et L. 640-5). Le juge peut conditionner l’octroi des mesures gracieuses à la conclusion effective d’un accord (CA Aix-en-Provence, 26 févr. 2015, n° 14/05046). Enfin, il convient de noter que, par dérogation, une association engagée dans une procédure de conciliation peut solliciter une procédure de sauvegarde accélérée, permettant une restructuration plus rapide de ses dettes (C. com., art. L. 628-1 et s.).
- La graduation des procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation
En fonction de la gravité de ses difficultés, une association peut accéder à plusieurs types de procédures collectives. La procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 620-1 et s.) est ouverte aux structures qui, sans être en cessation des paiements, rencontrent des difficultés juridiques, économiques, managériales ou financières qu’elles ne peuvent surmonter (CA Paris, 9 déc. 2021, n° 21/11049). Si l’association est en cessation des paiements, elle peut être placée en redressement judiciaire si un plan de continuation est envisageable. L’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité pour l’association de faire face à son passif exigible (correspondant aux dettes échues) à partir de son actif disponible (correspondant à la trésorerie et aux éléments réalisables immédiatement – CA Bastia, 5 juin 2019, n° 18/00891 ; CA Paris, 6 juin 2017, n° 17/01904). Il est un moment important pour les dirigeants associatifs, ces derniers disposant d’un délai de 45 jours pour déclarer cette situation au Tribunal. Au-delà, ces mêmes dirigeants commettent une faute de gestion susceptible d’engager leur responsabilité propre à partir de leur patrimoine personnel.
Le non-respect des obligations légales, notamment le défaut ou le retard dans la déclaration de cessation des paiements, constitue un élément de preuve classique de la faute de gestion. La cour retient alors la date effective de la cessation des paiements et la compare à la date de déclaration pour établir le manquement du dirigeant (CA Versailles, 13ème chambre, 1er mars 2012, n° 11/05299 ; CA Paris, Pôle 5 chambre 8, 20 septembre 2022, n° 20/07088). La poursuite d’une activité déficitaire, alors que la situation financière de l’association ne le permettait plus, est également retenue comme une faute de gestion. Les juridictions s’appuient sur les documents comptables, les bilans, et la chronologie des décisions de gestion pour établir que le dirigeant a maintenu l’activité en connaissance de cause (CA Versailles, 13e chambre, 11 juillet 2023, n° 22/06627 ; CA Lyon, 10 janvier 2013, n° 10/07838).
Conclusion
Ces différents dispositifs juridiques renforcent la capacité des associations à rebondir et à préserver les emplois salariés existants sans passer directement par une liquidation, si tout redressement apparaît impossible (C. com., art. L. 631-1 et L. 640-1). Ils doivent donc être connus des dirigeants associatifs, également parce qu’ils ont pour objectif de sécuriser leur situation en tant que bénévoles en évitant de les placer dans des situations souvent périlleuses.
- Les assises de la démocratie en organisations 3ème édition : Outiller la démocratie - 20 janvier 2026
- INJEP : Les effets du mécénat de compétences sur les associations - 16 janvier 2026
- Décret n° 2025‑1191 : implications pour les associations - 16 janvier 2026