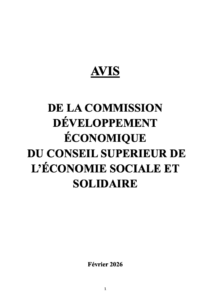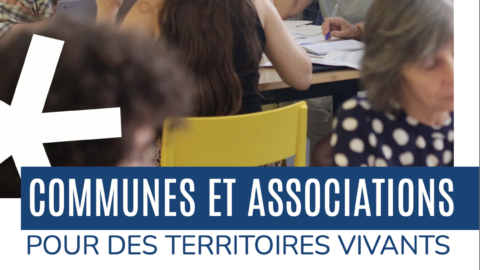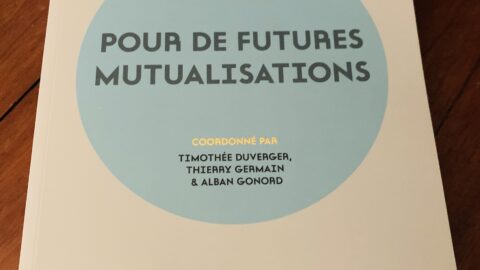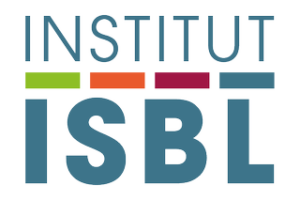Le 7 avril 2025 la Cour des comptes européenne a publié un rapport (11/2025) sur la Transparence des financements accordés par l’Union européenne à des ONG. Dans ce rapport la Cour rappelle le souci légitime des citoyens européens de connaître la destination des fonds versés par l’UE et les Etats membres dans le cadre de programmes communautaires. On comprend et partage ce souci car pour la période auditée (2021-2023) les subventions octroyées atteignent 7,4 milliards d’euros qui se décompose en 4,8 milliards pour la Commission et 2,6 milliards pour les états membres dans le cadre de programmes communautaires. La Cour a relevé que 12000 ONG ont bénéficié pour cette période de ces financements.
Dans ses conclusions la Cour formule plusieurs remarques et adresse des recommandations.
Il n’est pas question pour moi ici de reprendre tous les points techniques soulevés par la Cour mais plus simplement de faire quelques observations générales sur le rôle des ONG dans la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne d’une part et d’autre part, et c’est pour moi l’essentiel, de m’interroger sur la définition du sigle ONG exercice qui ressemble à la quadrature du cercle.
D’une façon générale il est clair que les ONG, qui sont des structures organisées de la société civile, contribuent non seulement à la réalisation des politiques voulues par l’Union européenne mais sont des partenaires indispensables de la mise en œuvre de ces politiques. L’objet du rapport 11/2025 ne concerne que le cadre intérieur de l’action de l’UE mais, si je reprends le rapport de 2018 qui avait pour objet l’action extérieure de l’UE, rappelons simplement, par exemple, que l’action humanitaire de Bruxelles est mise en œuvre presque uniquement par des ONG comme Action contre la faim, Médecins du monde, OXFAM ou Terre des hommes pour ne citer que celles là. Que ce soit lors de la guerre des Balkans dans les années 90 ou au Proche Orient, sans que cette liste soit limitative, les ONG ont été le « bras » humanitaire de l’UE pour le meilleur et pour le pire car beaucoup se sont interrogés sur les finalités de cette action. Mais ce n’est pas le lieu ici de s’interroger sur cette problématique même s’il y aurait beaucoup à dire.
Un autre point qui ne sera pas développé ici mais qui le mériterait : les ONG sont indispensables au maintien de la démocratie. Tous les régimes autoritaires ont commencé par limiter la liberté d’action des ONG avant de la supprimer purement et simplement. Voir le cas de la Russie, de nombreux Etats africains et il semble qu’Israël sous l’impulsion de son gouvernement actuel soit en bonne voie de ce point de vue là.
Maintenant au-delà de ces considérations, revenons sur un point soulevé par la Cour dans son rapport : quelle définition pour une ONG ?
Il ne s’agit pas d’un simple exercice intellectuel mais pratiquement cela a une importance. En effet, prenons le cas de l’action humanitaire. La recherche d’une définition était importante. Il y a déjà quelques années certains groupements du monde marchand se posaient la question de solliciter des subventions auprès d’ECHO, l’agence de l’Union européenne en charge de l’action humanitaire, en faisant valoir qu’ils pouvaient fournir des prestations à moindre coût que les ONG. Pourquoi pas ? Après tout, le monde marchand n’est-il pas déjà omniprésent dans le domaine de la santé ? Alors si on voulait réserver cette action à des ONG encore fallait-il les définir ?
Définir une ONG : le serpent de mer
Un peu d’histoire.
Il y a déjà plus d’une dizaine d’années la Cour des comptes de l’Union a demandé à la Commission de lui fournir une définition des ONG. C’est chose faîte semble-t-il même si le rapport demande que l’on apporte plus de précision dans cette définition. L’union définit ainsi une ONG : Organisation bénévole, indépendante des pouvoirs publics, sans but lucratif, qui n’est ni un parti politique ni un syndicat. Cette définition est-elle satisfaisante ? Autrement dit recouvre-t-elle une réalité fonctionnelle ?
Mais prenons acte de cette définition.
Rappelons ici dans un petit historique édifiant sur la complexité de la définition, que le sigle ONG est apparu pour la première fois à l’article 71 de la Charte des Nations unies, que cet article a été introduit à la dernière minute car, selon les historiens des organisations internationales, il ne figurait pas dans le dernier « draft » soumis à l’approbation des Etats lors de la conférence de San Francisco. Cet article ne définit pas les ONG mais spécifie qu’une ONG peut être une organisation internationale ou nationale. Le problème n’était pas nouveau car déjà en 1910 l’Institut de droit international demandait un statut international pour les associations agissant dans plusieurs pays et donc une définition et cette demande a été renouvelée en 1923 et 1950. A ce jour il n’existe toujours aucune définition d’une ONG universellement admise et même au sein des Nations unies les agences, programmes ou organisations ont chacun une définition plus ou moins différente. Il n’existe qu’un seul instrument normatif international définissant les ONG entré en vigueur le 1er janvier 1991 : il s’agit de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales communément appelé Traité STE 124.
Cette Convention a été ratifiée par : France, Autriche, Belgique, Chypre, Grèce, Liechtenstein, Macédoine du nord, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse.
Cette Convention définit ainsi une ONG ou OING :
- Avoir un but non lucratif d’utilité internationale
- Avoir été créée par un acte relevant du droit interne d’un Etat Partie
- Exercer une activité effective dans au moins deux Etats
- Avoir leur siège statutaire sur le territoire d’une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d’une autre Partie.
Dans son rapport la Cour rappelle que sur les 27 Etats membres de l’Union, 6 ont une définition et 21 n’ont aucune définition. Remarquons en passant que parmi les six qui ont une définition ne figure ni la Belgique, ni la France, ni les Pays-Bas, ni le Portugal alors même que ces Etats ont ratifié la Convention européenne et ont donc accepté une définition des ONG. Comprenne qui pourra.
Quoi qu’il en soit une autre observation s’impose ici : malgré tout le travail accompli par le Conseil de l’Europe pour que cette Convention soit ratifiée, il faut bien reconnaître que c’est un échec car seuls 12 Etats ont ratifié ce traité sur les 47 Etats membres et que malgré de nombreuses campagnes incitatives, tous les membres de l’Union européenne n’ont pas ratifié ce traité.
L’auteur de cet article, qui fut longtemps un praticien qui a participé aux réunions du Conseil de l’Europe sur ces questions et qui professionnellement a été confronté à l’absence de personnalité juridique des ONG dans un pays comme la Russie pour ne citer que celui là, peut témoigner des entraves graves auxquelles les ONG se trouvent confrontées : impossibilité d’avoir un siège social, impossibilité d’ouvrir un compte bancaire, impossibilité de recruter du personnel etc. Bref impossibilité de travailler alors que les besoins dans le pays sont criants.
Alors pourquoi tant de difficultés pour trouver une définition juridique aux ONG à cet » objet juridique non identifié « , comme le disait le doyen Mario Bettati ?
A mon sens et pour faire très court c’est que les ONG, OING ou autres organisations de la société civile organisée, pour reprendre les termes d’un rapport déjà ancien des Nations unies, sont des structures qui dérangent les Etats et que ces derniers n’ont eu de cesse depuis la création des organisations internationales gouvernementales (OIG) il y a un peu plus d’un siècle, de réduire le rôle des ONG dans la sphère politique internationale.
Peut-on imaginer des ONG intervenant à l’Assemblée générale des Nations unies aujourd’hui ? Non. Et pourtant l’ancêtre de l’ONU, la Société des Nations, permettait cela. Peut-on imaginer une OIG tripartite regroupant des syndicats ouvriers et patronaux et des Etats aujourd’hui ? Il reste un vestige : le BIT (Bureau international du travail).
Les ONG dérangent. Elles sont souvent les derniers témoins sur le terrain pour dire la réalité des choses et les crimes qui se commettent, elles sont bien avant la lettre des lanceurs d’alerte comme dans l’environnement et cela ne plaît pas. Définir les ONG et leur accorder un statut n’est malheureusement pas à l’ordre du jour.
- ONG : l’impossible définition - 27 avril 2025
- Le rapport de la Cour des comptes sur le mécénat ou comment aborder le problème par le petit bout de la lorgnette - 26 février 2019
- Faut-il avoir peur des ONG ? - 26 juillet 2017