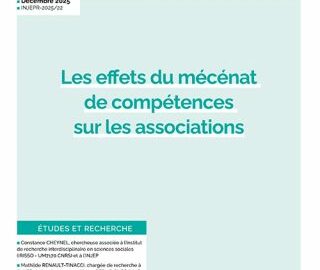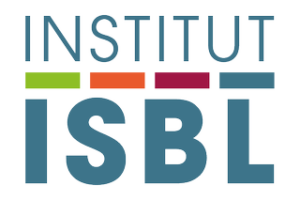Dans une société où la défiance progresse plus vite que les solutions permettant de la juguler, les résultats du Baromètre de la confiance 2025 livrent un diagnostic sans ambiguïté : les Français doutent de l’avenir collectif, mais continuent de considérer les associations et fondations comme un repère fiable. À l’heure où les attentes de transparence, d’efficacité et d’éthique se renforcent, les organisations à but non lucratif doivent se saisir de ces enseignements pour consolider la relation avec leurs publics et préserver un cercle vertueux essentiel à la cohésion sociale.
Un paysage marqué par la défiance, où le monde associatif demeure un repère solide
Le Baromètre de la confiance 2025 dresse un tableau sans concession : seuls 20 % des Français se disent confiants dans l’avenir de la société, et la confiance interpersonnelle chute de huit points en un an (53 %). Le discrédit est particulièrement marqué envers les institutions politiques, dont les niveaux de confiance atteignent des planchers historiques.
Dans ce contexte, les associations et fondations font figure d’exception. Avec 60 % de confiance (71 % chez les donateurs réguliers, 72 % chez les bénévoles), elles restent l’un des principaux repères de proximité et d’action. Un capital précieux, mais qui s’érode légèrement et doit être interprété comme un signal d’alerte plutôt qu’un acquis.
Le don : un geste structuré par la confiance
Les résultats 2025 confirment que la confiance est le premier déterminant du don. Elle constitue même le premier frein : 65 % des Français évoquent le manque de confiance avant le manque de moyens (56 %). Cette hiérarchie éclaire la nature profonde de l’engagement : un acte fondé d’abord sur une projection positive, sur l’idée qu’une action individuelle a un effet tangible.
La typologie des donateurs, construite en 2024 par Don en Confiance, illustre cette évolution : les « engagés d’une cause » (41 %) constituent la catégorie majoritaire, structurée par la qualité du lien plutôt que par la répétition mécanique d’un geste. L’engagement repose sur un rapport de confiance durable, nourri par des preuves tangibles.
Pour consolider ce lien, les critères décisifs sont parfaitement identifiés : traçabilité des dons (58 %), efficacité de l’action (51 %), affichage clair des missions, contrôle indépendant et transparence financière, chacun dépassant les 60 % dans les marqueurs de confiance. Ces attentes correspondent précisément aux pratiques de rendu compte et de rigueur sur lesquelles repose l’agrément Don en Confiance.
Ce que les donateurs attendent : lisibilité, rigueur et preuves
Les attentes exprimées par les Français sont désormais explicites et très stables. Les facteurs clés de confiance reposent sur des dimensions internes, évaluables et institutionnelles :
- Rendre compte des actions (65 %),
- Afficher clairement les missions et les respecter (64 %),
- Assurer une gestion rigoureuse des dons (63 %),
- Garantir la transparence financière (62 %),
- Être soumis à un contrôle indépendant (61 %).
La confiance se construit donc moins sur le discours que sur la structuration des processus internes. Elle exige une capacité à démontrer, expliquer et documenter l’impact.
La reconnaissance par un tiers constitue un facteur d’amplification de la crédibilité, en répondant directement aux exigences d’assurance et de traçabilité exprimées par les citoyens : 69 % des Français déclarent qu’un organisme indépendant garantissant la bonne utilisation des fonds les incite à donner, avec un effet encore plus marqué chez les donateurs réguliers (82 %). Au-delà d’un simple cadre de conformité, être contrôlé et agréé par un tiers devient un levier stratégique de crédibilité, en réduisant l’asymétrie d’information et en sécurisant le lien entre les organisations et les citoyens.
Un cadre fiscal sous tension : un risque réel pour la société
Les résultats montrent également la sensibilité du don au cadre fiscal. Si les avantages fiscaux étaient réduits, un Français sur deux diminuerait le montant ou la fréquence de ses dons. Cette donnée confirme le rôle essentiel de la fiscalité comme instrument de stabilisation du financement des associations.
A l’heure où le secteur fait face à une érosion des financements publics et à une demande sociale croissante, toute fragilisation du cadre fiscal viendrait affaiblir l’un des rares acteurs encore perçus comme fiables.
Le don comme marqueur sociologique : un état d’esprit plus qu’un profil
Le baromètre montre que la générosité est corrélée à un rapport positif au monde. Les donateurs se déclarent plus intégrés, solidaires, heureux et utiles que la moyenne des Français. Autrement dit, le don n’est pas seulement un geste financier, mais une manière de se relier à la société.
Le geste de don nourrit un sentiment d’utilité – 77 % des Français s’y sentent utiles, 91 % chez les donateurs réguliers – et participe à recréer une dynamique positive dans un contexte anxiogène.
Ce point est essentiel : le don n’est pas seulement un acte de générosité, c’est une manière d’habiter le monde, de revendiquer une capacité d’agir et de maintenir vivante l’idée d’un collectif.
Mais ce cercle peut se rompre si la confiance se délite.
Protéger un cercle vertueux fragile
Les données 2025 soulignent une évidence : la confiance est un actif stratégique pour les organisations à but non lucratif. Elle ne se décrète pas, elle se prouve. Et elle exige une vigilance de chaque instant.
Dans un climat de défiance généralisée, les associations et fondations restent des piliers de confiance. Mais ce statut n’est pas garanti. Seules des pratiques lisibles et évaluables – rigueur de la gouvernance, transparence, redevabilité, respect des parties prenantes, communication sincère – permettront de préserver un lien essentiel à la confiance démocratique.
Conclusion : protéger un cercle vertueux menacé
Le baromètre 2025 rappelle que les associations et fondations demeurent l’un des derniers remparts de confiance dans la société française. Elles portent un rôle d’intégration, de solidarité et de proximité que les citoyens reconnaissent explicitement. Mais cet équilibre reste fragile. Toute atteinte à la stabilité du cadre fiscal, toute perte de transparence ou toute dégradation du lien avec les donateurs pourrait casser un mécanisme essentiel à la cohésion sociale.
Renforcer la confiance, c’est donc renforcer la démocratie. Et c’est précisément la mission que poursuit Don en Confiance : instaurer des standards exigeants, offrir des assurances tangibles et bâtir, avec les associations et fondations, la confiance de demain.
Rachel Guez, Directrice Générale Don en Confiance
En savoir plus :