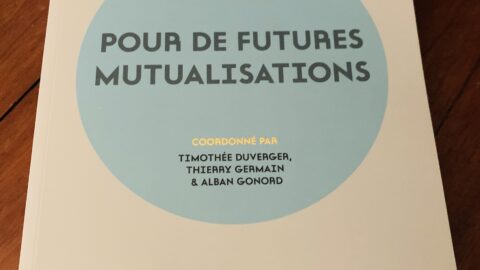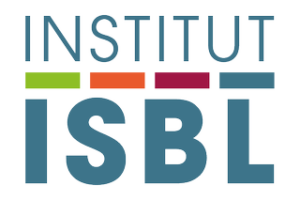L’éducation populaire constitue un levier politique et critique, indispensable pour repenser les rapports sociaux et ouvrir la voie à de nouveaux horizons collectifs. Elle doit remettre au cœur du débat les enjeux écologiques et sociaux abandonnés par le néolibéralisme, tout en inventant ses outils et méthodes de travail.
La question du financement des structures d’éducation populaire suscite, si l’on en croit plusieurs sources récentes, une inquiétude croissante : en 2025, 18 % des associations étaient contraintes de licencier pour préserver leur trésorerie (D’Alguerre, 2025) ; de plus, malgré une autofinanciation de 73 %, les 27 % de subventions publiques restent essentielles, surtout dans les territoires défavorisés (Artcena, 2025). Certaines MJC, dont une sur deux était en déficit en 2022, témoignent de la fragilité croissante de leur modèle économique (Le Monde, 2024).
Au final, l’éducation populaire représente un soubassement historique dans le domaine social et économique, et son maintien devrait prédominer sur les arbitrages budgétaires à brève échéance ; les intérêts concernés débordent du cadre local, si l’on considère son budget annuel de 26 milliards d’euros, ses 430 000 associations et les 467 000 emplois du secteur. (Educavox / An@é, 2025).
Trop souvent, ces structures sont perçues comme des « remorques » des pouvoirs publics, dépendantes de financements dont la pérennité demeure incertaine. Or, si l’on souhaite penser une « optimisation haute » de l’éducation populaire, il est nécessaire de la replacer dans un contexte plus large, comme celui qu’appellent Dardot et Laval (2010) avec leur réflexion sur la construction des communs et l’émancipation des individus.
Les travaux de Lebon (2025) corroborent les intérêts structurels, en démontrant qu’en France, l’éducation populaire est basée sur une fragmentation progressive du travail éducatif, impactant aussi bien des aspects du travail hors emploi (volontariat, service civique, bénévolat) que différents professionnels (musiciens, sportifs, animateurs). Cette disposition est toujours parcourue par des dynamiques de reproduction sociale, tout en apportant des réponses à un raisonnement basé sur l’émancipation.
En parallèle, l’analyse d’Hexopée (2025) remémore que l’éducation populaire ne peut être uniquement associée à un programme culturel ou éducatif, mais représente également un domaine social et économique de premier plan, avec ses 6 millions de bénévoles, son budget de 26 milliards d’euros, ses 430 000 associations et 467 000 salariés, soit 1 % du PIB français. Cette dimension illustre son influence inéluctable en matière d’ancrage territorial, d’insertion professionnelle et de cohésion sociale.
Néanmoins, la problématique majeure reste l’aptitude des citoyens à passer à l’action pour se transformer en authentiques acteurs et actrices. La vocation cruciale de l’éducation populaire se trouve dans cette problématique : accompagner et aider la formation de subjectivités agissantes. Ainsi que le remémore Maurel (2023), l’enjeu n’est pas uniquement de communiquer des savoirs, mais également de donner la possibilité aux individus de « s’éduquer ensemble par l’intermédiaire du monde » (p. 142).
De ce fait, pour quelle raison persister à plaider la cause de l’éducation populaire ? Sans doute car elle représente un mécanisme collectif d’émancipation, de conscientisation et d’élucidation. Elle structure l’action collective et l’expérience individuelle, tout en faisant obstacle aux instrumentalisations de l’Etat et aux diktats du marché. Selon l’étude Hexopée (2025), les attributaires de l’éducation populaire montrent une confiance accrue dans leur aptitude à choisir leur orientation et rebondir dans le domaine professionnel, de même qu’ils déploient plus de compétences transversales (prise de responsabilité, sens du travail en équipe, aptitude à la communication) que les non attributaires.
Toutefois, un certain nombre de challenges restent à relever. Des associations restent focalisées sur des doléances financières, alors mêmes qu’elles n’arrivent pas à énoncer des solutions clairement identifiées. Néanmoins, ainsi que formulé par Lebon (2025), l’éducation populaire doit permettre la politisation des sujets écologiques et sociaux que le néolibéralisme a laissé à l’abandon et a aussi pour mission de tout mettre en œuvre pour créer d’autres méthodes de travail, créer ses outils propres et caractériser les méthodes à employer.
Appréhendée de cet angle, l’éducation populaire, loin de se cantonner à une offre limitée d’activités éducatives ou culturelles, est un moyen d’action historique, un instrument permanent, politique, mutuel et critique, dont le but est de métamorphoser les rapports sociaux et de contribuer à la mise en place d’imaginaires collectifs nouveaux (Maurel, 2023)
André Decamp, Doctorant en travail social, codirection Université de Montréal et Université Libre de Bruxelles
En savoir plus :
Artcena. (2025, 31 juillet). L’éducation populaire menacée. Artcena.
Hexopée. (2025). Étude d’impact : L’éducation populaire en France. Eurogroup Consulting.
Maurel, C. (2023). Repenser l’éducation populaire comme levier d’action. Nectart, 17(2), 136-148.
Socialter. (2025, 5 mai). L’éducation populaire, fragile et sous pression politique.
- Repenser l’éducation populaire : financements, subjectivités et enjeux contemporains - 19 septembre 2025
- La mesure d’impact social dans l’ESS : le cas de la chaîne de valeur d’impact, mythe ou réalité ? - 25 février 2025
- Engagez-vous qu’ils disaient, vous verrez du pays ! - 29 septembre 2024