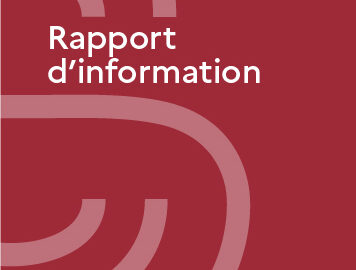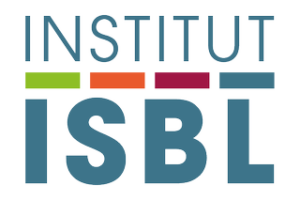Découvrez notre entretien avec Julien Talpin[1]Julien Talpin est directeur de recherche au CNRS, directeur-adjoint du CERAPS (UMR 8026 – Université de Lille). Il est co-directeur du Groupement d’intérêt scientifique « Démocratie … Continue reading, coauteur avec Antonio Delfini[2]Antonio Delfini est docteur en sociologie, chercheur associé au CLERSE, Université de Lille. Il est l’auteur au sein du Collectif Degeyter de Sociologie de Lille (La Découverte, 2017) et … Continue reading de l’ouvrage : L’État contre les associations, Anatomie d’un tournant autoritaire (éditions Textuel, septembre 2025), où ils dénoncent le virage autoritaire des relations entre l’État et les associations et proposent des actions concrètes pour riposter face à ces attaques.
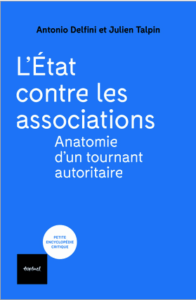 JPB – Depuis une dizaine d’années, un engrenage de lois et de dispositions sécuritaires semble avoir entraîné un débordement de l’antiterrorisme en direction de la sphère associative. Le confirmez-vous et quelles sont les grandes modalités des contraintes et entraves applicables aux associations en 2025 ?
JPB – Depuis une dizaine d’années, un engrenage de lois et de dispositions sécuritaires semble avoir entraîné un débordement de l’antiterrorisme en direction de la sphère associative. Le confirmez-vous et quelles sont les grandes modalités des contraintes et entraves applicables aux associations en 2025 ?
 JT – Le monde associatif a été saisi par l’antiterrorisme. L’année 2015, avec l’état d’urgence consécutif à l’attentat du Bataclan, constitue un tournant. Des mesures de restriction des libertés publiques vont progressivement entrer dans le droit commun. L’aboutissement de ce processus, c’est la loi « séparatisme » de 2021, qui créé le Contrat d’engagement républicain, étend les motifs de dissolution administrative d’association et l’injonction à la neutralité qui leur est faite. Cette loi considère que pour prémunir la société du « séparatisme » ou du terrorisme il faut davantage contrôler l’ensemble du monde associatif. Ca nous semble discutable.
JT – Le monde associatif a été saisi par l’antiterrorisme. L’année 2015, avec l’état d’urgence consécutif à l’attentat du Bataclan, constitue un tournant. Des mesures de restriction des libertés publiques vont progressivement entrer dans le droit commun. L’aboutissement de ce processus, c’est la loi « séparatisme » de 2021, qui créé le Contrat d’engagement républicain, étend les motifs de dissolution administrative d’association et l’injonction à la neutralité qui leur est faite. Cette loi considère que pour prémunir la société du « séparatisme » ou du terrorisme il faut davantage contrôler l’ensemble du monde associatif. Ca nous semble discutable.
JPB – Dans ce contexte, deux secteurs associatifs d’opinion et de plaidoyer – la lutte contre les discriminations et la protection active de l’environnement – semblent tout particulièrement dans le viseur des autorités. Pouvez-vous exemplifier ce qui s’apparente à un acharnement et nous renseigner sur l’état présent des rapports de force, à l’aune de l’exigence de signature d’un « Contrat d’engagement républicain » ?
JT – Tous les secteurs sont touchés. Notre enquête statistique indique qu’une association sur dix déclare une restriction de ses libertés ces dernières années. Malgré tout, certains secteurs sont particulièrement visés et de fait pas que les associations qui pourraient être suspectées de complicité avec le terrorisme. Le CER a d’abord touché des associations féministes et écologistes et désormais on voit monter le secteur culturel. C’est d’abord la capacité critique des associations qui est ciblée.
JPB – Un rapport de la FIDH (Fédération Internationale pour les Droits Humains), concomitant à la sortie de votre ouvrage, dénonce un « décrochage démocratique » à l’encontre de la société civile et des associations en particulier. Quelles pistes proposez-vous pour revitaliser une démocratie associative si durement challengée sur la période étudiée ?
JT – Les associations jouent un rôle démocratique essentiel, de contre-pouvoirs et de représentation des intérêts des groupes marginalisés. Pour leur laisser jouer ce rôle il ne suffit pas d’avoir plus de moyens ou de remettre en cause les appels à projet, comme on l’entend souvent. Il faut aussi transformer les modalités d’attribution des financements, pour sortir de la dépendance au financeur en instaurant par exemple des commissions mixtes d’attribution (avec notamment des élus de l’opposition). Il faut aussi démocratiser les institutions, introduire des mécanismes de co-décision pour que les associations aient moins le sentiment de crier dans le vide.
JPB – Votre ouvrage est le fruit de cinq années de travaux d’enquête menés au sein de l’ « Observatoire des libertés associatives. » Pouvez-vous, pour terminer, nous dire quelques mots de la genèse, des acteurs et des acquis à ce jour de ce collectif bien nécessaire ?
JT – L’Observatoire a été créé en 2020 pour documenter ces atteintes croissantes aux libertés associatives. Il rassemble chercheurs et acteurs associatifs pour réaliser une veille sur ces enjeux, mener des enquêtes de fond, publiciser ces questions, et apporter un accompagnement aux associations qui auraient des difficultés. On a réussi je crois à constituer cette question en problème public, à accroître la sensibilité des élus et du monde associatif à des questions qui paraissaient il y a encore 8 ans marginales.
Propos recueillis par Jean-Philippe BRUN, coopérateur délégué Coop Atlantique, délégué territorial AESIO Mutuelle, administrateur CRESS Nouvelle-Aquitaine
En savoir plus :
- Entretien avec Julien Talpin, par Jean-Philippe Brun - 21 octobre 2025
- Chronique des Bords de Sèvre – Niort, les 30 & 31 janvier 2024 - 26 février 2024
- L’ESS en librairie : une note de lectures - 20 février 2023
References
| ↑1 | Julien Talpin est directeur de recherche au CNRS, directeur-adjoint du CERAPS (UMR 8026 – Université de Lille). Il est co-directeur du Groupement d’intérêt scientifique « Démocratie et Participation », et membre des comités de rédaction des revues Participations et Mouvements. Il dirige également le conseil scientifique de l’Observatoire des libertés associatives. Ses recherches portent l’engagement dans les quartiers populaires en France et aux États-Unis. Il a notamment publié L’épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires (PUF, 2021) ; Communautarisme ? (PUF, 2018, dir. avec M. Mohammed) ; L’islam et la cité. Engagements musulmans dans les quartiers populaires, Presses universitaires du Septentrion, 2017 (dir. avec J. O’Miel et F. Frégosi) ; Community Organizing. De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux États-Unis (Raisons d’agir, 2016) ; Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-Gare, Le Croquant, 2015 (avec P. Cossart). |
|---|---|
| ↑2 | Antonio Delfini est docteur en sociologie, chercheur associé au CLERSE, Université de Lille. Il est l’auteur au sein du Collectif Degeyter de Sociologie de Lille (La Découverte, 2017) et avec Rafaël Snoriguzzi de Contre Euralille. Une critique de l’utopie métropolitaine (Les Étaques, 2019). Ses travaux portent sur les formes spatiales de la lutte des classes et l’accumulation du capital dans la ville. |