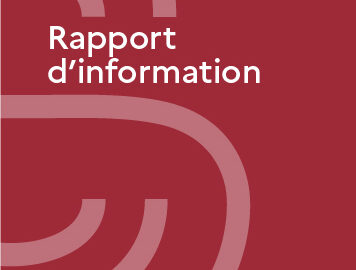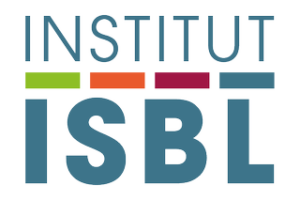Jusqu’alors, l’État était considéré comme l’initiateur et le protecteur du pacte social. Mais, selon une étude du CEVIPOF[1]Centre de recherches politiques de Sciences Po (2025), 76% des interrogés ne font plus confiance au gouvernement. 74% sont défiants vis-à-vis de l’Assemblée Nationale, et 72% vis-à-vis de la présidence de la République. Devons-nous en conclure que le pacte social puisse désormais concerner aussi l’échelle territoriale locale dans la proximité à la fois sociale et géographique qui la caractérise ? Dans ce contexte mêlant incertitudes quant à leur modèle socioéconomique et d’utilité sociale, les associations deviendraient-elles dès lors parmi les (premiers) partenaires des collectivités territoriales au service de la cohésion sociale et territoriale pour un « autre » pacte social ?
1 – De la fragilisation du pacte social à la nécessaire consolidation de la cohésion sociale.
Les expérimentations socio-politiques territorialisées ne cessent de se développer depuis une dizaine d’années en France. La toute dernière : « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée » – TZCLD, sous deux vagues d’expérimentation (2016-2019 ; 2020-2024), a abouti à faire coopérer des collectivités territoriales, le service public de l’emploi, les missions locales, et le plus souvent selon les territoires, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), au sein d’un comité local pour l’emploi soumis à des conditions de supplémentarité (non-concurrence) et exhaustivité (personnes privées durablement d’emploi). Pour résultat sont nées les entreprises à but d’emploi (EBE) sous statut d’associations commerçantes loi 1901. Dans le même temps, émergent des sociétés coopératives d’intérêt collectif -SCIC, telle que la SCIC Terres de Source en Bretagne sous l’impulsion des Eaux du Bassin Rennais (EBE), entre autres. Ces différentes contributions à un modèle de développement local soutenable dans ses dimensions économiques et sociales, s’ancrent dans un modèle de gouvernance coopératif où « Le territoire ne constitue pas une « dimension » du réel, mais le réel lui-même » (Davezies 2012, p.9). Il est un construit social autant que le pacte social l’est mais, sans cohésion sociale et territoriale, il n’est pas sûr que ce dernier demeure face aux injonctions individualistes et corporatistes. Pourtant, il existe un monde : le « monde associatif » qui, intrinsèquement et de manière a-politicienne, se place comme un acteur majeur du pacte social en raison de son modèle de gouvernance répondant au principe « une personne = une voix ». Mais, le contexte contemporain semble le mettre à mal.
« Ça ne tient plus ! », tel était le slogan porté par le monde associatif lors de la journée nationale de conscientisation du 11 octobre 2025. Passée quasi-inaperçue auprès de l’opinion publique et ce, malgré une importante communication via les réseaux sociaux, cette manifestation sectorielle visait à une conscientisation des conséquences de la baisse drastique du financement public issue du budget de l’Etat, sur le pacte social et la production de cohésion sociale et territoriale. Enclines à devenir des entreprises sociales à part entière, les associations risquent d’être soumises de plus en plus à une tension accrue entre leur nécessaire implication dans l’économique et leur mission d’utilité sociale, au service de la cohésion.
Dans une récente contribution pour le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), nous avons démontré que la cohésion ne repose pas nécessairement sur le « faire ensemble » qui relève déjà du droit à l’expérimentation ou du « faire (en) commun ». Mais, qu’elle commence à s’exprimer dès le « faire pour ». Si les appels d’offre ou les dialogues compétitifs amènent les collectivités territoriales à « faire avec » le monde associatif (délégation de service public, commandes publiques, prestations), ne serait-il pas temps de penser un nouveau partenariat qui reposerait sur le « faire sur » le territoire « pour » la cohésion sociale ?
Avec Davezies (2012, p.85), nous savons que « L’action concrète du service public étant liée aux territoires et à leur contenu social, sa capacité à démocratiser son action ne cesse de se réduire (…). L’action publique contre les inégalités tend à perdre en efficacité au niveau des territoires et à être cantonnée à des redistributions monétaires ». Il est donc nécessaire d’entrer dans une phase d’innovation socio-politique territorialisée où l’action publique s’appuie sur les partenaires du monde associatif pour répondre aux problèmes pernicieux auxquels l’Etat a du mal à apporter des éléments de réponse à la cohésion sociale, et, à la fragilisation du pacte social. Ce partenariat entre collectivités territoriales et monde associatif peut être envisagé dans le cadre d’une action publique coconçue qui permette de rompre avec l’idée reçue d’un secteur (exclusivement) subventionné sur fonds publics. Et ce, bien qu’un décret de 1938 impose aux associations recevant des fonds publics et des fonds du public une reddition comptable, comme toute organisation …
2 – Vers un modèle de coopération situé entre les associations et les collectivités territoriales au service de la cohésion sociale et du pacte social ?
La crise à laquelle est confronté le monde associatif ne se réduit malheureusement pas à la seule réduction des financements publics et privés (adhésions, cotisations, activités économiques). En effet, le mouvement « ça ne tient plus ! » a souligné également la montée de la précarité sociale et économique qui aboutit à une croissance des besoins sociaux et à la dégradation des conditions de réalisation des missions d’utilité sociale. Il faut comprendre que la solidarité sociale et territoriale est partout présente : secteur de la petite enfance, secteur du handicap, secteur de l’aide aux personnes, secteur sportif, secteur culturel, secteur social et médico-social, secteur de l’insertion par l’économique, secteur de la formation dans le cadre de la seconde chance, secteur de l’aide et de l’accompagnement aux malades.
Dans ce contexte, les associations font face à un nouveau management stratégique et à un autre modèle d’utilités sociales qui interrogent à la fois leur modèle de gouvernance, leurs outils de gestion, les opportunités de financement à saisir (fonds de dotation), leur environnement socio-économique et politique. Il en résulte la quête d’une nouvelle forme de pilotage intégrant stratégie organisationnelle et territoire, en développant une nouvelle alliance partenariale avec les collectivités territoriale pour « faire sur ».
Rappelons ici que les régions peuvent prendre des participations dans des sociétés de développement régionales, interrégionales, ou bien dans des sociétés de capital-risque solidaire. Les collectivités territoriales peuvent également avec les acteurs de la finance solidaire, participer à la promotion et au développement des sociétés coopératives d’intérêt collectif – SCIC, et accompagner les associations qui le souhaitent dans cette mutation organisationnelle et statutaire qui leur permet de conserver la ressources bénévole, tout en donnant la voix aux salarié.e.s et aux bénéficiaires de leur mission d’utilité sociale.
Les associations comme les SCIC, dans leur mission d’utilité sociale (art.2 de la Loi ESS du 31/07/2024) apportent, tout d’abord, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle, de leur état de santé ou de leurs besoins d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise. Elles contribuent, ensuite, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale. Et, elles concourent enfin, au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale. A ces titres, elles participent à leur échelle territoriale à la cohésion sociale et au pacte social.
Pour conclure, il est fondamental de considérer la convergence des initiatives citoyennes portées par l’économie sociale et solidaire et celles des collectivités territoriales comme un défi au service de l’action publique et de la cohésion sociale et territoriale. En effet, si changer le pansement ne suffit plus alors, il convient de penser le changement !
Pascal Glémain, Professeur des Universités, Université Rennes 2, UMR6590 CNRS-ESO Rennes
En savoir plus :
Replay : Les coopératives de service public
Enquête FAS septembre 2025 – Associations de solidarité en voie de disparition
References
| ↑1 | Centre de recherches politiques de Sciences Po |
|---|