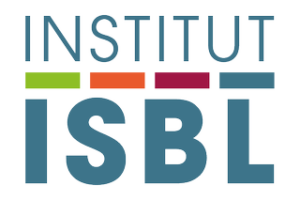En juillet dernier, l’Institut ISBL vous proposait une réflexion sur le périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)[1]Pierre Liret, « ESS, qui sommes-nous ?« , Institut ISBL, 26 juillet 2020. avec l’idée de clarifier les concepts, rappeler les fondamentaux juridiques qui distinguent les sociétés et les associations et comment les évolutions de la société contemporaine française ont finalement abouti à une loi définissant en 2014 des contours plus précis pour l’ESS. Cette loi a été conçue dans une logique inclusive afin d’encourager toutes les initiatives privées qui visent une finalité sociale ou sociétale. Mais dès lors qu’elle est venue s’inscrire dans un cadre juridique préexistant qui n’a pas fait évoluer la loi de 1901 ni le droit des sociétés (exception faite des art.1833 et 1835 du Code civil suite à la loi PACTE), elle n’a levé qu’une partie des ambiguïtés et des flous dans les frontières de l’ESS et surtout au sein même de l’ESS.
Une vision encore binaire
Ce qui, au fond, peut paraître le plus étonnant, c’est que malgré une hyper professionnalisation et une hyper spécialisation dans bien des domaines, le droit et la norme institutionnelle (de type INSEE par exemple)[2] INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/2736981 continuent de reposer sur une vision très binaire opposant le lucratif et le non lucratif, le marchand et le non marchand sans prendre en compte l’extrême diversité de la mosaïque humaine et par conséquent des motivations pour entreprendre. Conséquence : les associations qui veulent garder le droit à leurs subventions publiques, ne pas subir les impôts commerciaux ou visent une reconnaissance d’intérêt général sont condamnées à être tiraillées entre la nécessité d’aller chercher des ressources d’activités économiques face aux contraintes de l’environnement et l’impératif de ne pas perdre les droits qui leur sont octroyées en tant qu’organismes sans but lucratif [3]Colas AMBLARD, »Se différencier du secteur concurrentiel : comment et pourquoi ?« , éditorial Institut ISBL octobre 2018.
Notre cadre de référence oppose encore un secteur public supposé incarner l’intérêt général et un secteur privé supposé lucratif car ne représentant pas l’intérêt général. La multitude d’organisations qui se situent entre les deux pôles sont sommées de se conformer au choix binaire entre activité lucrative et non lucrative. Or entre l’intérêt général et l’intérêt individuel particulier, les marges sont vastes et aussi diversifiées que le sont les humains et leurs projets personnels et collectifs. C’est cette grande diversité qui conduit nombre d’observateurs et de décideurs à nier la réalité de l’ESS : comment peut-on dire qu’une banque mutualiste et un groupement d’hypermarchés relèvent de la même logique à défendre qu’une association d’aide à domicile ou une ONG ?
Banalisation de la bancassurance
De fait, les banques à statut mutualiste, les mutuelles d’assurance, les mutuelles santé se sont largement banalisées au fil du temps dans leurs relations à la clientèle. Cette banalisation résulte (souvent) moins de leur propre volonté que de la croissance et la professionnalisation progressive de leur secteur d’activité et de l’encadrement normatif qui s’est imposé à elles au fil du temps. Conséquence : les associations de consommateurs sont fondées aujourd’hui à dénoncer légitimement indistinctement toutes les banques, mutuelles et compagnies d’assurance dans la hausse de leurs tarifs et des frais financiers. Les banques mutualistes – qui redécouvrent leur identité coopérative depuis une dizaine d’années – mutuelles d’assurance et mutuelles santé ont beau à juste titre revendiquer leur gouvernance spécifique reposant sur un double regard technique et politique alors que leurs concurrents ont une gouvernance purement économique, pour le bénéficiaire ou assuré de base, la différence est mince et peu perceptible.
Dans le cas des banques, le sociétariat est de nouveau encouragé, mais essentiellement justifié par la motivation altruiste de pouvoir participer aux actions de solidarité de sa caisse locale et très peu par des services différenciants. Dans le cas des mutuelles, rares sont les années excédentaires ayant permis aux assurés d’avoir une perception palpable de leur statut de sociétaire via une ristourne. Au contraire même, face notamment à des obligations prudentielles toujours plus fortes, les mutuelles tentent d’expliquer qu’elles ont toujours plus besoin de fonds propres précisément pour assurer une bonne continuité de service. La réalité est plus complexe et se nouent aussi des enjeux autrement plus importants liés à l’emploi. A l’évidence, les marges de manœuvre budgétaires existent, par exemple (mais pas exclusivement) sur les frais de marketing, de publicité ou de gestion informatique. Mais fortes de milliers de salariés, les grandes organisations mutualistes et coopératives du secteur banques/assurances sont confrontées à d’énormes enjeux sociaux, et plus encore aujourd’hui avec la digitalisation qui pose aux banques la question du devenir des agences de proximité. Dès qu’une coopérative ou une mutuelle atteint une certaine taille, évidemment, elle n’appartient plus seulement à ses clients ou ses usagers, mais aussi à ses salariés qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme de simples rouages techniques au service des usagers. Or dans les métiers de services que sont la banque et l’assurance, les salaires et cotisations sociales constituent nécessairement une part prépondérante du budget de fonctionnement. Et par conséquent, pour les dirigeants salariés et politiques, la réflexion sur la baisse des tarifs adhérents interpelle nécessairement la question de la masse salariale et des emplois. Il n’en reste pas moins que les grandes banques et mutuelles ont certainement des marges de manœuvre pour donner à leurs bénéficiaires une réalité plus tangible du caractère mutualiste qu’elles revendiquent, par exemple dans le bon usage des « nouvelles technologies » pour développer un lien accessible, humain et différenciant avec l’adhérent et pas seulement viser à faire des économies de gestion.
Enjeu économique, social ou solidaire ?
Dans le cas du commerce sont souvent mises en avant les grandes enseignes de distribution Leclerc, Système U ou Intermarché dont les adhérents eux-mêmes n’ont jamais revendiqué quelconque appartenance à l’ESS. Et, de fait, les magasins membres de ces réseaux sont des entreprises tout ce qu’il y a de plus traditionnelles. Ce sont leurs groupements au niveau de la tête de réseau qui ont une forme coopérative ou associative. En conséquence, lorsqu’on quantifie le périmètre du mouvement coopératif ou de l’ESS, il ne faut bien sûr pas prendre en compte le chiffre d’affaires ou les emplois des membres dont les sociétés sont de droit commun, mais uniquement celui des têtes de réseau coopératives et associatives. Et à ce niveau des têtes de réseau, nombre d’observateurs ont pu témoigner que ces structures ont su faire perdurer leur culture coopérative fondée sur une gouvernance partagée, l’engagement et la participation des membres, la défense de l’intérêt commun, le lien humain, la solidarité entre les membres.
Ce qui est vrai, c’est que la coopération entre commerces, comme la coopération entre agriculteurs ou entre pêcheurs, vise d’abord et avant tout la pérennité économique de leurs membres. L’enjeu n’est pas ici une aide sociale, de lutte contre l’exclusion ou de plaidoyer pour transformer la société, mais la pérennité économique des membres. Mais cette finalité économique est en réalité une finalité sociale car par-delà la partie émergée de l’iceberg des riches propriétaires d’hypermarchés effectivement loin de l’ESS se pose un enjeu majeur pour notre société de savoir comment faire survivre les commerces de proximité sur tous les territoires et permettre à nos agriculteurs de vivre de leur activité. L’enjeu porte sur pas moins de 450 000 exploitations agricoles dont bon nombre ont du mal à se transmettre aux jeunes générations et plus de 300 000 commerces de détail avec environ 800 000 emplois pour les seuls petits commerces de détail (1). Au-delà de cet enjeu en termes d’emplois et de développement local, l’avenir du commerce et de l’agriculture nous concerne toutes et tous en tant que citoyens et consommateurs : n’a-t-on pas envie de garder de la vie dans nos centres ville ? N’a-t-on pas envie d’améliorer notre alimentation, notre environnement, notre cadre de vie ? C’est en ce sens que nos cadres juridiques de référence doivent évoluer. Ces commerces et ces exploitations agricoles ne relèvent ni du secteur public ni de l’intérêt privé lucratif au sens de l’entreprise patrimoniale, mais de la motivation ultra-dominante de chacun d’entre nous de juste pouvoir vivre du métier qu’on aime et d’être utile à son territoire ou sa communauté. En témoignent le foisonnement d’initiatives agricoles et commerciales sur tous les territoires sous les formes les plus diverses d’épiceries solidaires, participatives, coopératives de consommation, AMAP et autres tiers lieux qui, localement, sont bien perçus par les pouvoirs publics du territoire comme relevant de l’économie sociale et solidaire.
Grandir sans perdre son âme
Le réseau Biocoop illustre bien cette dynamique : les premiers magasins sont nés il y a bientôt 40 ans d’initiatives de consommateurs regroupés autour de la conviction de développer une alimentation bonne pour la santé et l’agriculture bio. Les premiers magasins étaient de petite taille, artisanaux, souvent associatifs et s’apparentaient à ce qu’on appelle aujourd’hui économie solidaire. Aujourd’hui, Biocoop est devenu une enseigne nationale qui rivalise avec toutes les grandes enseignes de distribution. Les uns critiquent aujourd’hui Biocoop pour s’être banalisé et tomber dans les travers du grand commerce. Dans la réalité, Biocoop a juste réussi son pari : sortir l’agriculture et l’alimentation bio de la marginalité pour en faire un réel enjeu pour toute la société. Incontestablement, le succès complique les choses : en grandissant, Biocoop attire des clients et des salariés qui ne sont plus aussi militants et dont l’engagement n’est plus aussi inconditionnel qu’à son démarrage. La croissance en taille et en nombre de structures (plus de 600 magasins aujourd’hui) complique aussi l’animation de réseau et la vie coopérative. Mais Biocoop reste toujours porté par le même projet. Ce sont les enjeux et l’ampleur des défis qui ont changé. Si l’on fait le parallèle avec les grandes enseignes de type Leclerc, Intermarché ou Système U, elles n’ont finalement pas non plus beaucoup changé dans leur projet : faire baisser encore et toujours les prix pour les consommateurs. Et pour y parvenir, ont institutionnalisé au fil du temps dans leurs pratiques une guerre de négociations avec les fournisseurs qui, malgré les prises de conscience de développer un commerce plus équitable et la récente loi Egalim de 2018, reste aussi impitoyable aujourd’hui. Et, de fait, les consommateurs ont suivi et suivent encore pour payer toujours moins cher. Les mêmes qui déclarent dans les sondages vouloir que les villes gardent leurs petits commerces font les beaux jours du e-commerce en général et d’Amazon en particulier. Il est vrai qu’on aimerait en savoir un peu plus sur la répartition des marges dans les plus gros hypermarchés. A l’évidence, le patrimoine de Michel-Edouard Leclerc et de ses barons les plus importants n’a plus rien à voir avec celui qui était celui du père fondateur et missionnaire Edouard Leclerc, ou celui aujourd’hui de Nicolas Chabanne, le fondateur de C Qui le patron, qui vient d’annoncer le reversement total de ses bénéfices à ses fournisseurs producteurs.
Le local, un bon échelon de mesure
Le commerce est donc une réalité à géométrie variable avec d’un côté des enseignes qui ont très bien réussi (et n’ont découvert leur responsabilité sociale qu’avec l’essor récent de ces préoccupations dans l’opinion), de l’autre une multitude de petits commerces menacés par ces grandes enseignes, mais surtout aujourd’hui par le e-commerce et enfin une kyrielle de commerces émergents, portés par une vision sociétale de développement local ou de modes de consommation alternative. Ainsi, le cadre local du territoire est le bon niveau pour mesurer avec pertinence de qui relève ou non de l’ESS, c’est-à-dire l’initiative privée au service du bien commun (intérêt collectif ou général). C’est ce que relève à juste titre Timothée Duverger dans son dernier ouvrage « Utopies locales, les solutions écologiques sociales et solidaires de demain » (éditions Les Petits Matins). Et c’est à ce niveau local qu’on se rend compte que l’ESS ne se résume pas aux gentilles associations « à but non lucratif » par opposition aux méchantes sociétés « à but lucratif ». Il faut se garder de considérer que d’un côté, il y aurait l’économie lucrative qui n’est là que pour enrichir des investisseurs et actionnaires, et de l’autre des associations par définition « solidaires » parce qu’elles sont portées par la culture du don et de l’engagement unilatéral.
Les associations elles-mêmes, en grandissant et face à un environnement normatif et concurrentiel toujours plus pressant, se retrouvent à leur tour confrontées exactement aux mêmes enjeux auxquels ont été plus tôt confrontées les banques, les mutuelles et les coopératives ayant grossi, comme l’a très bien décrit Véronique Dor dans un précédent article publié par l’institut ISBL[4]Véronique DOR, « La gouvernance dans les associations de l’action sociale et médico-sociale de l’ESS : une question d’équilibre« , Institut ISBL, 19 janvier 2021 : enjeux de professionnalisation croissante nécessitant de passer d’une prééminence du salariat sur le bénévolat, basculement des logiques de subventions vers des logiques contractuelles de prestations, contraintes gestionnaires et technocratiques plus fortes dans les appels à projet avec les financeurs et partenaires, institutionnalisation d’organisations toujours plus grandes, défis toujours plus immenses de trouver les bons modes de gouvernance pour faire vivre ces réseaux toujours plus grands et en hybridation croissante…
Prendre acte d’un monde qui change
Dans ce contexte, l’enjeu n’est pas d’opposer les structures institutionnalisées de l’ESS – nécessairement inscrites désormais dans le champ concurrentiel et tant mieux – aux petites structures supposées plus vertueuses et plus humaines et pouvant rester à la marge du champ concurrentiel sur des micro-publics, des micro-territoires ou reposant sur un bénévolat qui a ses limites, comme le montre l’exemple du logiciel libre marginalisé par les GAFA. Il faut se féliciter que la coopération et le mutualisme bancaire, assurantiel, commercial aient réussi au fil du temps à grandir comme les acteurs du secteur privé lucratif pour fournir un service de qualité au plus grand nombre. En Suisse, par exemple, le commerce est dominé par deux groupements coopératifs, Coop et Migros. A l’évidence, Coop et Migros aujourd’hui n’ont strictement plus rien à voir avec les modestes associations de consommateurs qui les ont fait naître. Mais les deux enseignes ont gardé dans leur ADN l’enjeu de leur responsabilité sociale et désormais sociétale. Ce n’est pas un hasard si les Suisses les placent régulièrement au sommet de leurs marques préférées.
Oui, la professionnalisation, la croissance, l’hybridation, l’institutionnalisation transforment nécessairement les formes associatives, mutualistes, coopératives. Mais elles ne conduisent pas forcément à perdre son âme. Mais précisément, pour ne pas perdre son âme et son projet, il faut prendre à bras le corps les réalités d’un monde qui change et savoir les devancer pour faire évoluer son organisation afin qu’elle puisse rendre un service toujours meilleur et à un public toujours plus important. C’est le défi qui est posé à bon nombre d’associations aujourd’hui en France et qui explique notamment pourquoi de plus en plus choisissent de se transformer en coopérative afin de moderniser leur gouvernance et se donner des marges de développement économique. Ainsi que le cinéaste Luchino Visconti le fait dire à son personnage le prince de Lampedusa dans le célèbre film « Le Guépard » : « Il faut que tout change pour que rien ne change ». C’est le défi posé aujourd’hui aux grandes structures de l’ESS, les unes pour gérer leur changement d’échelle et la complexification croissante de leur environnement législatif, normatif, administratif, social et sociétal et les autres pour réinventer le lien à leurs membres adhérents et bénéficiaires à la mesure des défis du 21e siècle.
Pierre LIRET
Expert coopératif, formateur, vulgarisateur, consultant
En savoir plus :
Pierre LIRET, « ESS, qui sommes-nous ?« , Institut ISBL, 26 juillet 2020.
Colas AMBLARD, »Se différencier du secteur concurrentiel : comment et pourquoi ?« , éditorial Institut ISBL octobre 2018
Véronique DOR, « La gouvernance dans les associations de l’action sociale et médico-sociale de l’ESS : une question d’équilibre« , Institut ISBL, 19 janvier 2021
- Sociétés à mission : enjeux pour l’ESS - 23 février 2026
- Duralex, symbole du deux poids deux mesures - 24 novembre 2025
- L’arlésienne du financement des Scic - 28 mai 2025
References
| ↑1 | Pierre Liret, « ESS, qui sommes-nous ?« , Institut ISBL, 26 juillet 2020. |
|---|---|
| ↑2 | INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/2736981 |
| ↑3 | Colas AMBLARD, »Se différencier du secteur concurrentiel : comment et pourquoi ?« , éditorial Institut ISBL octobre 2018 |
| ↑4 | Véronique DOR, « La gouvernance dans les associations de l’action sociale et médico-sociale de l’ESS : une question d’équilibre« , Institut ISBL, 19 janvier 2021 |