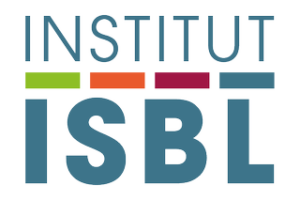A l’heure où les « super profits » défient les lois de la pesanteur, la question de leur taxation qui pourrait rapporter entre 18 et 44 milliards d’euros selon une récente proposition de loi met le Gouvernement actuel sous pression. En période de forte inflation et de crise énergétique, les résultats dégagés par nos grandes entreprises (Total Energies, pour ne citer qu’elle, a engrangé 20 milliards de profit en 2022) doivent-ils être partagés ? Entre qui ? Pourquoi ce « gâteau » ne profiterait-il pas aux corps intermédiaires (associations, fondations, fonds de dotation) voire aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) dont la vocation première consiste en la réalisation d’activités d’intérêt général et/ou d’utilité sociale ? La mise en œuvre d’un tel système de redistribution des richesses ne serait-il pas le moyen le plus efficace pour accélérer la transformation écologique, sociale et démocratique ?
Rien ne s’oppose plus à la logique ESS que la Bourse qui pèse lourd depuis longtemps et de plus en plus. Depuis début 2023, l’indice du CAC 40 a progressé de plus de 13% pour atteindre un seuil record de presque 7400 points. Le précédent record était de 6900 points dans les années 2000 avant qu’il ne retombe autour des 3000 après la crise financière de 2008/2009. Depuis lors, il n’a cessé de remonter. Ce chiffre peut paraître surprenant compte tenu du contexte : depuis quelque temps, l’économie est particulièrement secouée par la guerre en Ukraine, l’augmentation des prix de l’énergie, les tensions géopolitiques, la hausse des taux de marchés financiers, évidemment la pandémie Covid et les très grosses inquiétudes liées aux catastrophes climatiques, aux tensions sur les ressources en eau, la hausse de coût de production des matières premières, etc. Sur un spectre plus long, ça fait environ 20 ans que la démondialisation a commencé et nos économies occidentales n’en semblent pas impactées.
Bien sûr, la Bourse n’est pas toute l’économie. Elle ne représente qu’une sélection de 40 entreprises multinationales censées incarner le fer de lance de l’économie française. Elle est de fait (partiellement) déconnectée de l’économie réelle des territoires faite de PME, TPE, organisations ESS, institutions non marchandes, services publics… Mais elle crée de la valeur financière, c’est même sa fonction première et elle demeure encore le principal thermomètre de la santé de notre économie dans son ensemble. Sans surprise, Total Energies est l’une des valeurs qui a le plus gagné : on déplore la « real politik » de cette entreprise et les couleuvres que ses actionnaires doivent sciemment avaler pour gagner toujours plus d’argent dans un grand nombre de pays de la planète en étant peu regardants sur le politique, le social, l’environnement etc. Mais, en l’état actuel des rapports de force sur le plan géopolitique, ne vaut-il pas mieux pour la France d’avoir un colosse ultra-profitable dans le secteur des énergies plutôt que d’être dépendants d’acteurs étrangers ? Même chose pour Thalès, Dassault, Aérospatiale et toutes les valeurs liées de près ou de loin à l’armement, la sécurité, la défense, etc. Plutôt que de simplement déplorer la santé de plus en plus florissante des marchands d’armes dans notre microcosme national, ne faut-il pas aussi (malheureusement) constater qu’un nombre très important de gouvernements de la planète ont beaucoup moins d’états d’âme que le nôtre ? De ce point de vue, ne faut-il pas d’abord se féliciter d’avoir ces géants chez nous, que l’on peut donc à peu près maîtriser, étant entendu qu’ils nous offrent des arguments de poids dans nos négociations internationales ? Dans un registre plus soft, on dénonce à bon droit Bernard Arnault à propos de son appétit inextinguible pour l’accumulation de richesses personnelles et le pouvoir. Mais force est de reconnaître qu’en matière de « soft power » mondial, LVMH est un succès sur le plan économique et joue un rôle crucial dans la diffusion de la culture française (sans compter son apport dans notre balance commerciale qui en a bien besoin !). Et là encore, dans le combat géopolitique et économique international, mieux ne vaut-il pas mieux avoir chez soi Bernard Arnault qu’un Elon Musk à des années-lumière de notre vision française et européenne. Bref, on est en droit de critiquer le CAC40 et la Bourse, mais dans les faits, il faut d’abord constater qu’elle est là encore pour quelques temps, qu’elle pèse actuellement de tout son poids dans notre système de création de richesses et qu’elle est étonnamment résiliente malgré les multiples critiques qui émaillent la financiarisation de notre économie.
Une fois exposé ces constats et aussi accepté le fait qu’en y incorporant l’actionnariat salarié, il y a plus de 6 millions de particuliers français qui interviennent directement ou indirectement dans la structuration capitalistique de sociétés commerciales, via une Sicav, un FCP ou autre assurance-vie, la question suivante se pose : pourquoi nous, ESS, ne pourrions-nous pas à notre tour, être aussi un peu bénéficiaires d’une partie de cette manne financière pour compenser le manque de moyen que l’on constate régulièrement par ailleurs ? Tout bon responsable administratif et financier relèvera qu’on ne finance pas de l’exploitation avec du financier et encore moins du fonctionnement structurel avec de l’aléatoire. Pourtant, les start-up de la « tech » ne sont pas si regardantes : neuf fois sur dix – et les investisseurs l’acceptent en conscience – elles vivent non pas avec l’argent de leurs clients et d’un marché souvent hypothétique, mais sur le dos de leurs investisseurs qui attendent moins des dividendes de résultats d’exploitation que de la plus-value potentielle sur une valorisation future présumée.
Or, quel est le constat dans l’ESS ? Pour l’essentiel, nous sommes dans les métiers de l’humain, ceux sur lesquels la recherche constante de productivité a un impact mortifère sur le bien-être des personnels dont l’activité principale repose le plus souvent sur leur capacité à consacrer du temps aux autres et non pas à le compresser sans cesse. Ainsi, les organisations ESS sont sans doute celles (avec les services publics de santé et d’éducation) qui souffrent le plus de l’impact sur les comptes des cotisations sociales (le coût du travail) et de toutes les normes qui réglementent leurs activités sans oublier la gestion administrative des subventions et autres financements publics. Résultat : dans les organisations et leurs têtes de réseaux, le stress est constant pour joindre « les deux bouts », fidéliser leur personnel, recruter de nouveaux collaborateurs ou dirigeants bénévoles, maintenir la qualité du service, investir et moderniser leur système d’information, leur gestion administrative, etc. Au fond, dans l’ESS comme dans pas mal de services, ce qui pèse le plus dans les comptes, ce sont les salaires et les charges de structure, les loyers quand on n’est pas propriétaires et les systèmes d’information à améliorer sans cesse. Sans parler de la pression des normes croissantes, de la réglementation et des contraintes financières qui conduisent inévitablement à faire comme dans le capitalisme concurrentiel : des « synergies » et/ou des fusions à répétition.
Contrairement à ce que proclamait il y a peu Jean-Luc Mélenchon, nostalgique des rapports de force tels que connus au 19e siècle, le combat n’est plus de mieux répartir les richesses entre capital et travail. Il est de mieux répartir les richesses tout court et donc que tous, y compris les plus démunis, soient reconnus comme des parties prenantes dans la répartition des revenus du capital, d’une manière ou d’une autre mais le plus directement possible et sans attendre un hypothétique ruissellement qui, on le sait ne viendra pas ou si peu… A l’ère de l’Anthropocène, cette logique qui doit désormais prévaloir pour les individus est désormais transposable aux organisations : pourquoi celles de l’ESS ne réfléchiraient-elles pas aux bonnes modalités pour bénéficier aussi davantage des ressources du capitalisme dans le respect de leurs valeurs ? Ce ne serait qu’un juste retour des choses face à un système capitalisme trop heureux d’avoir des roues de secours pour réparer ses méfaits et ainsi accepter de faire ce que personne ne veut plus, pas même l’Etat ou de moins en moins.
Certes, et même si cette pratique est parfaitement admise par l’administration fiscale[1]BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 du 03 oct. 2018, par. 560 et s., un organisme sans but lucratif n’a pas pour seule alternative de créer une société filiale pour générer un accroissement de ses moyens de financement. Après tout, la financiarisation de l’économie n’est pas un impératif incontournable, comme l’illustre par exemple le Crédit Mutuel, banque universelle présente dans de nombreux pays et qui n’a jamais eu besoin de la Bourse pour bien, même très bien se porter et remplir ses missions d’utilité sociale voire d’intérêt général. Certains autres acteurs de l’ESS le font depuis toujours, savent parfaitement bien gérer leurs ressources, leur fonds associatif, leurs réserves de trésorerie, en clair leur capital financier. Cela se fait déjà à l’échelon de bon nombre de structures de l’ESS, mais personne n’en parle : on cantonne cela à l’intendance financière sans se rendre compte que ces contraintes de gestion ne sont pas forcément contraires aux valeurs que l’on défend. Lorsqu’une organisation ESS dégage assez de fonds propres, la logique financière consiste à se soulager d’un loyer payer à fonds perdus en achetant de l’immobilier. Lorsque se dégagent des ressources supplémentaires, il n’est pas rare que le superflu généré par les OSBL serve à constituer un capital pour renforcer leur « haut de bilan » mais qui, aussi, peut contribuer à favoriser la spéculation immobilière, parfois même dans des proportions discutables, alors que dans le même temps, on vilipende la Bourse et les marchés financiers. Mais spéculer sur l’immobilier ou sur la finance, quelle différence ?
Dès lors, deux cas de figure se présentent dans l’ESS :
- D’un côté, une minorité d’acteurs installés et qui ont, au fil du temps, réussi à constituer des fonds propres suffisamment conséquents pour prendre des risques, soit pour financer de la R&D « sociétale », soit pour s’orienter vers d’autres projets d’investissement. A ceux-là, on serait tentés de dire : de temps à autre, sortons le « nez du guidon », regardons ce que nous faisons et nos placements ou investissements sont-ils bien cohérents avec notre projet, notre raison d’être, notre identité, nos prises de position publiques ?
- De l’autre, une majorité d’acteurs qui, chaque jour, sont tellement focalisés sur les impératifs de leur mission première, qu’ils en oublient de s’ouvrir à des opportunités hors champ de leur spectre de réflexion ou tout simplement qu’ils refusent par pure idéologie, sans chercher à appréhender toutes les dimensions liées à la recherche d’efficacité en termes d’action. Pendant longtemps, la coopérative Enercoop a voulu rester « pure et dure », droite dans ses bottes idéologiques pour déployer sur le long terme une électricité d’origine vraiment renouvelable sur le territoire. Mais la crise énergétique est arrivée et bon nombre de clients sociétaires se sont aperçus que loin d’être indépendante, Enercoop était comme les autres fournisseurs totalement dépendante d’une politique énergétique européenne qu’ils se proposaient de combattre. Résultat : l’AG 2022 a voté le recours à l’ARENH et donc au nucléaire pour limiter l’impact sur les prix de leurs clients et, surtout pour gagner en autonomie, pour le lancement d’une structure Enercoop Développement lui permettant ainsi de déployer ses propres installations ENR dans un schéma de société capitaliste classique, mais filiale de la maison mère coopérative.
Cette illustration est un exemple parmi des centaines d’autres. Aussi, à toutes ces structures de l’ESS, petites ou grandes, qui peinent à boucler les fins de mois, à augmenter les salaires, à payer des primes, à recruter les talents, il faut leur dire et redire qu’une telle situation n’est pas une fatalité et que sans dévoyer leurs valeurs, mais au contraire dans le but de les conforter, il est essentiel de regarder au-delà du résultat d’exploitation voire d’hypothétiques subventions à percevoir et de continuer à explorer toutes les pistes de financement – et elles sont nombreuses – permettant de développer des ressources pérennes dans le domaine financier (ou exceptionnel) et de stabiliser des modèles socio-économiques le plus souvent hybrides. L’ESS a la chance de disposer d’opérateurs financiers, certes de niche, mais qui connaissent très bien l’ESS, à commencer par la NEF ou le Crédit Coopératif par exemple : ce sont des partenaires naturels pour explorer ces pistes. Et on ne peut qu’inviter les directions financières des organisations ESS, parmi les plus « riches » ou les plus « innovantes », à ne surtout pas cacher ce qu’elles font pour renforcer leurs fonds propres et financer leur fonctionnement mais au contraire à partager leurs savoir-faire dans ce domaine afin que d’autres puissent s’en inspirer afin d’améliorer leurs propres pratiques tout en continuant à respecter les valeurs qu’elles se proposent de porter. La finance, comme la Bourse, ne doivent pas être considérés comme des ennemis en soi. Mais comme une boîte à outils qu’il convient de (mieux) connaître pour savoir ce que l’on peut en garder… ou en jeter. Parce que remettre l’économie au service de l’Humain passe aussi, et très certainement, par-là !
- L’arlésienne du financement des Scic - 28 mai 2025
- L’ESS, un atout pour la souveraineté - 26 novembre 2024
- Il est possible de donner à chaque jeune en difficulté un accompagnement spécifique - 24 septembre 2024
- Services à la personne : là où le privé déraille ! - 29 juin 2025
- Associations en 2025 : l’urgence d’agir face à une crise silencieuse - 29 mai 2025
- Centres de santé : un engagement renforcé de l’État et des ARS en 2025 - 22 avril 2025
References
| ↑1 | BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 du 03 oct. 2018, par. 560 et s. |
|---|