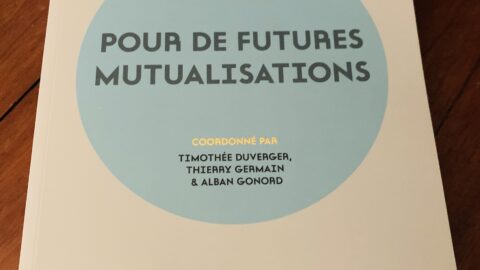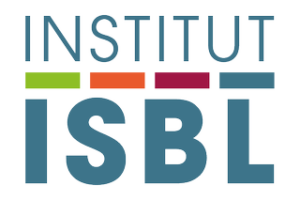Depuis la promulgation de la loi du 4 août 2008[1]L. n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5, art. 140 et 141 ; décr. n° 2009-158 du 11 févr. 2009, JO du 13, v. not. JA 2023, n° 681, p. 16 et s., dossier « Fonds de dotation – 15 ans : l’âge … Continue reading, le succès des fonds de dotation ne se dément pas. La diminution drastique des subventions publiques destinées aux associations a pour effet de renforcer cette tendance. Mais si le fonds de dotation bénéficie d’avantages fiscaux indéniables, certains aspects de son statut fiscal méritent des éclaircissements.
Pour les associations, la création d’un fonds de dotation peut s’avérer utile pour pallier la baisse des financements
publics et (ré)investir le champ de l’intérêt général[2]C. Amblard, Fonds de dotation – Un outil au service de l’intérêt général, Lefebvre Dalloz, coll. « Hors-série Juris associations », 2024. en bénéficiant du régime de mécénat[3]L. n° 2003-709 du 1er août 2003, JO du 2.. De ce point de vue, l’apparition de ce nouvel organisme sans but lucratif (OSBL) doit être vue sous un angle favorable. Cependant, pour optimiser la relation entre ces deux structures, il importe de manoeuvrer avec précision[4]V. JA 2023, n° 678, p. 32, étude C. Amblard.. Certaines zones grises du statut fiscal des fonds de dotation doivent être éclaircies.
FISCALITÉ ET MÉCÉNAT : LES FONDS DE DOTATION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Définition juridique
L’article 140 de la loi du 4 août 2008 définit le fonds de dotation comme « une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général ». De fait, ce type d’organisme s’impose de plus en plus comme une structure complémentaire aux associations à vocation d’intérêt général[5]CGI, art. 200 et 238 bis. avec pour objectif de mobiliser des ressources privées sous forme de libéralités (dons et/ou legs) pour financer leurs activités. Un tel dispositif s’avère être d’autant plus efficace que la ou les associations à l’origine de la création du fonds peuvent être destinataires du mécénat de flux récolté par l’intermédiaire de ce dernier[6]Rép. min. à M. Marland-Militello, JOAN Q du 17 mai 2011, n° 62981., tout en disposant de dirigeants communs : « […] rien n’interdit qu’il y ait identité de dirigeant avec l’organisme adossé dans le statut juridique et fiscal du fonds de dotation, cette situation étant même au contraire assez logique dès lors que celui-ci est simplement collecteur et a pour objet de redistribuer les revenus tirés de la capitalisation des dons qui lui sont consentis pour assister un organisme d’intérêt général. Dans ce cas, le fonds a naturellement pour objet de stimuler l’activité de l’organisme adossé (en l’espèce l’association) […] »[7]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50 du 18 déc. 2024, § 110..
Par ailleurs, la mise en oeuvre d’une telle organisation « bicéphale » (association / fonds de dotation) présente de nombreux autres avantages, tels que la possibilité de bénéficier de l’exonération des droits de mutation[8]CGI, art. 795, 14o ; v. égal. BOFiPImpôts, BOI-ENR-DMTG-10-20-20 du 14 juin 2022, § 310 à 370. à l’occasion des libéralités reçues, de s’affranchir de l’autorisation préalable pour accepter les libéralités (autres que les dons manuels)[9]C. civ., art. 910., de sanctuariser son patrimoine et de le faire fructifier sans être redevable de l’impôt sur les sociétés au taux réduit[10]CGI, art. 206, 5. – à la différence des associations qui demeurent toujours redevables de cet impôt sur leurs revenus du patrimoine quel que soit leur statut fiscal.
Régime juridique de la dotation
Lors de la création, une dotation initiale de 15 000 euros doit être versée en numéraire par le ou les fondateurs. Cette dotation doit être accordée sans contrepartie et de manière définitive. Par la suite, l’ensemble des libéralités reçues en cours de vie par le fonds (« mécénat de flux »), indépendamment de leur nature (numéraire, titres de société, biens mobiliers ou immobiliers, droits d’auteur, etc.), doit obligatoirement être comptabilisé dans la dotation[11]L. n° 2008-776, préc., art. 140, III..
En outre, sont admis – à titre exclusif – comme ressources potentiellement exploitables par un fonds de dotation[12]Ibid., art. 140, III, al. 4 et 5. : les revenus de ses dotations, les produits des activités autorisées par ses statuts, les produits des rétributions pour service rendu ainsi que les dons issus de la générosité du public[13]L. n° 91-772 du 7 août 1991, JO du 10, art. 3.. Cette distinction entre dotations et ressources est fondamentale. En effet, si le législateur[14]L. n° 2008-776, préc., art. 140, III, al. 6, 7 et 8. stipule que « le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social », à l’inverse, « il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie, ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci. Toutefois, par dérogation […], les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée ».
Dès lors, la problématique qu’il convient d’aborder à ce stade est la suivante : quel est le régime fiscal applicable aux fruits de la capitalisation (ou revenus de ses dotations) en matière d’impôt sur le revenu du patrimoine lorsque les statuts du fonds prévoient que les dotations sont partiellement consomptibles ?
RÉGIME FISCAL DES FONDS DE DOTATION : DES POINTS À PRÉCISER
Rappel
S’agissant du régime fiscal applicable aux activités du fonds de dotation, il est identique à celui dont relèvent les associations[15]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20 du 7 juin 2017., à l’exception de l’impact lié à l’accumulation d’excédents[16]Ibid., § 640. puisque cela relève de sa nature juridique – à l’instar des fondations. Sous cette réserve, le fonds doit avoir une gestion désintéressée, ne pas exercer d’activités lucratives au-delà du seuil de 80 011 euros (pour 2025) et de manière prépondérante, ni entretenir de liens privilégiés avec des entreprises du secteur concurrentiel qui en retirent un avantage. À défaut, il sera assujetti aux impôts commerciaux, c’est-à-dire principalement à l’impôt sur les sociétés[17]CGI, art. 206, 1 ; v. égal. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50, préc., § 90 et s. et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et sera exclu du régime de mécénat.
S’agissant du régime fiscal applicable aux revenus du patrimoine du fonds, l’article 206-5 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, précise que « les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital » sont placés hors champ d’application de l’impôt sur les sociétés au taux réduit prévu à ce même article[18]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40 du 25 mars 2013, § 570..
Problématique
Selon nous, cette disposition pose problème pour plusieurs raisons. D’une part, seuls les fonds de dotation les plus richement dotés ont la capacité de financer l’intérêt général à partir de leurs seules ressources – et en particulier des fruits de la capitalisation –, c’est-à- dire sans avoir besoin de consommer leur dotation. D’autre part, ces mêmes fonds disposent d’un avantage par rapport aux autres, à savoir que les revenus qu’ils tirent de leur dotation ne seront pas imposables à l’impôt sur les sociétés à taux réduit[19]CGI, art. 219.. Enfin, cette disposition ne précise pas le régime fiscal applicable aux revenus de la dotation pour un fonds ayant fait le choix d’une dotation partiellement consomptible.
Concernant ce dernier point, un avis de la direction des services juridiques du ministère de l’Économie datant du 21 décembre 2023[20]economie.gouv.fr/daj > « Fonds de dotation » > « Questions-réponses ». apporte une précision. À la question posée : le fonds de dotation peut-il consommer entièrement sa dotation ? Le ministère répond : « Oui. Si, par principe, la dotation n’est pas consomptible, le fonds de dotation peut consommer entièrement sa dotation, à condition que ses statuts en prévoient explicitement la possibilité. De plus, rien n’interdit que les statuts prévoient une consomptibilité partielle de la dotation. Cependant, que la consomptibilité de la dotation soit partielle ou totale, le fonds de dotation perd le bénéfice de l’exonération à l’impôt sur les sociétés. » La problématique décelée provient du fait qu’il existe une zone grise sur le bénéfice de cette exonération applicable à ces fonds dans la mesure où un tel avis ministériel formulé sous forme de questions-réponses n’a aucune valeur juridique contraignante, en dehors de son caractère informatif [21]Acte de droit souple ayant pour objet de modifier ou d’orienter le comportement des destinataires et susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir : CE, sect., 12 juin 2020, n° … Continue reading. Une telle situation est source d’insécurité, et en raison de la réponse apportée, espérons que les juridictions administratives sauront donner une interprétation extensive à l’article 140 ci-dessus visé, au contraire de la position actuellement affichée par le ministère de l’Économie. À défaut, le risque est de voir proliférer des biens inaliénables (« mainmorte »)[22]« Biens sans maître » dont la caractéristique principale est l’inaliénabilité. appartenant à des fonds de dotation dont le principal intérêt consistera, pour les plus fortunés, à bénéficier des avantages liés au régime de mécénat.
Quelle(s) solution(s) ?
Pour pallier l’insécurité fiscale actuelle, comment une association peut-elle s’organiser dès lors qu’elle souhaite créer un fonds de dotation pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés sur ses revenus du patrimoine (transféré), tout en s’aménageant la possibilité de percevoir le mécénat de flux collecté ?
La première possibilité nous semble consister en l’adoption de statuts prévoyant une dotation partiellement consomptible pour les libéralités recueillies sous forme de numéraire, la partie non consomptible étant réservée aux actifs susceptibles de générer des revenus patrimoniaux importants sous forme de loyers ou de dividendes. Pour les raisons précédemment exposées, cette solution n’apparaît toutefois pas totalement sécurisée. À tout le moins, il conviendrait, concernant cette option, de sectoriser comptablement les dotations afin d’identifier clairement ce qui relève de la partie consomptible et non consomptible.
La seconde solution, a priori plus sécurisante, passe par l’adoption d’une dotation totalement non consomptible, tout en considérant que l’ensemble des libéralités reçues par le fonds de dotation est issu de campagnes d’appel à la générosité du public. Dès lors qu’il constitue une ressource, ces libéralités n’ont pas à être comptablement enregistrées dans la dotation et peuvent donc librement être distribuées à l’association fondatrice du fonds.
Pour mémoire, l’appel à la générosité du public consiste en une sollicitation active du grand public dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. L’ordonnance du 23 juillet 2015[23]Ord. n° 2015-904 du 23 juill. 2015, JO du 24, art. 8. a modifié l’article 3 de la loi du 7 août 1991[24]L. n° 91-772, préc. et fait disparaître toute référence aux procédés utilisés pour faire des appels à la générosité du public. Ils peuvent ainsi être effectués par tout moyen, y compris par le recours à un site Internet, et les obligations légales attachées à l’appel à la générosité du public s’appliquent aux appels aux dons sur le site Internet d’un fonds de dotation.
Pour conclure, il est important de rappeler que le fonds doit être autorisé par la préfecture territorialement compétente en fonction de son siège social[25]Décr. n° 2009-158, préc., titre IV, art. 11 à 13.. En effet, depuis le décret du 16 mai 2022[26]Décr. n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17, art. 12., le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu au préalable cette autorisation administrative, constitue un dysfonctionnement susceptible de fonder une décision de suspension administrative de l’activité du fonds, voire sa dissolution. Le fonds devra ainsi déposer une déclaration d’autorisation préalable[27]L. n° 91-772, préc., art. 3 : « Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle. » pour l’année entière, nommer obligatoirement un commissaire aux comptes lorsque les ressources annuelles dépassent le seuil de 10 000 euros[28]L. n° 2008-776, préc., art. 140, VI, al. 1er. et établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) lorsqu’il reçoit, par le biais de l’appel à la générosité du public, un montant de ressources annuelles supérieur à 153 000 euros[29]Ibid., art. 140, VI, al. 3 ; L. n° 91-772, préc., art. 3 et 4 ; décr. n° 2019-504 du 22 mai 2019, JO du 24.
Colas AMBLARD, docteur en droit, avocat associé
En savoir plus :
Article publié aux éd. Juris associations du 15 sept. 2025, n°724, p. 37-39
Fonds de dotation : un outil au service de l’intérêt général, Juris-Associations Dalloz, Ed. Hors-Série, mars 2024
Juris associations n°678 1 mai 2023
JA 2022, n° 669, p. 35, C. Amblard.
- Face à la raréfaction des financements publics, plaidons pour la coopération et le regroupement - 26 janvier 2026
- Fonds de dotation : une opportunité stratégique pour les collectivités territoriales - 9 décembre 2025
- L’entreprise associative : vers une reconquête politique et sociale du concept d’entreprise - 26 novembre 2025
References
| ↑1 | L. n° 2008-776 du 4 août 2008, JO du 5, art. 140 et 141 ; décr. n° 2009-158 du 11 févr. 2009, JO du 13, v. not. JA 2023, n° 681, p. 16 et s., dossier « Fonds de dotation – 15 ans : l’âge de faire » ; JA 2018, n° 583, p. 15 et s., dossier « Fonds de dotation – 10 ans, ça se fête ! » ; v. égal. JA 2015, n° 521, p. 16 et s., dossier « Fonds de dotation – Le fonds et la forme ». |
|---|---|
| ↑2 | C. Amblard, Fonds de dotation – Un outil au service de l’intérêt général, Lefebvre Dalloz, coll. « Hors-série Juris associations », 2024. |
| ↑3 | L. n° 2003-709 du 1er août 2003, JO du 2. |
| ↑4 | V. JA 2023, n° 678, p. 32, étude C. Amblard. |
| ↑5 | CGI, art. 200 et 238 bis. |
| ↑6 | Rép. min. à M. Marland-Militello, JOAN Q du 17 mai 2011, n° 62981. |
| ↑7 | BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50 du 18 déc. 2024, § 110. |
| ↑8 | CGI, art. 795, 14o ; v. égal. BOFiPImpôts, BOI-ENR-DMTG-10-20-20 du 14 juin 2022, § 310 à 370. |
| ↑9 | C. civ., art. 910. |
| ↑10 | CGI, art. 206, 5. |
| ↑11 | L. n° 2008-776, préc., art. 140, III. |
| ↑12 | Ibid., art. 140, III, al. 4 et 5. |
| ↑13 | L. n° 91-772 du 7 août 1991, JO du 10, art. 3. |
| ↑14 | L. n° 2008-776, préc., art. 140, III, al. 6, 7 et 8. |
| ↑15 | BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20 du 7 juin 2017. |
| ↑16 | Ibid., § 640. |
| ↑17 | CGI, art. 206, 1 ; v. égal. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50, préc., § 90 et s. |
| ↑18 | BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40 du 25 mars 2013, § 570. |
| ↑19 | CGI, art. 219. |
| ↑20 | economie.gouv.fr/daj > « Fonds de dotation » > « Questions-réponses ». |
| ↑21 | Acte de droit souple ayant pour objet de modifier ou d’orienter le comportement des destinataires et susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir : CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142 ; v. égal. CE 3 févr. 2023, n° 451052. |
| ↑22 | « Biens sans maître » dont la caractéristique principale est l’inaliénabilité. |
| ↑23 | Ord. n° 2015-904 du 23 juill. 2015, JO du 24, art. 8. |
| ↑24 | L. n° 91-772, préc. |
| ↑25 | Décr. n° 2009-158, préc., titre IV, art. 11 à 13. |
| ↑26 | Décr. n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17, art. 12. |
| ↑27 | L. n° 91-772, préc., art. 3 : « Les organismes effectuant plusieurs appels au cours de la même année civile peuvent procéder à une déclaration annuelle. » |
| ↑28 | L. n° 2008-776, préc., art. 140, VI, al. 1er. |
| ↑29 | Ibid., art. 140, VI, al. 3 ; L. n° 91-772, préc., art. 3 et 4 ; décr. n° 2019-504 du 22 mai 2019, JO du 24 |