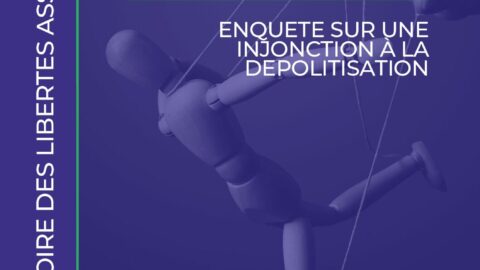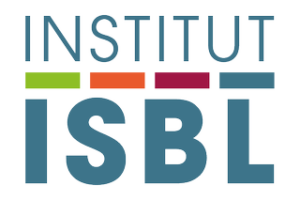L’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 30 octobre 2014, rendu à l’occasion d’un accident de motocyclisme survenu à l’entraînement, mérite l’attention non pas tant par la solution admise, qui est sans surprise, que par les motifs inattendus que les juges ont retenu pour appliquer la responsabilité du fait des choses.
1-Au cours de sa séance d’entraînement sur circuit une motocycliste décroche soudainement dans un virage, glisse puis chute. Alors qu’elle était au sol le pilote qui la suivait, la percute et lui roule sur le corps. Grièvement blessée, elle assigne en réparation l’auteur de la collision ainsi que l’exploitant du circuit. Elle obtient des premiers juges la condamnation du pilote à l’indemniser à hauteur de 50 % de ses blessures. En revanche, elle est déboutée de ses prétentions contre l’organisateur. La cour d’appel revoit le montant de l’indemnisation et le fait passer à 75%. Elle confirme, en revanche, le rejet de la demande formée contre l’organisateur.
2-Les accidents où sont impliqués des véhicules à moteur- à l’instar d’une motocyclette- sont normalement soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Mais, le sport de compétition fait l’objet d’un traitement à part caractérisé par le refoulement de la loi de 1985 entre compétiteurs[1] et jusqu’à l’arrêt du 4 novembre 2010 par l’éviction de l’article 1384 alinéa 1 du code civil pour cause d’acceptation des risques. Dans un considérant de principe, la Cour de cassation a énoncé que les dispositions de la loi de 1985 n’étaient pas applicables entre concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur. Puis elle a élargit le cercle de l’exclusion en y incluant les accidents survenus à l’entraînement[2]. Il en résultait que les concurrents étaient privés du bénéfice de la loi de 1985 et qu’ils n’avaient pas d’autre alternative que d’agir sur le fondement de la responsabilité pour faute puisque la voie de la responsabilité du fait des choses leur était également fermée.
3-Dans ce contexte, l’arrêt du 4 novembre 2010 fit l’effet d’une bombe en levant l’interdit de l’acceptation des risques[3]. En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décida que la victime d’un dommage causé par une chose pourrait désormais invoquer contre le gardien de celle-ci la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, « sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».
4-La doctrine n’a pas manqué de s’interroger sur les conséquences que l’arrêt du 4 novembre 2010 pourraient avoir sur le sort de la loi de 1985. Si la théorie de l’acceptation des risques était abandonnée il n’y avait plus aucune raison que les concurrents ne puissent pas tirer parti de ce texte. De surcroît, son abolition devait mettre fin à la distinction, très critiquée par la doctrine, entre spectateurs qui bénéficiaient des dispositions de la loi de 1985 et pilotes qui en étaient privés[4] .
5-La Haute juridiction ne s’est pas encore engagée dans cette voie. Il faut donc considérer que la loi Badinter ne s’applique pas aux accidents survenus en compétitions ou à l’entraînement. L’arrêt du 4 janvier 2006 est donc toujours en vigueur et il n’est pas surprenant que la cour de Nîmes en ait fait application. Toutefois la formule qu’elle emploie pour énoncer que la collision entre deux pilotes évoluant « sur un circuit fermé explicitement dédié à l’activité sportive » n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 pose question. En effet, on ne s’explique pas pourquoi ce qui n’est pas un accident de la circulation entre concurrents le deviendrait lorsque la victime est un spectateur. Une telle application distributive de la loi entre concurrents qui en sont privés et spectateurs qui en bénéficient est discutable. On ne peut pas fouler du pied une loi dont les dispositions sont d’ordre public et qui devrait s’appliquer à toutes les victimes sans distinction[5]. Par ailleurs, prise à la lettre, la formulation de la Cour de cassation, que reprend à son compte la cour de Nîmes, peut avoir des conséquences inattendues. Si on considère que les accidents entre pilotes survenus sur des circuits fermés exclusivement dédiés à l’activité sportive ne sont pas des accidents de la circulation, c’est moins l’activité sportive qui justifie l’exclusion de la loi de 1985 que le lieu de l’accident. En effet, un circuit fermé pourrait être utilisé à d’autres fins qu’une pratique sportive, tel que les essais par un fabricant d’un nouveau modèle de motocyclette. Dans une telle hypothèse, la loi de 1985 serait refoulée alors qu’il s’agirait d’un accident sans rapport avec le sport motocycliste. A l’inverse, la loi aurait vocation à s’appliquer entre deux pilotes « faisant la course » sur une voie ouverte à la circulation publique. On voit quelles difficultés peut susciter une telle formulation prise à la lettre.
6- Ayant écarté l’application de la loi de 1985, la cour d’appel considère que le régime juridique applicable au présent litige est celui de la responsabilité civile délictuelle et relève que la victime recherche la responsabilité du pilote de la motocyclette sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. On observera, à notre grande surprise, qu’elle écarte l’acceptation des risques, que l’auteur de la collision oppose à la victime, non pas en référence à la jurisprudence de 2010 qui l’a remisé aux oubliettes, mais parce que l’accident ne serait pas survenu à l’occasion d’une compétition sportive. Or l’arrêt du 4 novembre 2010 avait précisément été rendu à l’occasion d’un accident survenu à l’entrainement. Par ailleurs, dans son considérant de principe, la Cour de cassation n’avait fait aucune allusion à une distinction entre accident en compétition et accident à l’entrainement. La généralité des termes utilisés[6] laissait supposer qu’elle n’avait entendu mettre aucune restriction à l’abandon de la théorie pour les dommages causés par des choses. En définitive, la cour d’appel en revient au stade où l’acceptation des risques avait été confinée à la compétition et fait mine d’ignorer la jurisprudence de 2010.
7-L’action en responsabilité ayant été admise sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, la cour d’appel devait alors se pencher sur ses conditions d’application. Celles-ci ne faisaient aucune difficulté en l’espèce aussi bien s’agissant de la garde que du rôle actif de l’engin. L’auteur de la collision était assurément le gardien de la motocyclette dont il avait l’usage et la direction puisqu’il la pilotait au moment de l’accident. Par ailleurs, son engin avait bien été la cause du dommage puisqu’il avait percuté la victime alors qu’elle était au sol. Sans doute lui était-il toujours possible d’objecter que les blessures de la victime étaient consécutives à sa chute. Mais c’était aller contre les conclusions des experts pour qui les dégâts osseux dont elle était affectée n’étaient pas en relation avec sa chute.
8-Le pilote n’avait alors d’autre alternative que d’opposer à la victime une cause d’exonération de responsabilité. Si on considère que l’absence de faute de sa part n’était pas recevable puisque le gardien de la chose est tenu de plein droit des dommages qu’elle cause à autrui, il ne lui restait guère d’autre solution que d’établir la preuve d’une cause étrangère.
9-La faute de la victime est le moyen le plus habituellement soulevé par le gardien. En l’occurrence, les juges relèvent la maladresse de la victime dont la perte de maîtrise de son engin a provoqué sa chute. Elle révèle, selon eux, que la pilote n’a pas su adapter sa vitesse aux contraintes du circuit.
10-La faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle revêt les caractères de la force majeure. Or une chute à l’entrainement ou en compétition n’est pas imprévisible. Comme l’observent, à juste titre les juges, elle n’a rien d’inhabituel. D’où la décision finale d’un partage de responsabilité. En retenant celle du pilote à hauteur de 75% au lieu des 50% décidés par le tribunal de grande instance, la cour d’appel atténue quelque peu la rigueur de la décision des premiers juges envers la victime. Cependant, il eut été, à notre avis, plus juste de ne retenir aucune faute à son endroit.
11-En effet, si la maladresse constitue une faute dans la vie courante, ce n’est plus forcément vrai dans le contexte d’une pratique sportive. Notons qu’il ne s’agissait pas ici d’une activité ludique ou de loisir mais d’une séance de préparation à la compétition. Or l’entrainement n’est guère différent de la participation à une course. Si le pilote ne se met pas dans les conditions de la compétition où la prise de risque est nécessaire, il réduit singulièrement ses chances de victoire. Dans ces conditions une simple erreur technique ne devrait pas être constitutive d’une faute civile. C’est d’ailleurs la position de la jurisprudence qui admet que les compétiteurs n’ont pas à répondre de leurs maladresses.
12-Sans doute, faut-il tenir compte du contexte dans lequel s’est déroulé cet entraînement. En effet, la victime se savait suivie par d’autres pilotes. On peut admettre une imprudence de sa part si elle a pris des risques. Mais cela supposait d’établir que sa vitesse était excessive et qu’elle avait été la cause de sa chute ce qui ne semble pas avoir été établi en l’espèce. Aussi a-t-on l’impression que les juges retiennent sa faute par simple présomption ce qui est discutable.
13-La victime recherchait également la responsabilité contractuelle de la société gestionnaire du circuit pour n’avoir pas veillé à ce que l’auteur de l’accident respecte les distances de sécurité avec les motos qui le devançaient. Son action est rejetée au motif que n’étant pas déclarée à la date de l’accident elle était dépourvue de la personnalité morale et donc de la capacité juridique pour ester en justice. Si cette société avait été déclarée, la victime aurait du rapporter la preuve qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité. En effet, le régime de responsabilité applicable aux exploitants d’établissements sportifs est celui de la faute prouvée car ils ne sont tenus qu’à une obligation de sécurité de moyens. La question qu’il faut alors se poser est de savoir qu’elles étaient précisément les obligations de cette société. Se limitaient-t-elles à l’entretien des installations où avait-elle également en charge la surveillance des pilotes en veillant notamment à ce qu’ils respectent les distances de sécurité ? L’enquête a révélé qu’il existait une autre association qui organisait les séances d’entraînement à la date de l’accident. Mais, comme le relève l’arrêt, la victime n’a pas rapporté la preuve que la société exploitant le circuit se trouvait aux droits de l’association en charge des entrainements. Il y a donc fort à parier que l’obligation de surveillance incombait à cette dernière et que la société exploitant le circuit aurait été vraisemblablement mise hors de cause si elle avait été déclarée.
Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012