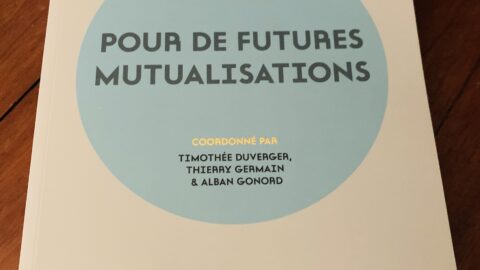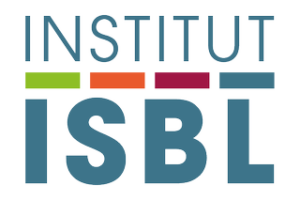Face à l’épuisement des réponses apportées par les logiques marchandes classiques et les limites croissantes des politiques publiques à répondre aux besoins sociaux, l’entreprise associative émerge comme une alternative puissante et crédible. Ce modèle socio-économique, issu de l’économie sociale et solidaire (ESS)[1]L. 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août, incarne une autre manière de faire entreprise : non plus tournée vers l’accumulation du capital, mais résolument centrée sur la transformation sociale et l’intérêt général.
Rompre avec l’instrumentalisation marchande : l’entreprise associative comme acte politique
Les associations qui produisent des biens ou services à haute valeur sociale ajoutée ne peuvent plus être réduites à des structures philanthropiques confinées dans une logique de charité[2]J. Delga, De la reconnaissance du caractère lucratif ou commercial des activités exercées par les associations à la reconnaissance de leur qualité de commerçant ou de leur finalité … Continue reading. Comme l’exprime avec lucidité M.-T. Chéroutre, « l’activité économique fait désormais partie intégrante de toute personne, individuelle ou collective. »[3]M.-T. Chéroutre, Exercice et développement de la vie associative dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, Rapport au nom du Conseil économique et social, 1993. Cette affirmation, loin d’être anodine, appelle à une redéfinition politique du rôle des associations : celui d’acteurs économiques à part entière, porteurs d’une vision du développement fondée sur la justice sociale, la solidarité et la démocratie.
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1988[4]Cass. com. 18 janv. 1988, Foyer Léo-Lagrange, JPC Ed. N., I, n°43-44, p.335 et s., le droit français rappelle que la qualité de commerçant est incompatible avec le statut associatif. Pourtant, la jurisprudence ne prohibe nullement la lucrativité en tant que telle, à condition que celle-ci demeure un moyen au service d’une finalité désintéressée[5]CA Besançon, 18 janv. 1969, Gaz. Pal. 1969, II, 304 : « attendu que l’expérience quotidienne montre qu’une association charitable ou autre a besoin pour équilibrer son budget, de faire face … Continue reading. Cette distinction est cruciale : elle ouvre la voie à un modèle hybride où l’activité économique sert un projet collectif et non l’enrichissement individuel.
Ce cadre juridique favorise ainsi l’émergence d’un nouvel acteur socio-économique : l’entreprise associative, qui réintègre l’activité marchande dans un projet social transformateur. Les bénéfices dégagés doivent impérativement être réinvestis dans l’objet statutaire (L. 1901, art. 1), dans une logique de redistribution équitable au service des bénéficiaires, des salarié·es, des partenaires et de l’ensemble de la communauté.
Une économie à finalité sociale : entre résistance et innovation
Dans un contexte de crise systémique – écologique, sociale, démocratique – [6]J. Gatel, Demain il sera trop tard ! Comment sortir de la crise systémique du capitalisme, Libre & Solidaire, 2022, 144 pages, il devient urgent de dépasser la vision dichotomique qui oppose marché et bien commun. Les associations – du moins pour celles qui se situent dans le champ de l’ESS – se positionnent désormais comme des entreprises politiques au sens fort : elles contestent le monopole économique de la finalité lucrative et réhabilitent l’utilité sociale comme moteur de production de valeurs.
Ce n’est pas là une simple réforme cosmétique du langage économique, mais bien une mutation profonde[7]J-L Cabrespines, Le modèle associatif peut-il s’inscrire dans un nouveau paradigme économique ? www.institut-isbl.fr, éditorial ISBL magazine mai 2021 . L’introduction progressive, sous l’influence du droit européen, de notions comme « activité économique » ou « entreprise » sans lien exclusif avec la recherche de profit annonce l’avènement d’une troisième voie économique : démocratique, redistributive, humaine.
Ainsi, comme le soulignait M.-T. Chéroutre, dès 1993, cette transformation « ne soulève aucune difficulté technique : elle dépend d’une simple volonté politique. »[8]Préc. note 3. Le véritable enjeu n’est donc pas juridique, mais idéologique et institutionnel : voulons-nous d’un modèle d’entreprise qui ne vise pas la rentabilité financière comme finalité ultime, mais la cohésion sociale, la justice environnementale ou l’émancipation collective ?
L’entreprise associative : une réponse structurelle au capitalisme financier
Dans un monde dominé par la financiarisation de l’économie – où la rentabilité à court terme, l’extraction de valeur et la concentration des richesses priment sur toute autre considération – l’entreprise associative s’affirme comme une réponse radicale aux excès du capitalisme actionnarial[9]C. Amblard, Et si l’entrée massive des associations dans la sphère économique signait la fin du capitalisme ? www.institut-ISBL.fr, éditorial ISBL magazine novembre 2023. Avec les coopératives et les mutuelles, elle se présente comme une rupture radicale, une subversion consciente du modèle dominant. Elle propose non seulement une alternative économique, mais une reconfiguration profonde de ce que signifie « faire entreprise », en remettant au centre les finalités sociales, la démocratie interne, la territorialité et la réappropriation collective des moyens d’agir. Elle refuse la logique de l’accumulation spéculative pour proposer une redistribution des richesses produites collectivement, au service de l’utilité sociale. Le modèle associatif défend une économie relocalisée, démarchandisée, gouvernée collectivement et recentrée sur les besoins fondamentaux des populations.
Repolitiser l’économie : du profit privé à l’utilité commune
Le capitalisme actionnarial a progressivement transformé l’entreprise en un vecteur de financiarisation, déconnecté de ses ancrages humains et territoriaux. La logique de maximisation de la valeur pour l’actionnaire s’est imposée comme norme hégémonique, reléguant l’intérêt général, la qualité des emplois, ou encore la soutenabilité écologique à des variables d’ajustement. Dans ce contexte, l’entreprise associative est une réponse politique : elle reterritorialise l’activité économique, déprivatise la valeur produite, et refuse le court-termisme spéculatif.
L’entreprise associative ne vise pas l’accumulation du capital, mais sa circulation et son affectation à l’utilité sociale[10]C. Amblard, Loi Economie sociale et solidaire : l’utilité sociale comme critère distinctif en matière d’entrepreneuriat, Recma, 2024/1 n°372-373. Là où le capitalisme financier extrait la valeur pour la redistribuer vers une minorité d’actionnaires, l’association la réinjecte dans le projet collectif. Elle n’externalise pas les coûts sociaux ou environnementaux : elle les assume comme des impératifs fondamentaux de son modèle économique.
La non-lucrativité, loin d’être un obstacle, est en réalité un levier de liberté stratégique. Elle libère l’organisation de la contrainte du retour sur investissement financier, permettant de réorienter les choix économiques selon des critères de justice, de solidarité et de durabilité. Ce cadre ouvre un espace de respiration démocratique, où les décisions se prennent sur la base de l’intérêt général, non des rendements escomptés.
Dans cette perspective, le refus du profit comme finalité exclusive devient un acte de résistance. L’entreprise associative n’est pas neutre : elle s’inscrit dans un projet de transformation systémique, qui interroge la manière dont la richesse est produite, partagée et gouvernée. Elle revendique une économie au service du commun, capable de répondre aux besoins collectifs que le marché laisse délibérément sans réponse car peu ou non rentables.
Un modèle d’anticipation post-capitaliste
Loin d’être une simple survivance du monde associatif traditionnel, l’entreprise associative représente une anticipation de ce que pourrait être une économie post-capitaliste. Elle s’inscrit dans une logique de biens communs, refuse la spéculation sur le vivant, l’éducation, le soin, l’alimentation ou la culture. Elle repose sur des mécanismes de régulation interne (gouvernance démocratique, contrôle de la lucrativité)[11]Du même auteur, La gouvernance de l’entreprise associative – Administration et fonctionnement – Juris Associations Dalloz, Collec. Hors-Série, 22019, 230 pages et de solidarité inter-structures, qui permettent de mutualiser les risques, de partager les ressources, de sortir de la logique concurrentielle permanente.
Elle crée également les conditions d’une rémunération éthique du travail, en refusant les écarts de salaires excessifs, en garantissant l’utilité du poste occupé, et en valorisant les compétences souvent invisibilisées dans l’économie traditionnelle. Elle privilégie les circuits courts de décision, l’implication des parties prenantes, la co-construction des projets avec les bénéficiaires – autant de pratiques qui remettent en question l’autoritarisme gestionnaire de l’entreprise capitaliste financiarisée.
En cela, l’entreprise associative s’oppose frontalement aux logiques d’accumulation spéculative, de prédation des ressources et de financiarisation du vivant. Elle constitue une réponse structurelle, systémique, transformatrice, là où l’économie capitaliste[12]Thierry Jeantet , Le capitalisme est-il obligatoire ? Institut ISBL, juillet 2025 ne propose que des ajustements techniques et des promesses sans lendemain.
De la périphérie à l’avant-garde[13]J. Saddier, Pour une économie de la réconciliation · Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain, Ed. Les Petits Matins, Coll. Mondes en transition, avr. 2022
Trop longtemps marginalisées, les entreprises associatives apparaissent aujourd’hui comme des laboratoires vivants de l’économie de demain. Elles expérimentent des réponses concrètes aux grands défis de notre temps : dérèglement climatique, fragmentation sociale, pauvreté de masse, délitement démocratique.
Elles démontrent qu’il est possible de concilier viabilité économique, justice sociale et soutenabilité écologique, à condition de repenser en profondeur la manière dont les structures sont financées, régulées, soutenues. Cela suppose une refonte des politiques publiques : reconnaître pleinement le rôle de ces structures, adapter les régimes fiscaux, sécuriser des financements de long terme, et surtout sortir de la fétichisation de l’entreprise classique comme unique modèle légitime d’activité économique.
Vers une nouvelle définition du modèle économique
Le concept de modèle économique, historiquement issu du capitalisme actionnarial, doit être dépassé. Il s’agit désormais de penser en termes de modèle socio-économique : un ensemble de mécanismes permettant de créer, délivrer et capter de la valeur non pour l’accumuler, mais pour la redistribuer. La chaîne de valeur est ici centrée sur l’intérêt général, intégrant les salarié·es, les bénéficiaires, les partenaires, les territoires.
Une adaptation constante : résilience et transformation
Les associations sont confrontées à une complexité croissante : baisse des subventions[14]Tchernonog – L. Prouteau, Le Paysage associatif français – Mesures et évolutions, 3e éd., Juris éditions – Dalloz, coll. « Hors-série », mai 2019 : entre 2005 et 2017, les … Continue reading, diversification des attentes sociales, besoin de gouvernance plus inclusive. Dans ce contexte, l’évolution de leur modèle socio-économique n’est pas une option mais une nécessité. L’hybridation des ressources, la capacité à innover, la solidité du projet collectif deviennent des conditions de viabilité.
Ce mouvement d’adaptation doit s’accompagner d’une rigueur dans la conception et la gestion du projet démocratique. Il suppose aussi de repenser les outils de pilotage, de valoriser les compétences internes, de renforcer les coopérations territoriales. Il s’agit de faire évoluer ces structures vers des organisations puissamment transformatrices, capables d’équilibrer performance économique et utilité sociale.
Conclusion : Reconquérir l’entreprise, reconstruire le commun, réapproprier l’économie par le social
Face aux ravages du capitalisme financier, l’entreprise associative offre une voie de transformation systémique, à la fois pragmatique et radicale une force d’opposition active, une économie de résistance et d’espérance.
Elle n’est donc pas qu’une « bonne action » ou une parenthèse dans le système : elle est une stratégie de réappropriation collective de l’économie. Elle incarne la possibilité concrète de réconcilier économie et démocratie, gestion et solidarité, efficacité et justice. Elle réhabilite l’entreprise comme outil au service du commun, et non comme instrument d’enrichissement privé.
En tant que figure centrale de l’ESS, elle représente bien plus qu’un modèle alternatif. Elle représente la possibilité concrète de construire un monde post-capitaliste, fondé sur la coopération plutôt que la compétition, sur le soin plutôt que sur l’exploitation, sur la participation démocratique plutôt que sur la logique actionnariale.
Mais pour déployer tout son potentiel transformateur, elle doit être reconnue, soutenue, et revendiquée comme telle – non pas comme une exception marginale, mais comme le cœur battant d’une autre manière de produire, d’échanger, de vivre ensemble[15].
Colas Amblard, président de l’Institut ISBL
En savoir plus :
L’Entreprise Socialement Intéressée : comment allier performance économique et utilité sociale
Thierry Jeantet , Le capitalisme est-il obligatoire ? Institut ISBL, juillet 2025
Thierry Jeantet, L’ESS doit accélérer face au capitalisme, éditorial ISBL magazine septembre 2025
- Face à la raréfaction des financements publics, plaidons pour la coopération et le regroupement - 26 janvier 2026
- Fonds de dotation : une opportunité stratégique pour les collectivités territoriales - 9 décembre 2025
- L’entreprise associative : vers une reconquête politique et sociale du concept d’entreprise - 26 novembre 2025
References
| ↑1 | L. 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août |
|---|---|
| ↑2 | J. Delga, De la reconnaissance du caractère lucratif ou commercial des activités exercées par les associations à la reconnaissance de leur qualité de commerçant ou de leur finalité intéressée, Quotidien juridique, 27 juin 1989, n°72, p. 3 et s. : Dans un tel scénario, les associations ne devraient plus être prisonnières « d’une conception strictement philanthropique excluant tout rapport d’affaires. » |
| ↑3 | M.-T. Chéroutre, Exercice et développement de la vie associative dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, Rapport au nom du Conseil économique et social, 1993 |
| ↑4 | Cass. com. 18 janv. 1988, Foyer Léo-Lagrange, JPC Ed. N., I, n°43-44, p.335 et s. |
| ↑5 | CA Besançon, 18 janv. 1969, Gaz. Pal. 1969, II, 304 : « attendu que l’expérience quotidienne montre qu’une association charitable ou autre a besoin pour équilibrer son budget, de faire face à ses dépenses par des gains réalisés. » ; A rapprocher de l’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 qui rappelle qu’ « à titre liminaire, est réaffirmé le principe selon lequel il est légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflets d’une gestion saine et prudente » (point 67). |
| ↑6 | J. Gatel, Demain il sera trop tard ! Comment sortir de la crise systémique du capitalisme, Libre & Solidaire, 2022, 144 pages |
| ↑7 | J-L Cabrespines, Le modèle associatif peut-il s’inscrire dans un nouveau paradigme économique ? www.institut-isbl.fr, éditorial ISBL magazine mai 2021 |
| ↑8 | Préc. note 3 |
| ↑9 | C. Amblard, Et si l’entrée massive des associations dans la sphère économique signait la fin du capitalisme ? www.institut-ISBL.fr, éditorial ISBL magazine novembre 2023 |
| ↑10 | C. Amblard, Loi Economie sociale et solidaire : l’utilité sociale comme critère distinctif en matière d’entrepreneuriat, Recma, 2024/1 n°372-373 |
| ↑11 | Du même auteur, La gouvernance de l’entreprise associative – Administration et fonctionnement – Juris Associations Dalloz, Collec. Hors-Série, 22019, 230 pages |
| ↑12 | Thierry Jeantet , Le capitalisme est-il obligatoire ? Institut ISBL, juillet 2025 |
| ↑13 | J. Saddier, Pour une économie de la réconciliation · Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain, Ed. Les Petits Matins, Coll. Mondes en transition, avr. 2022 |
| ↑14 | Tchernonog – L. Prouteau, Le Paysage associatif français – Mesures et évolutions, 3e éd., Juris éditions – Dalloz, coll. « Hors-série », mai 2019 : entre 2005 et 2017, les subventions sont passées en moyenne de 34 % à 20 % dans les budgets associatifs |