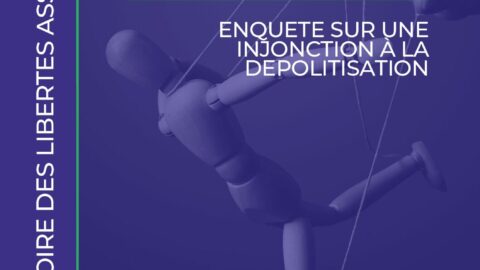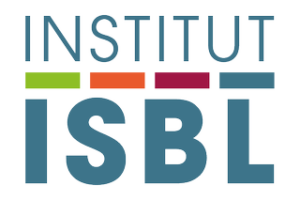Les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation en pleine conformité avec la règle « speciala generalibus derogant » mais aussi dans le droit fil d’une jurisprudence soucieuse de soumettre l’instance civile aux mêmes contraintes que le procès pénal. Elle ruine les espoirs d’indemnisation d’un professeur de tennis qui s’estimant victime d’atteinte à sa réputation par les parents d’une de ses élèves les avait assigné en réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
1-Pour ne pas avoir choisi la bonne voie de droit aux fins d’être indemnisé d’allégations qu’il considérait comme portant atteinte à sa réputation et à sa dignité un professeur de tennis a vu ses espoirs de réparation anéantis. Il a commis l’erreur d’agir sur le fondement de l’article 29 de la loi sur liberté de la presse du 29 juillet 1881. Erreur d’aiguillage irréparable en raison du bref délai de prescription de l’action en diffamation qui se prescrit après trois mois révolus (Article 65 de la loi de 1881) et qui était arrivé à son terme lorsque la Cour de cassation lui a fait comprendre qu’il n’avait pas fait le bon choix.
2-Voici les faits. Les parents d’une jeune mineure apprennent que leur fille entretient une relation sexuelle avec son professeur de tennis. Ils déposent alors plainte contre celui-ci pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Dans le même temps, ils font pression sur son employeur pour obtenir la démission de l’entraineur et alertent divers organes administratifs et sportifs dont la direction départementale de la jeunesse et des sports, la ligue, la fédération française de tennis ainsi que la presse quotidienne régionale. Le tribunal correctionnel relaxe l’intéressé des faits qui lui sont reprochés. En représailles, le professeur de tennis assigne les parents sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour avoir porté atteinte à sa réputation et à sa dignité.
3-La cour d’appel de Douai considère, à l’instar des premiers juges, qu’il n’appartenait pas aux parents de s’ériger en enquêteur et en justicier. Elle considère que la multiplication des courriers et démarches envers les membres du club, pris personnellement, mais aussi envers d’autres administrations et associations sportives, dans le but affiché d’écarter l’entraîneur de toute fonction en lien avec le tennis, caractérisaient un comportement dénigrant excessif et un acharnement de leur part alors qu’ils auraient dû s’en remettre aux instances judiciaires et disciplinaires dans l’attente de sanctions éventuelles.
4-Les parents forment un pourvoi contre cet arrêt et obtiennent gain de cause en cassation. La haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir indemnisé le professeur de tennis sur le fondement de l’article 1382 alors «que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi».
5- Cette décision n’est pas une première comme l’atteste un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2010[1] dans une espèce voisine où un couple avait adressé une lettre à un employeur décrivant l’un de ses salariés comme « une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de cette société« . En l’occurrence la personne qui s’estimait diffamée avait assigné le couple sur le fondement de l’article 1382 du code civil. L’arrêt de condamnation avait été censuré pour les mêmes motifs. Cette jurisprudence qui s’applique dans les cas où la diffamation ou l’injure ont été commises autrement que par voie de presse est aujourd’hui bien établie. Elle a mis fin aux tactiques des personnes s’estimant diffamées et qui consistait à donner la préférence à la voie civile pour échapper aux contraintes de la loi de 1881.
6-Le présent arrêt illustre parfaitement la règle « speciala generalibus derogant » en vertu de laquelle les règles spéciales, ici la loi de 1881, dérogent à celles générales. La loi de 1881 est d’abord une loi répressive. Son L’article 4 du code de procédure pénale ouvre aux victimes un droit d’option entre la voie civile et la voie pénale[2]. Le juge civil a ainsi le pouvoir de juger les injures, ainsi que les délits de diffamation commis envers les particuliers qui peuvent le saisir y compris lorsque l’action publique a été éteinte par le décès de l’auteur du fait incriminé ou par l’amnistie. Pendant des décennies, les juridictions civiles ont appliqué les règles de procédure propres aux instances civiles, sauf pour les règles de fond de la loi de 1881 comme la courte prescription édictée par l’article 65. En revanche, les articles 53 à 56 de cette loi, qui règlent les formes des citations devant les tribunaux répressifs n’étaient pas appliqués aux instances introduites devant le juge civil. « Il en résultait un déséquilibre fâcheux entre la voie pénale et la voie civile. Alors que le procès pénal était semé d’embûches, le procès civil apparaissait sans écueil [3] ». Les personnes mises en cause devaient pouvoir bénéficier des mêmes garanties qu’elles soient citées devant un tribunal correctionnel ou assignés devant un tribunal de grande instance[4].
7-La deuxième Chambre civile s’est engagée sur la voie de l’harmonisation en soumettant le référé de diffamation à l’article 55 de la loi de 1881 qui donne un délai de dix jours au juge civil pour statuer quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires[5]. L’arrêt du 22 juin 1994 a confirmé l’application de cet article devant la juridiction de jugement.[6] Celui du 19 février 1997[7] étend l’article 53 au procès civil. Dans son arrêt du 6 mai 1999 [8] la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir fait application de la prescription spéciale prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, bien que les parties eussent agi sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. De même, il a été jugé « qu’en édictant le principe général suivant lequel l’action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d’une infraction pénale se prescrit selon les règles du droit civil, l’article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale a laissé subsister les dispositions spéciales de l’article 65 de la loi sur la presse prévoyant une prescription de trois mois pour l’action devant la juridiction civile en réparation d’un dommage causé par une infraction prévue par cette loi »[9]. Comme l’a fait remarquer le conseiller Guerder, l’extension au procès civil des règles de procédure édictées par la loi de 1881 a rétabli le principe de l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable qu’impose l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8-Cette jurisprudence qui fait prévaloir la loi de 1881 sur le droit commun a été consacrée par deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000 aux termes desquels « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil« [10].
9-La présente décision s’inscrit donc dans le droit fil de cette jurisprudence. On notera qu’il s’agit d’un arrêt sans renvoi. En effet, la cour relève que la prescription de trois mois édictée par article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n’a pas été interrompue par des actes de poursuite[11]. En conséquence, elle se trouve acquise de sorte que la cause est définitivement entendue. Il ne reste plus rien à juger. La voie d’une action formée sur le fondement de l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse est définitivement fermée pour le professeur de tennis.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012