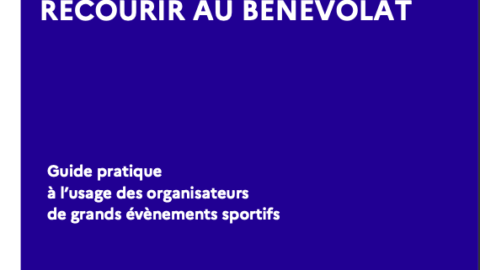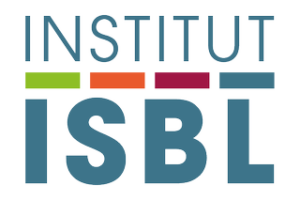La Cour de cassation est formelle : il n’y a pas de responsabilité de l’Etat en application des L. 911-4 du code de l’éducation sans preuve d’une faute personnelle d’un enseignant identifié. Question majeure et source de complication pour les parents et les jeunes victimes car en dépend la compétence juridictionnelle. La porosité de la frontière entre faute de surveillance dont l’appréciation relève du juge judiciaire et faute d’organisation du service public que seul le juge administratif est habilité à connaître, les expose au risque d’erreur dans le choix de la juridiction comme le révèle l’arrêt du 16 janvier 2014.
1-Un enfant d’une école maternelle fait une chute d’un toboggan à la fin de la récréation surveillée par une institutrice et un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Les parents, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, actionnent l’Etat lui reprochant un défaut de surveillance et d’assistance de l’enfant blessé.
2-La cour d’appel de Versailles réformant la décision des premiers juges retient la responsabilité de l’Etat après avoir imputé l’accident « à un défaut de surveillance lié à un défaut d’organisation du service ». L’arrêt est cassé pour avoir omis de constater une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé en application d’une jurisprudence constante de la 2ème chambre civile[1].
3-Il faut rappeler ici que le régime de responsabilité applicable aux accidents scolaires est l’aboutissement d’un processus législatif dont l’objectif était d’alléger la responsabilité civile des instituteurs particulièrement exposés du fait de leurs fonctions. C’est à la suite de la fameuse affaire Leblanc, du nom de l’instituteur qui sombra dans la démence après sa condamnation à la suite du décès accidentel d’un écolier[2], que se mit en marche « la machine réformatrice ». La loi du 20 juillet 1899 substitua la responsabilité de l’État à celle de l’instituteur, l’épargnant ainsi d’une mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Cependant, le régime de responsabilité alors fondé sur une présomption de faute fut maintenu. La loi du 5 avril 1937 (codifiée à l’article L.911-4 et suivants du code de l’éducation) supprima cette présomption et subordonna la responsabilité de l’Etat à l’existence d’une faute prouvée de surveillance de l’enseignant en application des règles du droit commun de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs, elle étendit le mécanisme de la substitution, jusque là limité aux dommages causés par les élèves, à ceux qu’ils subissent et désigna le juge judiciaire pour traiter ce contentieux[3]. Il en résulte une dichotomie entre la responsabilité de l’Etat pour faute de surveillance et sa mise en cause pour défaut d’organisation du service. Le contentieux est judiciaire dans un cas et administratif dans l’autre.
4-La responsabilité de l’Etat devant le juge judiciaire est alignée sur les règles du droit commun. Il résulte de la combinaison des alinéas 6 et 8 de l’article 1384 et de l’article L.911-4 et suivants du code de l’éducation qu’elle peut être recherchée toutes les fois que, « pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité » les enseignants se sont rendus coupables de négligence ou d’imprudence alors que les élèves se trouvaient sous leur surveillance. L’économie de ce régime de responsabilité est donc caractérisée par l’existence d’une faute de surveillance dont la charge de la preuve incombe à la victime. Il ne s’agit pas d’une « responsabilité présumée à partir de la seule constatation du dommage » comme se plait à le rappeler la cour d’appel de Versailles qui signale également que la preuve du lien de causalité entre le dommage et la faute de surveillance est à la charge des victimes.
5-En l’espèce, l’existence de ce lien de causalité supposait, nécessairement, que le dommage se soit produit à l’école car si l’enfant s’était blessé en dehors de l’enceinte scolaire, la cause de l’accident n’aurait pu être imputée à une faute des agents ayant en charge la surveillance des élèves. Le témoignage de l’un d’entre eux attestant qu’il avait vu l’enfant sur le toboggan avec une trace rouge sur le dos permettent d’affirmer, selon les juges d’appel, qu’il s’est blessée en utilisant le toboggan. Encore fallait-il que ce dommage provienne bien d’une faute de surveillance. L’examen des faits révèle qu’au moment où s’est produit l’accident, l’institutrice faisait rentrer les élèves en s’assurant qu’aucun enfant ne restait dans la partie nord de la cour, tandis que l’ATSEM s’occupait particulièrement de la zone sud de la cour. Il apparaît donc qu’à cet instant, la surveillance était assurée uniquement par l’ATSEM, l’institutrice ne pouvant tout à la fois surveiller et faire entrer les élèves d’autant que la configuration en U des lieux, ne lui permettait pas, depuis l’entrée de la classe, d’avoir une vue globale sur la cour. Cette analyse est confortée par des clichés photographiques postérieurs à l’accident montrant que trois personnes ont été affectées à la surveillance de la cour et que certaines possibilités offertes par le toboggan ont été supprimées. Les juges en arrivent à la conclusion que cette surveillance n’était pas assurée « de manière normale, suffisante et adaptée compte tenu de l’âge des enfants et de l’équipement, attractif mais dangereux que constitue un toboggan ».
6-La cour d’appel s’est également interrogée sur un défaut d’assistance de l’enfant qui n’aurait pas été prise en charge par les services de secours. Elle a écarté cette hypothèse après avoir constaté que son état de santé n’était pas visiblement « préoccupant » et que l’arrivée de la mère un quart d’heure plus tard après avoir été appelée au téléphone ne justifiait pas d’appel aux pompiers qui, s’il avait eu lieu, aurait différé de 5 ou 10 minutes tout au plus la prise en charge de l’enfant.
7-Dans un attendu surprenant, elle conclut son analyse en affirmant que l’accident est dû à « un défaut de surveillance lié à un défaut d’organisation du service ». La formule est maladroite et malheureuse car elle sert de motif à la cassation. En effet, à partir du moment où est évoquée l’existence d’une faute de surveillance, il fallait nécessairement en identifier le ou les auteurs, ce que n’avait pas fait la cour d’appel et pour cause puisque selon ses propres constatations il n’y a pas eu de manque d’attention de l’institutrice.
8-En supposant que l’ATSEM qui assurait la surveillance de la zone où se trouvait le toboggan n’ait pas correctement accompli sa mission, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être retenue qu’à la condition qu’elle soit assimilée à un « membre de l’enseignement public ». Dans une espèce où un enfant qui participait à une classe de neige, sous la surveillance non de l’instituteur mais d’un moniteur municipal, le Tribunal des conflits a admis que la chute dont il avait été victime ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité de l’Etat soit recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 avril 1937[4]. Cependant, le juge des conflits a estimé que si la qualité de membre de l’enseignement public devait être étendue à toutes les personnes qui participent à l’encadrement des enfants, cette extension se limitait aux activités réalisées dans un but d’enseignement. Aussi, a-t-il refusé cette qualité aux agents de la commune, chargés de la surveillance des enfants pendant la pause méridienne, dès lors que ce temps « se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative »[5]. Dès lors, si on applique sa jurisprudence à la présente espèce, il ne servira à rien aux parents d’établir l’existence d’un défaut d’attention de l’ATSEM pour obtenir la condamnation de l’Etat car la surveillance de la récréation, comme celle de la cantine n’ont aucune
finalité éducative.
9-Si on admet que la chute était imputable à un défaut d’organisation de la surveillance, comme l’évoque la cour d’appel, il aurait fallu s’en tenir à cette expression et renvoyer les parents et la victime à mieux se pourvoir. En effet, le juge administratif est le juge naturel de l’Etat. C’est par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires que le législateur a confié au juge judiciaire le contentieux civil des accidents scolaires imputables aux fautes de surveillance des personnels enseignant. En revanche, pour tout accident qui découle de la mauvaise organisation du service public, le juge administratif conserve sa compétence. A lui d’examiner la responsabilité pour faute de l’Etat[6].
10-Cette dévolution de compétence complique singulièrement la tâche du justiciable. La frontière entre la faute de surveillance d’un enseignant déterminé et un défaut d’organisation du service de surveillance est laissée à l’appréciation du juge. Mais il n’est pas possible de l’occulter comme semble l’avoir fait la cour d’appel en affirmant que l’accident était dû à « un défaut de surveillance lié à un défaut d’organisation du service ». Le pourvoi relève à juste titre que « si la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire s’étend à l’ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d’un membre de l’enseignement public (…) les règles normales de compétence retrouvent leur empire dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent » ce qui paraît bien être le cas dans la présente espèce.
11-A l’examen des circonstances de l’accident et de l’analyse qu’en a fait la cour d’appel, il est peu probable que les parents de la victime puissent établir une faute de surveillance de l’institutrice devant la juridiction de renvoi. Leurs chances d’aboutir en actionnant l’Etat devant le juge administratif sont, en revanche, plus sérieuses si on admet la probabilité d’un fonctionnement défectueux du service de surveillance de l’école par manque d’effectif.
12-Surtout, les parents peuvent se prévaloir du bénéfice de la présomption de faute propre aux dommages causés par un ouvrage public. En effet, l’enfant s’est blessé en chutant du toboggan. S’agissant d’un ouvrage public, puisqu’il est ancré au sol, le toboggan est présumé affecté d’un défaut d’entretien. Il suffit donc aux parents d’établir qu’il est à l’origine de la chute ce qu’ils feront en excipant la trace rouge repérée sur le dos de l’enfant. A charge pour la commune propriétaire de l’installation de combattre cette présomption en sachant que ses chances d’y parvenir sont faibles si on admet que ce type d’équipement par nature dangereux pour de jeunes enfants ne peut être utilisé sans la présence d’un enseignant ce qui n’était le cas au moment de l’accident puisqu’aucun des deux agents n’a vu l’enfant tomber.
13-En supposant que les parents veuillent encore tenter leur chance devant la cour de renvoi seront-ils prêt à poursuivre leur action en réparation qui va prendre des allures de marathon judiciaire si après un nouvel échec ils se trouvent contraint d’actionner l’Etat devant le juge administratif ? L’image qu’ils se font de la justice risque d’être singulièrement écornée. Il est donc temps de mettre fin à cette dualité judiciaire source d’erreur et d’inutiles complications pour les victimes. Le contentieux des accidents scolaires devrait être exclusivement un contentieux administratif dès lors que l’Etat est l’organisateur du service public de l’enseignement.
14-Sans doute une campagne d’explication préalable s’avère nécessaire pour éviter les cris d’orfraie de la communauté éducative qui, selon le mot d’un auteur[7], perçoit comme une composante de ses droits l’absence de poursuites et de comparution devant les juridictions civiles. Il suffira de lui rappeler, d’une part, que le juge administratif est juge de l’Administration et non de ses agents et d’autre part que la responsabilité pour faute de l’Etat apparaît comme une responsabilité du fait d’autrui de sorte que les agents publics auteurs d’une faute de service (comme le sont les fautes de surveillance) sont civilement irresponsables[8].
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
Documents joints:
CIV_2_16_JANV_2014_ACCIDENT_SCOLAIRE
Notes:
[1] Civ. 2ème 17 juill. 1991, Bull. civ. II, n° 232 ; Civ. 2ème 2 mars 1994 n° 92-16768 et 16 mars 1994 n° 92-19649 Bull. civ. II n° 92 p. 53. Civ. 2ème 29 mars 2001, Bull. civ. II n° 69.
[3] Elle précise, également, que l’action en réparation dont la prescription est ramenée à trois ans sera dirigée contre le préfet du département.
[4]TC15 févr. 1999,n° 03021. La Cour de cassation a statué dans le même sens dans une espèce où un collégien s’était blessé lors d’un exercice de gymnastique alors qu’il faisait partie d’un groupe placé sous la surveillance d’un éducateur sportif municipal. Civ. 2e, 13 déc. 2001, RTD Civ. 2002 p. 312 note P. Jourdain.
[8] En revanche ils répondent de leur faute personnelle si bien que, dans le cas de faute personnelle non détachable du service (par exemple des violences commises sur un enfant récalcitrant), l’Administration après avoir indemnisé la victime pourra exercer une action récursoire contre son agent pour lui faire supporter les conséquences pécuniaires de sa faute. Par ailleurs, les agents publics ne bénéficient d’aucune immunité pénale et répondent comme n’importe quel citoyen des infractions dont ils sont les auteurs.