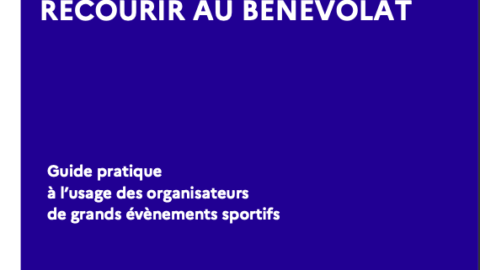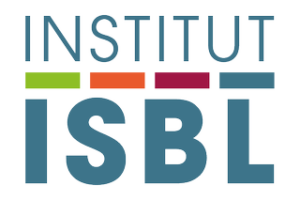L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 13 janvier 2010 a de quoi rassurer les centres écoles de parachutisme. Il vient rappeler qu’un exploitant d’établissement sportif tenu à une obligation de moyens et non de résultat n’est pas responsable du seul fait de la survenance du dommage. A charge pour la victime d’établir la preuve qu’il a manqué à son obligation de sécurité. S’agissant d’un sport dangereux la Cour de cassation considère, toutefois, qu’elle doit s’apprécier avec plus de sévérité. Mais cette rigueur dans l’appréciation de l’obligation de sécurité doit tenir compte du niveau atteint par l’élève et des risques qu’il a accepté de prendre, comme l’atteste l’arrêt des magistrats angevins.
1- Une élève parachutiste s’évanoui au départ de son saut. L’ouverture de sa voile de secours s’effectue automatiquement grâce à un dispositif de sécurité, mais elle se blesse en se posant dans une haie hors zone normale d’atterrissage. La CPAM subrogée dans ses droits actionne alors le club organisateur du saut et obtient sa condamnation par les premiers juges. La Cour d’appel d’Angers réforme cette décision, estimant que la Caisse Primaire n’a pas rapporté la preuve d’une violation par l’exploitant de son obligation de sécurité de moyens.
2- C’est l’occasion de rappeler, comme le fait l’arrêt, que l’intensité de cette obligation est déterminée par le comportement actif de l’élève particulièrement manifeste dans le cas du saut sans assistance. Sa réussite dépend en grande partie des gestes de l’intéressé de sorte qu’il y a une certaine logique à subordonner la responsabilité de l’organisateur à une faute de sa part et à faire supporter à la victime la charge de la preuve de ce comportement fautif. En l’occurrence, celle-ci avait cru relever trois défaillances du club : un atterrissage en dehors de la zone prévue et donc non sécurisée ; un matériel de sécurité défectueux et l’absence d’encadrement des élèves tout au long de chaque phase du saut en contravention avec les dispositions de l’arrêté du 9 décembre 1998.
3- Aucun de ces moyens n’est retenu comme preuve de l’existence d’une faute. Les deux premiers n’appellent pas de remarque particulière. Il n’y avait effectivement pas d’erreur à avoir laissé atterrir l’élève dans une zone non sécurisée. En effet, le point d’atterrissage d’un parachutiste largué à une altitude de 4 000 mètres ne peut se situer à l’aplomb du lieu de son largage étant donné la vitesse acquise lors de la sortie de l’aéronef largueur et la dérive due au déplacement de la masse d’air dans laquelle il évolue. De même, la CPAM ne prouve pas plus la défectuosité du matériel de sécurité qui a normalement fonctionné et a évité à la victime de s’écraser au sol. Restaient les conditions de suivi du saut qui, pour la victime, n’étaient pas celles qu’elle était en droit d’attendre. En particulier, elle faisait valoir qu’elle n’avait pas eu de moyen d’entrer en communication par radio avec son moniteur au cours de la descente. N’est-ce pas là une négligence de la part du club ?
4- A supposer que ce fut le cas, il faut avoir alors les plus grands doutes sur l’existence d’un lien de causalité entre cette négligence et l’atterrissage de l’élève hors de la zone sécurisée. En effet, même si le moniteur au sol était en communication radio avec celle-ci, les conseils prodigués n’auraient guère pu lui servir puisqu’elle s’était évanouie et se trouvait donc dans l’incapacité de se diriger.
5- Cela étant, contrairement à l’analyse faite par les premiers juges, l’arrêt ne retient aucune faute à l’encontre du club. Il faut y voir l’effet de la prise en compte du niveau de la victime et de l’acceptation des risques.
La prise en compte du niveau de la victime
6- Bien que la communication par radio ne soit pas obligatoire, dans l’état actuel de la réglementation, comme l’observe la Cour d’appel, il arrive que les tribunaux aient un niveau d’exigence supérieur à celui des réglementations fédérales et étatiques quand la sécurité des pratiquants est en jeu. C’est le cas pour les sports dangereux d’autant plus que la Cour de cassation a convié les tribunaux à faire preuve de rigueur dans l’appréciation de la faute [1]. Ainsi, dans son arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence oppose à l’exploitant qui insistait sur le caractère non obligatoire d’une liaison radio que l’utilisation d’un ULM paramoteur aurait permis au moniteur de lui prodiguer les conseils nécessaires pour redresser l’appareil. Il serait donc tentant de relever une contradiction entre les deux juridictions. En réalité, l’examen attentif des circonstances de chacune des deux espèces montre qu’il n’y en a pas. La prise en compte du niveau de l’élève permet de le vérifier. Dans la première affaire, la cour relève que l’élève n’avait effectué que 5 heures de vol en ULM. En revanche, dans la présente espèce la victime a connu une progression normale dans son initiation au parachutisme, a réussi ses 29 sauts précédents, et a atteint un niveau technique lui permettant d’effectuer son 30ème saut à l’issue duquel elle a été blessée. Les deux situations ne sont donc pas comparables. D’un côté, il est question d’un débutant en phase d’apprentissage, incapable encore de maîtriser la conduite de son engin, ce qui peut justifier une surveillance rapprochée s’exerçant par radio. De l’autre, il s’agit déjà d’une élève confirmée. Elle est titulaire du brevet A en progression traditionnelle délivré par la Fédération française de parachutisme qui confère l’aptitude aux sauts individuels sans assistance d’un moniteur après un minimum de 15 sauts en chute. En outre, le jour de l’accident, elle effectuait son 30ème saut en vue de la validation du niveau B.
L’acceptation des risques
7- Il est intéressant de relever la référence faite par les juges à l’acceptation des risques. Elle n’est pas seulement utilisée pour justifier l’application d’une obligation de moyens à la charge du club. La mobilité qu’implique le saut en parachute y suffit. Elle l’est surtout pour l’appréciation de la responsabilité de l’organisateur notamment sur la question de l’accompagnement qui était au cœur du litige. Il existe, en effet, deux méthodes françaises d’enseignement du parachutisme : la progression traditionnelle et la progression accompagnée en chute avec un moniteur aux côtés de l’élève. La victime a fait le choix de la progression en individuel et donc accepté, en pleine connaissance de cause, le risque d’un saut sans assistance rapprochée et notamment celui toujours possible d’une perte de connaissance. Sa référence à l’arrêté de 1998 dont les dispositions sont aujourd’hui reprises aux articles A322-147 et suivants du code du sport est donc erronée, puisque l’article A 322-151 applicable à sa situation réglemente la progression non accompagnée en chute [2].
8- Il ne peut donc être reproché au club de ne pas avoir prévu d’accompagnement y compris pour la diriger sur une zone sécurisée. L’essentiel est que, dans une telle circonstance, elle ait été équipée d’un parachute de secours qui a normalement fonctionné en lui évitant de s’écraser au sol.
9- Comme l’indiquent les juges, s’il avait fallu garantir à la victime d’atterrir sur la zone sécurisée, il n’y avait pas d’autre alternative que le saut en tandem. Or elle avait fait le choix du saut individuel et en avait accepté le risque.
10- Enfin, ce saut n’était pas dépourvu de tout contrôle puisqu’il est établi « que deux moniteurs étaient en charge du groupe de parachutistes dont la victime faisait partie… l’un au sol et l’autre dans l’avion ». L’encadrement paraissait donc bien adapté à la nature de l’activité et au niveau des pratiquants comme l’exige l’article A322-160 du code du sport.
11- Au final, cet arrêt met bien en évidence l’importance de l’aléa et de l’acceptation des risques qui influent singulièrement sur la définition de la faute. L’apprentissage du parachutisme en traditionnel sans assistance rapprochée présente certainement plus de danger que le saut en tandem. Mais c’est la liberté de choix de l’élève qui est en jeu. Le plaisir attendu n’est certainement pas le même selon la méthode de saut choisie. L’important est que le néophyte ait été suffisamment informé par le club sur la part de risque de chacune avant de faire son choix. Au stade de progression où se trouvait la victime il y a de bonnes raisons de penser qu’elle était parfaitement informée de l’étendue des risques qu’elle prenait et dont la Cour d’appel se plait à rappeler qu’elle les avait acceptés.
Jean Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur Un ouvrage de M Jean-Pierre Vial – septembre 2010 : voir en ligne
Notes:
[1] Civ 1, 5 nov. 1996 ; Bull. civ. I, n° 380, D. 1998, somm. p. 37, obs. A. Lacabarats.
[2] « 1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d’abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l’action d’ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d’accéder à la chute libre ». En possession du brevet A et en voie d’obtenir le brevet B, la victime avait largement dépassé ce niveau.