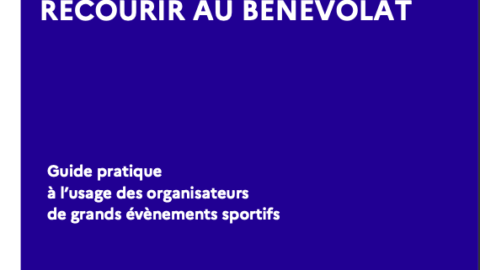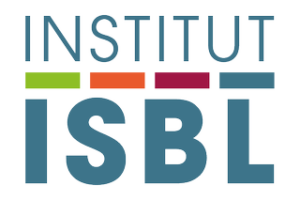Mesure emblématique de la loi du 30 juin 2000, le référé liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative permet de régler des situations où ne sont pas nécessairement en cause des décisions, comme c’est le cas pour le référé suspension, mais de simples agissements ou des carences de l’Administration. Cette procédure qui n’a pas tardé à connaître un succès croissant chez les victimes d’atteintes à des libertés fondamentales est toutefois subordonnée à des conditions restrictives dont le Conseil d’Etat, juge en appel, veille au respect scrupuleux comme le confirment ses ordonnances du 13 août 2013 et du 18 avril 2014.
La Loi du 30 juin 2000 a substitué aux procédures administratives d’urgence trois référés de droit commun[1] dont « le référé liberté ». Cette procédure, qui a constitué une réelle innovation en son temps, offre au juge des référés la possibilité de prendre toute mesure pour faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale.
2-Les ordonnances commentées ici ne sont évidemment pas les premières du genre. Mais elles méritent l’attention car elles confirment l’élasticité du concept de liberté fondamentale que le Conseil d’Etat a étendu aux atteintes à l’exercice de droits.
3-Dans la première espèce, il était question d’atteinte au droit de propriété. Un arrêté municipal avait interdit la circulation des véhicules à moteur sur le tronçon d’un chemin rural, à l’exception de certains véhicules[2], au motif d’assurer la tranquillité et la sécurité des randonneurs qui empruntent ce sentier situé sur un itinéraire pédestre de grande randonnée. Pour assurer le respect de cette interdiction l’arrêté avait prévu le dépôt d’un rocher au débouché du chemin sur la route. Un riverain saisit alors le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui prononça la suspension de l’arrêté et ordonna l’enlèvement du rocher.
4-Dans la seconde espèce, c’est le droit à la vie qui était l’objet de la requête. Des requins-bouledogues avaient à plusieurs reprises attaqué des surfeurs sur les plages de la Réunion, les blessant mortellement. Confrontée à l’inaction du préfet malgré sa demande d’autorisation de prélèvement de requins, une commune saisit le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis. Celui-ci fit injonction au préfet de procéder à la détermination des mesures nécessaires pour prévenir le risque d’attaques de ces squales.
5-Ces deux ordonnances sont réformées par le Conseil d’Etat qui se montre sourcilleux tant sur le respect des conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que sur les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés.
L’urgence
6-Le législateur n’a pas défini le concept d’urgence laissant ce soin au juge administratif. On pouvait penser que le Conseil d’Etat appliquerait au référé liberté les mêmes critères d’appréciation que pour le référé suspension et considérerait que cette condition est remplie « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » (Cne de Pertuis, req. no 254411 Lebon 68) que la situation d’urgence, pour l’application de l’article L. 521-2, n’était caractérisée que si elle impliquait que soit prise une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. C’est au requérant de « justifier de l’urgence de l’affaire ». L’atteinte ne peut être évoquée de façon générale dans la requête. Les requérants doivent apporter des éléments concrets d’appréciation et notamment établir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2.
7-Dès lors qu’il leur faut démontrer que l’atteinte à une liberté fondamentale est assez grave pour qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, la condition d’urgence se trouve de fait examinée en second. C’est d’abord de la gravité de l’atteinte et de son imminence dont il est question.
8-Ainsi, dans l’affaire des requins-bouledogues, le Conseil d’Etat constate d’abord l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie caractérisée par l’imminence d’un risque de mort ou de blessures graves, pour conclure « que, (…) la condition d’urgence est également satisfaite ». L’urgence se déduit donc de cette constatation.
9-De même, dans son ordonnance du 18 avril 2014, il commence par relever que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique considéré comme accessoire du droit de propriété. La gravité de l’atteinte caractérisée par le dépôt d’un rocher empêchant l’accès à une voie publique des véhicules à moteur, justifie l’urgence à en suspendre l’application dès lors qu’il empêche tout accès aux véhicules de secours. En revanche, la simple limitation du droit de circuler créant seulement une gène pour l’usager « ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai, de ce seul fait, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». D’où la décision du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à l’exception des dispositions relatives à l’enlèvement du rocher.
L’atteinte à une liberté fondamentale[3]
10-Une question préalable doit être réglée avant toute définition de l’objet et de l’intensité de l’atteinte à une liberté fondamentale. Normalement le droit d’agir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent se prévaloir d’une atteinte personnelle à l’exercice d’une liberté. C’est assurément le cas du propriétaire privé du libre accès à ses biens. En revanche, l’existence d’une commune n’est pas directement menacée par des attaques de requins. Elle ne peut, a priori, se prévaloir d’une atteinte grave au droit à la vie dont elle n’est pas titulaire. C’est précisément le moyen que faisait valoir le préfet estimant que « la requête de la commune […] était irrecevable, faute pour elle de justifier subir directement l’atteinte à la liberté fondamentale dont elle se prévaut ». Pourtant ce moyen est écarté par le Conseil d’Etat pour qui la « commune a intérêt à saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soient prises par l’autorité préfectorale des mesures de nature à prévenir ces attaques ». C’est une nouvelle manifestation du référé liberté pour autrui que le Conseil d’Etat avait précédemment consacré dans l’arrêt Ville de Paris[4]. Sans l’évoquer explicitement, la Haute assemblée justifie sa position par l’exercice du pouvoir de police du maire qui a en charge la sécurité de ses concitoyens et la mise en œuvre de toute mesure nécessaire pour l’assurer. Le référé liberté est un des moyens dont dispose l’autorité de police municipale pour accomplir ses missions[5]. Et si, en l’occurrence, elle doit passer par la voie judiciaire, c’est que les mesures à prendre relèvent de la compétence du préfet, à la fois de son pouvoir de police spéciale pour celles à mettre en œuvre dans le périmètre de la réserve marine, mais aussi de ses compétences propres dès lors que les attaques des requins-bouledogues dépassent le seul territoire d’une commune et ont vocation à s’appliquer dans le ressort de plusieurs communes. Ce sont, d’ailleurs, les motifs dont le Conseil d’Etat s’est prévalu pour rejeter les deux fins de non-recevoir qu’opposait le préfet, estimant que la commune n’était pas recevable à demander au juge des référés le prononcé de mesures relevant du pouvoir de police du maire.
11-Pour que le référé liberté aboutisse, il faut encore établir « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Cette double condition en limite, a priori, singulièrement le périmètre. D’abord, l’atteinte doit porter sur une liberté fondamentale, ce qui impose de faire le tri entre les libertés en écartant celles qui ne présentent pas ce caractère. Ensuite, il faut exclure les atteintes qui ne sont ni graves ni manifestement illégales. De surcroît, aucun de ces concepts n’a été défini. L’imprécision des termes employés, laisse donc une grande marge d’appréciation au juge administratif qui ne s’en est pas privé.
12-L’emploi de l’expression de « libertés fondamentales » implique nécessairement de faire un tri. Dans la conception formelle, sont considérées comme libertés fondamentales uniquement celles qui forment le bloc de constitutionnalité. Le juge administratif des référés s’est ainsi fondé sur la Constitution et sur son préambule pour qualifier de liberté fondamentale la libre administration des collectivités territoriales (CE 18 janvier 2001 req. n° 229247), le droit d’asile (CE 9 décembre 2003 req. n° 262186), la liberté de culte (CE, 16 février 2004 req. n° 264314) ainsi que la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie qui en est une composante (CE, 12 novembre 2001 req. n° 239840). Cependant, la valeur constitutionnelle d’une liberté est un « indice (de sa fondamentalité) mais pas un critère absolu »[6]. Le juge administratif tirant parti du silence du législateur a développé « une notion autonome, moderne et pragmatique de la liberté fondamentale »[7]. Il a admis qu’une liberté ne tienne pas nécessairement son caractère fondamental de sa consécration constitutionnelle ou conventionnelle. Ainsi, il a jugé qu’une liberté fondamentale puisse trouver son origine dans une loi comme celle du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle.[8] Le Conseil d’Etat ne s’est donc pas limité au critère formel et n’hésite pas à faire des applications du critère matériel en intégrant les libertés publiques dans la catégorie des libertés fondamentales comprises comme celles qui assurent la protection des individus contre les intrusions de la puissance publique. Ainsi a-t-il admis que « le refus de renouvellement ou de délivrance d’un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d’aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ». Mais il n’en est pas resté là et a admis que le concept de liberté puisse englober les atteintes à des droits.
13-La question s’est posée pour le droit de propriété. Comme l’avait fait justement remarquer le tribunal administratif de Paris, « une liberté est un droit qui se définit communément comme celui de disposer d’un pouvoir d’autodétermination » (…) Or, si les attributs du droit de propriété ont pour effet de conférer à son titulaire les ‘‘libres’’ usage, jouissance et disposition de la chose possédée, ils ne peuvent néanmoins avoir par eux-mêmes pour conséquence de faire de ce droit réel une liberté au sens sus-évoqué »[9]. Néanmoins, le Conseil d’Etat ne s’est pas arrêté à cette objection[10] et a déjà eu l’occasion d’affirmer que le libre accès des riverains à la voie publique constituait un accessoire du droit de propriété[11].
14- Mais, l’atteinte a un droit doit avoir une incidence sur l’exercice d’une liberté. « Directement ou indirectement, il est nécessaire qu’il y ait mise en cause d’une liberté »[12]. Ainsi, les arrêts rattachent habituellement le droit de propriété[13] à la liberté de disposer librement de ses biens par son propriétaire[14]. Dans son ordonnance du 18 avril 2014 le Conseil d’Etat observe « que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». En somme, le droit de propriété est assimilé à une liberté fondamentale car il suppose nécessairement que son titulaire puisse disposer librement de son bien.
15-Est-ce aussi vrai pour le droit à la vie ? Faut-il admettre qu’il a pour accessoire la liberté de mener toutes les actions que requiert sa nature pour la réalisation et l’épanouissement de la personne ? L’existence de ce droit n’est-elle pas la condition préalable à l’exercice de toutes les libertés ? Par ailleurs, le fait que ce droit soit consacré par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel le Conseil d’Etat fait explicitement référence dans son ordonnance du 13 août 2013, suffit pour le ranger dans la catégorie des libertés fondamentales dès lors que la Haute assemblée s’est inspirée à plusieurs reprises des normes conventionnelles pour déceler le caractère fondamental d’une liberté[15].
Une atteinte grave et manifestement illégale
16-Il ne suffit pas que l’atteinte à une liberté fondamentale ait été établie. Il faut encore qu’elle soit grave et manifestement illégale. Si on s’en réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la condition d’illégalité manifeste doit être regardée comme remplie s’il « est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise »[16]. La Haute assemblée a fait application de cette règle dans son ordonnance du 18 avril 2014 dans laquelle elle relève que la mesure consistant à interdire, au moyen du dépôt d’un rocher, tout accès par des véhicules à quatre roues à un chemin desservant des habitations constitue « une mesure excessive au regard de l’objectif recherché qui est la tranquillité et la sécurité des randonneurs qui empruntent le sentier de grande randonnée dont le tronçon en cause constitue un élément ».
17-Dans le cas inverse où aucune mesure n’a été prise, comme dans l’affaire des requins- bouledogues, et qu’il est reproché à l’autorité publique de ne pas avoir pris de mesures suffisantes, il faut établir que cette inaction relative a eu pour effet de mettre en péril la liberté ou le droit que l’autorité publique est censée protéger, ici le droit à la vie. Sans doute, l’Administration n’est pas restée inactive. Ainsi, le préfet a engagé un programme d’études sur le comportement des deux espèces de requins côtiers en cause, afin notamment de vérifier leur éventuelle sédentarisation. Par ailleurs, il a pris des mesures d’interdiction de certaines activités nautiques. Néanmoins ces mesures ont été jugées insuffisantes en regard de la gravité et de l’imminence du danger. Plusieurs circonstances l’attestent : la multiplication des attaques (11 répertoriées entre juin 2011 et juillet 2013), l’ampleur des dommages (5 attaques mortelles) et le fait que certaines attaques se sont produites à proximité du rivage. Cette situation qualifiée « d’exceptionnelle » révèle la disproportion entre les mesures prises et le risque de nature à créer « un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ». Sans doute le risque est-il limité aux pratiquants sportifs et spécialement aux surfeurs qui sont les plus exposés aux attaques. Pourtant le Conseil d’Etat considère que l’existence d’un tel risque mortel, surtout s’il s’agit d’une activité ordinaire de baignade proche du rivage, excède les dangers qui peuvent être normalement encourus lors de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs par une personne même avertie du risque pris. En somme, si on peut admettre qu’un sportif accepte le risque d’atteinte à son intégrité corporelle en relation avec la pratique de son sport, comme celui de noyade pour les activités aquatiques, en revanche, il n’accepte pas celui sans rapport avec cette activité car il est incapable de le maitriser. De surcroît, la Haute assemblée relève à juste titre, faisant ici écho à une jurisprudence de la Cour de cassation, que le risque de mort excède les dangers normaux qu’acceptent les pratiquants d’un sport à risque comme le surf et à fortiori les adeptes d’activités purement ludiques comme la baignade.
18-Une fois la gravité de l’atteinte établie, le juge va devoir évaluer les mesures qui permettront de la faire cesser dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond par le juge du principal.
Les mesures prescrites
19-L’ordonnance du 13 août 2013 sur les requins-bouledogues fournit deux indications intéressantes sur les mesures susceptibles d’être prises dans le cadre du référé liberté. D’abord, le Conseil d’Etat reproche au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de s’être borné « à fixer un objectif général sans préciser les domaines dans lesquels des mesures pouvant porter effet dans un bref délai doivent être prises ». Celui-ci s’était, en effet, contenté d’enjoindre à l’administration préfectorale de procéder à la détermination des mesures nécessaires pour prévenir le risque d’attaques de requins-bouledogues. Ce rappel à l’ordre est intéressant. Il donne la mesure de l’étendue des pouvoirs du juge administratif qui se substitue à l’administration pour déterminer quelles mesures celle-ci doit prendre. On peut y voir le moyen pour le juge d’empiéter sur ses compétences et partant d’égratigner le principe de séparation des pouvoirs. Mais c’est la loi qui le permet puisque l’article L. 521-2 désigne « toute mesure nécessaire ».
20-Toutefois, le Conseil d’Etat pose une limite à ce pouvoir de prescription. C’est le deuxième enseignement de l’ordonnance. Il est la conséquence du bref délai dont dispose le juge des référés pour se prononcer. L’article L. 521-2 prévoit qu’il dispose pour cela « d’un délai de quarante-huit heures ». Le préfet faisait remarquer que le premier juge s’était contredit sur ce point en lui enjoignant de déterminer des mesures à prendre dans le délai de quinze jours et non dans celui de quarante-huit heures. Mais, c’était faire une confusion entre le délai édicté par l’article L. 521-2 qui concerne celui imparti au juge pour statuer et le délai que celui-ci prescrit à l’autorité publique pour prendre les mesures de nature à faire cesser l’atteinte. Cependant, la nécessité pour le juge de se prononcer dans un délai aussi bref a, selon l’analyse du Conseil d’Etat, une incidence directe sur les mesures qu’il va prescrire. Il ne peut s’agir que de celles dont les effets sont immédiats. Aussi, considère-t-il que le prélèvement de requins ou l’installation de dispositifs limitant leur incursion dans certaines zones, ne peuvent être prescrites sur le fondement de l’article L. 521-2 car leurs effets favorables éventuels ne sont pas susceptibles de se produire à bref délai. Il ne peut s’agir que de mesures complémentaires qui relèvent « d’une décision ultérieure » prise à brève échéance. Ainsi le juge des référés doit-il faire la part entre les mesures immédiatement applicables et celles qui doivent être différées. En l’occurrence, le Conseil d’Etat a jugé que seules les interdictions de baignade et d’activités nautiques, dans des zones où elles n’avaient pas encore été prises et leur diffusion par une signalisation adaptée pouvaient être prescrites.