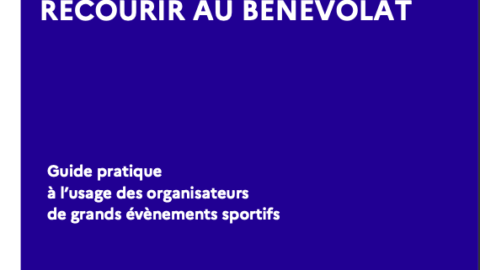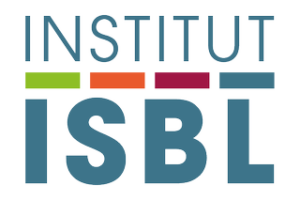La procédure du référé suspension est une arme fréquemment utilisée par les sportifs en réplique aux sanctions disciplinaires prononcées par leurs fédérations sportives susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts financiers. Toutefois, la suspension de la mesure par le juge des référés est subordonnée à des conditions draconiennes et spécialement à l’exigence d’urgence que le Conseil d’Etat a estimé non remplie dans son ordonnance du 3 novembre 2014 rendue à la suite de la requête d’une footballeuse professionnelle ayant fait l’objet d’un avertissement pour avoir manqué à son obligation de localisation.
1-L’actualité sportive de ces derniers mois a révélé qu’une sportive professionnelle évoluant dans le club de football du Paris Saint-Germain en division 1 féminine s’était rendue coupable de manquements à l’obligation de fournir des renseignements précis sur sa localisation[1]. Le cas n’est pas unique et il existe des précédents comme la presse s’est plu à le rappeler. En l’occurrence, la joueuse avait été désignée par le directeur des contrôles de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) pour faire partie du groupe cible des sportifs soumis aux contrôles individualisés prévus par les articles L. 232-5 et L 232-15 du code du sport. Après deux tentatives de contrôle sans résultat, suivis d’avertissements, l’AFLD a soumis l’intéressée à un troisième contrôle individualisé à son domicile. Nouvel échec : le préleveur ayant constaté son absence lors de son contrôle inopiné, le président de l’AFLD lui a notifié alors un troisième avertissement pour manquement aux obligations de localisation. Son recours gracieux ayant été rejeté, l’intéressée s’est adressée au juge des référés du Conseil d’Etat pour obtenir en urgence la suspension de l’avertissement et le rejet implicite de son recours gracieux.
2-Les procédures administratives d’urgence ont été réformées par la loi du 30 juin 2000. Elles ont une double justification. D’abord, l’afflux des requêtes qui retarde l’examen des décisions par le juge du fond. Ensuite, « le privilège du préalable » en vertu duquel les actes de l’administration sont immédiatement applicables. Dans ces conditions, l’existence d’une procédure d’urgence présente l’avantage de suspendre l’exécution d’une décision administrative dont les effets pourraient être irréparables si elle s’avère illégale. La suspension de l’acte administratif peut être obtenue de deux manières. Soit par la procédure du référé suspension (art. L. 521-1 COJA) qui a remplacé l’ancien sursis à exécution, soit par celle du référé liberté (Art. L. 521-2 COJA) qui permet au juge de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3-Le référé suspension et le référé liberté ont une condition d’octroi commune : l’urgence. En effet, c’est lorsque « l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » que le juge des référés, « saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ». De même, il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’il est saisi « d’une demande justifiée par l’urgence ».
4-Le législateur n’ayant pas défini l’urgence, le juge administratif a dû s’atteler à cette tâche.
Très vite, le Conseil d’Etat a pris position sur sa définition dans un arrêt remarqué du 19 janvier 2001 Confédération nationale des radios libres. Dans un considérant de principe il a affirmé que « la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ».
5-De toute évidence, il ressort de cette définition, devenue classique puisqu’on la retrouve dans des arrêts récents[2], que l’urgence ne se réduit pas à l’imminence de l’exécution de l’acte litigieux. Elle s’apprécie au regard de deux éléments cumulatifs : d’une part, les conséquences graves de l’acte et d’autre part l’immédiateté du préjudice. L’urgence au sens où l’entend le Conseil d’Etat ne se limite pas à sa « composante temporelle » mais s’y ajoute aussi une « composante matérielle »[3] qui rend plus difficile sa justification.
6-La requérante n’ignorait pas ces exigences puisqu’elle indique dans sa requête « que les décisions contestées sont susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation en l’empêchant, à brève échéance, d’exercer son activité sportive et en portant atteinte à ses intérêts financiers, à son image et à sa réputation ». Elle précise, à cet égard, qu’une mesure de suspension d’une durée d’au moins un an l’empêchera de participer aux compétitions sportives importantes pour la suite de sa carrière, la privera de sa rémunération de joueuse professionnelle ainsi que des primes prévues en cas de sélection en équipe de France et sera de nature à lui faire perdre définitivement le bénéfice de ses contrats de partenariat.
7-En l’espèce, c’est principalement sur la composante temporelle que va se jouer la décision de la Haute juridiction. Celle-ci considère que le préjudice dont se prévaut la requérante ne répond pas à la condition d’immédiateté.
8-L’immédiateté s’apprécie « à la date à laquelle le juge des référés se prononce »[4]. Le préjudice n’est pas immédiat s’il n’est pas actuel à la date à laquelle le juge statue et s’il est susceptible de se produire à un stade ultérieur d’une procédure administrative. Ainsi, il a été jugé que la condition d’urgence n’était pas remplie, dans une autre espèce où avait été donnée l’autorisation de création d’une salle de cinéma multiplexe, alors que l’immeuble dans lequel l’installation des huit salles était envisagée n’était pas construit, et qu’aucun permis de construire n’avait même été délivré[5]. En l’espèce, la décision avait été prise, mais sans avoir encore été exécutée. Bien mieux, dans la présente affaire, nous n’en sommes que dans la phase préparatoire d’une décision administrative. En effet, aux termes de l’article 13 de la délibération n° 54 des 12 juillet et 18 octobre 2007 du collège de l’Agence « Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l’article 9 pendant une période de dix-huit mois consécutifs, l’agence transmet à la fédération compétente un constat d’infraction ». Or comme le relève le Conseil d’Etat, « les décisions dont la suspension est demandée se bornent à constater un nouveau manquement de Mme B…à ses obligations de localisation et à indiquer que ce constat sera transmis à la fédération sportive auprès de laquelle elle est licenciée ». A ce stade de la procédure, ni l’organe disciplinaire de la fédération qui dispose d’un délai de dix semaines pour se prononcer, à compter de la réception du constat transmis par l’Agence, ni l’organe disciplinaire d’appel saisi d’office si l’organe disciplinaire n’a pas statué dans ce délai, ne se sont prononcés (Art L 232-21 C. sport), , ce qui fait dire à la Haute juridiction que « le préjudice invoqué par la requérante ne pourrait résulter que d’une sanction éventuellement prononcée par cette fédération ». En effet, la sanction n’est pas automatique tant dans son principe que dans son quantum. Le Conseil d’Etat relève, à cet égard, que « si les organes disciplinaires des fédérations doivent appliquer les sanctions prévues par le règlement disciplinaire type « en tenant compte », selon l’article 39 de ce règlement, des recommandations figurant aux articles 9 à 11 de la convention mondiale antidopage, il leur appartient d’apprécier, dans chaque cas, la réalité et la gravité du manquement reproché au sportif, notamment au vu des justifications qu’il invoque, et de déterminer la sanction adaptée à ce manquement ». En somme, il ne s’agissait que d’un préjudice éventuel et non actuel puisque l’organe disciplinaire de la fédération ne s’était pas prononcé.
9-De surcroit, s’il ne répondait pas à la composante temporelle, le préjudice ne satisfaisait pas plus à la composante matérielle, c’est-à-dire à l’exigence de gravité. La Haute assemblée exige, en effet, que lui soit fourni suffisamment d’éléments concrets[6] pour pouvoir évaluer si la décision litigieuse a porté une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, elle a estimé, que cette condition n’était pas remplie dans le cas d’un pilote à qui on avait refusé de se présenter aux épreuves du brevet de pilote privé d’hélicoptère au motif que ce diplôme s’applique, non pas à l’exercice d’une activité professionnelle, mais à une activité de loisirs[7]. Au contraire, elle a jugé qu’elle était satisfaite dans le cas de la perte, par un chauffeur de taxi, de la validité de son permis de conduire[8]. On pourrait penser que l’interdiction pour une footballeuse professionnelle d’exercer son métier pendant au minimum une année est une circonstance suffisante pour justifier la gravité de l’atteinte qu’elle subit. Encore faut-il qu’elle rapporte la preuve qu’une sanction disciplinaire aurait un effet direct sur ses intérêts financiers c’est-à-dire sur son salaire et sur les revenus qu’elle tire de ses contrats de partenariat. Or sur ce point le Conseil d’Etat s’estime insuffisamment renseigné puisque « la requérante ne précise pas dans quelles conditions le salaire que lui verse son club viendrait à être suspendu en cas de sanction ». En outre, il relève que la rémunération des contrats de partenariat passés par la requérante « ne constitue qu’une part limitée de ses revenus ». Enfin, il remarque « qu’elle est subordonnée, à l’existence d’atteintes « graves » à l’image du cocontractant ou à des agissements « manifestement contraires » aux lois et règlements ou aux comportements attendus d’un sportif professionnel, ainsi qu’à l’appréciation du cocontractant ». Il considère donc que la requérante ne lui pas apporté d’éléments suffisants pour établir que les manquements à l’obligation de localisation seraient d’un degré de gravité assez sérieux pour porter atteinte à l’image ou au comportement attendu d’un sportif professionnel et, en conséquence, justifier la rupture des contrats de partenariat. Dans ces conditions, faute de satisfaire aux exigences d’immédiateté et de gravité du préjudice, le rejet de la requête devenait inéluctable.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
Notes:
[1] Aux termes de l’article 3 de la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet et 18 octobre 2007 du collège de l’Agence: « Tout sportif désigné par le directeur des contrôles de l’agence pour faire l’objet de contrôles individualisés doit indiquer, pour chaque jour, un créneau horaire d’une heure, durant lequel il est susceptible de faire l’objet d’un ou de plusieurs contrôles individualisés par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage ».
[2] CE, ord., 12 sept. 2014, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, n° 383721, CE, 26 août 2014, n° 382755, CE 10 sept 2014, n° 383820.
[3] « Du neuf avec du vieux : l’urgence en matière de suspension ». B. Seiller, D. 2001 juris p. 1414.
[4] CE 26 août 2014, n° 382755.
[5] CE 1er févr. 2001, n° 228875 229018.
[6] « Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ». CE 26 août 2014, n° 382755. CE 10 sept 2014, n° 383820.Ainsi dans un arrêt du 14 mars 2001 le Conseil d’Etat a annulé une ordonnance d’un juge des référés se bornant à relever, pour suspendre un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour, que la condition d’urgence était remplie eu égard à l’invitation de l’intéressé à quitter le territoire sans rechercher « s’il justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension demandée ».