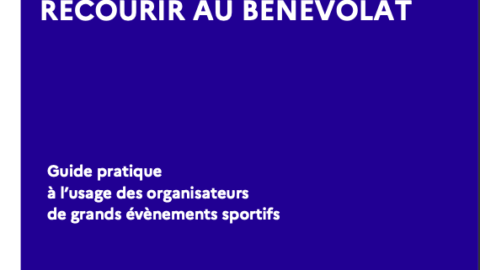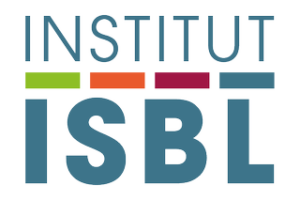Les collisions en vol d’aéronefs légers -parapentes, parachutes ou deltaplane- révèlent l’encombrement de l’espace aérien qu’il faut attribuer à l’engouement pour les sports aéronautiques. Elles sont aussi source de contentieux lorsque les victimes ne parviennent pas à trouver un accord sur leurs responsabilités, comme l’atteste l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2010 qui avait à se prononcer à la fois sur le terrain de la responsabilité pour faute et sur celui de la responsabilité sans faute.
1- Dans la première espèce, le passager d’une montgolfière avait été blessé à la suite de l’atterrissage précipité de son aéronef. Dans la seconde un élève avait fait une chute alors qu’il pilotait un ULM paramoteur. Le débat tournait autour du régime de responsabilité applicable. Pourtant la solution ne faisait guère de doute. En effet, depuis un arrêt de 1999, la Cour de cassation considère que le baptême de l’air est soumis aux règles du code de l’aviation civile tandis que l’initiation au vol libre relève des règles du droit commun de la responsabilité civile. Les dispositions des articles L 110-1 et L 310-1 du code de l’aviation civile devaient donc s’appliquer à l’accident de montgolfière survenu lors d’une promenade d’agrément. En revanche, c’est l’article 1147 du code civil qui devait arbitrer le litige relatif à l’accident d’ULM survenu, lui, lors d’un vol d’instruction.
I- Détermination des règles applicables
2- Pour bien saisir les enjeux du litige et le débat sur la détermination de la loi applicable, il faut d’abord prendre la mesure de l’importante différence entre les règles du code de l’aviation civile et celles du droit commun. Elles portent notamment sur la mise en oeuvre de la responsabilité, l’étendue de la réparation plafonnée dans le transport aérien, la prescription de l’action en responsabilité et la compétence juridictionnelle.
3- Depuis l’arrêt de la 1ère chambre civile de 1999 qui a admis que le baptême de l’air était une promenade aérienne et non l’initiation à une activité sportive, deux critères cumulatifs déterminent l’application du code de l’aviation civile : le transport à bord d’un aéronef d’une part et un vol ayant pour finalité le déplacement d’autre part.
4- La Cour de cassation définit l’aéronef comme tout « appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs » [1]. Cette définition permet de déborder largement du cadre des avions et d’y inclure, comme l’ont fait les tribunaux [2] tous les engins légers comme les deltaplanes, parapentes et ULM qui se déplacent grâce aux courants aériens. Rien de surprenant, donc, que la Cour de Douai ait assimilé une montgolfière à un aéronef.
5- Le contrat de transport aérien se définit aussi par le but du déplacement. L’article L. 310-1 du code de l’aviation civile précise qu’il « consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers ». Pourtant les vols de promenade n’ont pas toujours été considérés comme des contrats de transport, notamment en raison du caractère circulaire du déplacement. Ceux effectués à bord d’engins légers avec un lieu unique pour l’envol et l’atterrissage ont été longtemps traités comme des contrats d’initiation à un sport [3] jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1999 qui va substituer les règles du code de l’aviation civile à celles du droit commun de la responsabilité. La première chambre civile y approuve les juges du fond d’avoir relevé que le baptême de l’air en parapente qui a un caractère occasionnel à la différence du vol d’instruction était « une promenade aérienne et non pas une initiation à la pratique de l’activité sportive de parapente ». Elle en a donc logiquement déduit la qualification de transport aérien et affirmé même péremptoirement dans un arrêt du 3 juillet 2001 que « le baptême de l’air en parapente biplace est un transport aérien » [4]. Elle a étendu cette jurisprudence dans ses arrêts du 22 novembre 2005 au deltaplane [5] et à l’ULM [6].
6- Ce qui est vrai pour ces engins par nature légers, doit l’être également pour une montgolfière. La Cour d’appel de Douai a donc justement retenu la qualification de transport aérien au vol de cet aéronef d’autant qu’il ne s’agissait pas d’un vol circulaire puisque le lieu de l’envol était distinct de celui de l’atterrissage [7]. De surcroît cette promenade méritait bien le qualificatif de « succédané d’un baptême » dès lors qu’il s’agissait d’un vol ponctuel. Rien à voir avec un stage d’initiation dont la finalité est l’acquisition des techniques de pilotage impliquant une progression pédagogique qui sous-entend la répétition des vols.
7- En revanche, lorsqu’il s’agit de faire un tel apprentissage, la Cour de cassation refuse de qualifier ce contrat de transport aérien considérant que l’élève « n’a pas en vue un déplacement, mais seulement la leçon qu’il va recevoir » [8]. C’était précisément la situation à laquelle était confrontée la victime dans la seconde espèce où l’accident était survenu lors d’un vol d’instruction. Les premiers juges ayant admis la qualification de transport aérien à ce vol en ULM, il fallait s’attendre à ce que la Cour d’appel de Douai, réforme la décision. L’enquête révèle, en effet, que la victime avait débuté un mois auparavant une formation en vue de l’obtention du brevet de licence ULM classe parachute motorisé. Le jour de l’accident, elle effectuait un vol de perfectionnement dans le cadre de l’école et pilotait l’appareil sous le contrôle de son instructeur. La finalité du vol concernait donc bien l’initiation au vol en ULM et non pas un baptême de l’air qui ne peut s’effectuer sans la présence de l’instructeur aux commandes de l’avion.
II- Application des règles du code de l’aviation civile
8- Les règles du code de l’aviation civile s’appliquant au vol en montgolfière, la cour de Douai avait un nouveau point de désaccord à trancher entre les parties. Après le débat sur la qualification du contrat, il fallait également régler celui qui les opposait sur sa nature. En effet, les règles de la responsabilité diffèrent selon que le transport s’effectue à titre gratuit ou onéreux. L’exploitant prétendait qu’il s’agissait d’un vol gratuit alors que la victime, au contraire, estimait qu’il s’agissait d’un vol rémunéré. Là encore, l’enjeu du litige était de taille. Si le vol gratuit était retenu, c’est le régime de responsabilité pour faute prouvée qui s’appliquait. Cela signifie deux choses : d’une part, que la responsabilité du transporteur n’est pas automatique mais subordonnée à l’existence d’une faute et d’autre part que la charge de la preuve incombe à la victime.
9- En revanche, si le transport s’effectuait à titre onéreux, c’est une responsabilité pour faute présumée qui s’appliquait et non pas de plein droit comme le mentionne l’arrêt. Cette expression imparfaite peut laisser penser à tort qu’il est fait référence à une présomption de responsabilité. Or il s’agit pourtant d’une présomption de faute comme l’admet d’ailleurs la Cour de Douai puisqu’elle autorise le transporteur à établir l’absence de faute de pilotage. En pratique cette présomption de faute est difficile à combattre, notamment lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, en raison de la sévérité des tribunaux dans l’appréciation des causes exonératoires [9]. Ceci peut expliquer cette expression de responsabilité de plein droit utilisée par les juges et par certains auteurs.
10- La mise en jeu de la responsabilité du transporteur est donc quasi-automatique en cas de transport rémunéré alors que la victime d’un accident survenu lors d’un vol gratuit doit supporter un régime de responsabilité pour faute prouvée bien qu’elle soit totalement passive. On comprendra donc, dans la présente espèce, que le seul moyen pour elle d’être épargné du fardeau de la preuve consistait à faire valoir que le transport s’était effectué à titre onéreux. En l’occurrence, le transporteur, bien que non rémunéré, était intéressé à l’opération puisque le vol trouvait sa cause dans des accords commerciaux ayant but de favoriser les relations d’affaires et de fidéliser un client. L’argument n’est pourtant pas retenu par la cour qui se range à la jurisprudence dominante en droit aérien selon laquelle le transport bénévole inclut le transport intéressé. En refusant de l’assimiler au transport onéreux pour lui préférer la qualification de transport gratuit, la cour met la victime dans l’obligation d’établir la preuve d’une faute de pilotage.
11- Celle-ci pouvait facilement se déduire des circonstances de l’espèce. En effet l’atterrissage avait eu lieu non pas sur le terrain initialement prévu dépourvu de tout risque mais en un lieu parfaitement inadapté à une montgolfière puisque formé de buttes et de tranchées larges et profondes. La défense du pilote faisant état d’une brutale dégradation des conditions atmosphériques n’a pas résisté à l’examen des juges ayant relevé, au contraire, qu’elles étaient propices au vol d’après les déclarations des enquêteurs. En tout état de cause le pilote ne démontre pas que la dégradation aurait été telle qu’elle l’aurait contraint à un atterrissage précipité.
12- La responsabilité de l’exploitant une fois engagée, la victime n’était pas assurée de bénéficier d’une réparation intégrale, en raison de la limitation de responsabilité du transporteur, plafonnée par l’article L 322-3, à 114 336,76 euros [10]. Seule une faute inexcusable, dont la définition figure à l’article 321-4, pouvait mettre ce plafonnement d’indemnité en échec. La preuve d’une telle faute, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, laisse peu de chance à la victime de l’établir. Le plus souvent, il sera question d’une erreur d’appréciation du pilote sur la manœuvre à opérer [11] comme c’était le cas en la circonstance. Ce n’est manifestement pas une faute délibérée, comme pourraient l’être des acrobaties inconsidérées ou un vol à trop basse altitude, qui rendent probable la survenance d’un dommage qu’un pilote ne peut ignorer. Il n’est donc guère surprenant que la victime ne soit pas parvenue à rapporter la preuve d’une telle faute, comme le constatent les juges.
13- Outre la faute inexcusable, la convention de Varsovie prévoit une autre situation dans laquelle la victime a droit à une réparation intégrale. Celle de l’absence ou de l’irrégularité du titre de transport ce qui était le cas en l’occurrence. Ce moyen admis par les premiers juges a été rejeté sans surprise en appel dès lors que la jurisprudence française considère que cette disposition de la convention n’a pas été reprise pour les transports intérieurs [12].
14- Ce traitement différencié des victimes, selon le mode de transport choisi (à titre onéreux ou gratuit) et selon qu’il s’agit d’un vol d’agrément ou d’un vol d’instruction, est choquant. Il l’est encore plus lorsque le transporteur exploite un établissement sportif car il se trouve alors assujetti à une obligation d’assurance et que c’est au final l’assureur en responsabilité qui prendrait en charge la réparation. La responsabilité allégée du transporteur à titre gratuit a pu s’expliquer pour ne pas faire peser à celui qui rend service une responsabilité aussi lourde que celui qui effectue un transport à titre onéreux. Mais elle n’est plus aujourd’hui en phase avec le puissant courant d’indemnisation des victimes et la multiplication des régimes spéciaux d’indemnisation. Aujourd’hui, « L’urgence n’est plus la protection du transporteur mais la garantie de l’intégrité du consommateur de transport » [13]. Le passager d’un véhicule automobile accidenté a toute chance d’être intégralement indemnisé grâce aux bienfaits de la loi Badinter : le conducteur, même s’il effectue un transport à titre amical, est responsable de plein droit du dommage, à la différence du pilote d’un aéronef. De surcroît, il n’a pas la possibilité de s’exonérer par la voie de la force majeure ou du fait d’un tiers.
On en arrive à cette conclusion curieuse où il vaut mieux faire une promenade en quad que de monter à bord d’un aéronef pour un vol d’agrément ! Aussi, on ne peut que conseiller au passager d’un baptême de l’air gratuit de souscrire une assurance individuelle accident. Faut-il enfin relever que la victime aurait été intégralement indemnisée en application des règles du droit commun, si elle avait pris une leçon et reçu l’ordre d’atterrir à l’endroit de l’accident ? C’est précisément la situation dans laquelle se trouvait celle accidentée lors d’un vol d’instruction.
III- Application des règles du droit commun
15- Dans la seconde espèce, où la qualification de transport aérien avait été retenue à tort par les premiers juges, ce sont les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle qui devaient s’appliquer, comme le rappelle la Cour d’Aix-en-Provence et plus spécifiquement l’article 1147 du Code civil.
16- Suivant celles-ci, l’exploitant est tantôt assujetti à une obligation de sécurité résultat dans le cas où le cocontractant n’a pas participé à l’exécution du contrat, ce qui implique un rôle passif de sa part, tantôt une obligation de sécurité moyens s’il a eu un rôle actif. Le comportement de l’élève, et par voie de conséquence le régime de responsabilité applicable, dépend de sa position en cours de vol.
17- Si l’élève prend sa leçon sur un appareil biplace piloté par son moniteur et dont il n’est que le passager, l’exploitant est tenu d’une obligation de résultat. Ainsi en a décidé la Cour de cassation pour les vols, au cours desquels l’élève n’a joué aucun rôle actif [14], ce qui implique nécessairement que le moniteur soit a
ux commandes de l’appareil. Solution logique : si l’élève n’a pas participé à la conduite de l’appareil, il est en droit, comme le passager d’un train ou d’un autobus, de prétendre à une sécurité absolue [15]. En revanche, s’il prend les commandes, l’obligation de l’exploitant est à nouveau une obligation de moyen.
18- Lorsque l’élève est seul en vol et suit les instructions données au sol par le moniteur, comme c’était le cas dans la présente espèce, l’obligation de sécurité est invariablement de moyen. Toutefois, s’agissant d’un sport dangereux, la Cour de cassation considère qu’elle s’apprécie alors avec plus de rigueur ce que ne manquent pas de relever les juges d’appel [16].
19- Outre la dangerosité de l’activité pratiquée, il faut aussi mettre au compte du renforcement de l’obligation de sécurité le manque d’expérience de l’élève qui, en l’occurrence n’avait effectué que 5 heures de vol en paramoteur à la date du dommage. Dans de telles circonstances, les juges n’hésitent pas à relever la moindre faute et à mettre le niveau des exigences de sécurité au-delà même de celui fixé par les réglementations fédérales comme c’était le cas, en l’espèce. Il n’est donc pas surprenant qu’une communication par radio se soit imposée dans leur esprit, même si ce mode de contact n’était pas prévu dans le contrat et si, selon les dires d’un formateur d’instructeurs, l’usage de la radio n’est pas obligatoire. Ils observent toutefois que ce témoin a convenu qu’il s’agissait « d’un outil pédagogique appréciable » et que le pilote tellement convaincu de son utilité a faussement porté dans sa déclaration d’accident la mention selon laquelle « l’élève était suivi en vol et par radio ».
20- Ce défaut de moyen de communication était-il la cause de l’accident ? L’exploitant tentait précisément de démontrer l’absence de lien de causalité entre cette négligence et le dommage.
C’est l’occasion de rappeler que l’exigence d’un tel lien fait partie des conditions de mise en œuvre de toute responsabilité. N’ayant pu convaincre les juges qu’il avait accompli les diligences normales de sa fonction, l’exploitant disposait encore de ce moyen de défense classique. Il n’a pas eu plus de succès puisque les juges d’appel ont, au contraire, estimé que la cause des difficultés rencontrées par la victime n’étant pas détectable depuis le sol, l’utilisation d’une radio aurait permis au moniteur de lui prodiguer les conseils nécessaires pour redresser l’appareil. Ce raisonnement par déduction apparaît plus comme une présomption de causalité que comme une véritable preuve. Mais il arrive que les juges y aient recours en faveur de la victime lorsque le risque d’accident est hautement prévisible ce qui était le cas. La victime n’ayant que cinq heures de vol à son actif, il y avait une forte probabilité qu’en cas de difficulté de l’élève le moniteur ne puisse pas le conseiller et lui éviter une chute.
21- Au final, cette coexistence de plusieurs régimes de responsabilité, qui trouvent leur source dans deux codes distincts, est source de litige et d’injustice. Comme l’a fait remarquer la doctrine [17] les dispositions de la Convention de Varsovie auxquelles renvoie toujours le code de l’aviation civile [18], sont aujourd’hui dépassées car la priorité n’est plus de protéger le transporteur mais le consommateur de transport comme l’atteste la Convention de Montréal de 1999 (applicable aux « transporteurs aériens communautaires » mais pas aux vols d’engins légers) qui supprime tout plafond de responsabilité en cas de dommages corporels.
22- Il est choquant qu’une personne effectuant un baptême de l’air (réparation plafonnée ; responsabilité pour faute prouvée s’il est offert ou pour faute présumée s’il est rémunéré) soit moins bien traitée que celle qui prend une leçon dans un appareil biplace piloté par le moniteur (obligation de résultat et responsabilité sans faute) alors que ni les uns ni les autres n’ont participé activement à l’opération.
23- Cette injustice pourrait être réparée en déniant au baptême de l’air la qualification de transport comme avait tenté de le faire le pourvoi. C’est la solution adoptée par la chambre criminelle qui a pris « l’exact contre-pied de la 1ère chambre civile » en rangeant les baptêmes de l’air à bord d’engins légers dans la catégorie d’activités d’enseignement au motif que le passager n’est pas inactif puisqu’il doit coopérer au décollage et à l’atterrissage [19].
L’abandon de la qualification de transport aérien pour tout type de vol d’agrément ou d’instruction à bords d’engins légers permettrait d’appliquer les règles de droit commun de la responsabilité civile contractuelle [20]. Elle aurait l’avantage d’offrir à la victime le bénéfice d’une réparation intégrale sans qu’elle n’ait à administrer la preuve d’une faute (y compris inexcusable) du moniteur pendant les vols où celui-ci est aux commandes de l’engin comme c’était le cas dans l’accident de la montgolfière.
Jean Pierre VIAL , Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoir plus :
Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur Un ouvrage de M Jean-Pierre Vial – septembre 2010 : voir en ligne
Notes:
[1] C. aviation, art. L. 110-1
[2] Chambéry, 17 oct. 1989, RFD aérien 1989 p. 551 ; Pau, 26 févr. 1997, RFD aérien 1997, p. 91 ; Civ. 1, 19 oct. 1993 Bull. civ. n° 287. Crim. 20 mars 2001, Bull. civ. n° 76.
[3] TGI Nice 8 janv. 1985, D. 1985, IR 367, note G. Jeannot-Pagès.
[4] Bull. civ. n ° 205
[5] « L’acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien ; que tel est le cas du baptême de l’air en deltaplane biplace ». Civ.1, 22 nov. 2005, Juris-Data n° 2005-030815.
[6] « L’acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien, que tel est le cas du baptême de l’air en ULM biplace » Civ. 1, 22 nov. 2005, Juris-Data n° 2005-030818.
[7] Il faut toutefois préciser que les tribunaux admettent aujourd’hui que la qualité de transporteur aérien englobe les déplacements circulaires Civ 1, 12 mai 2004, Chappaz c/ Aussedat. Juris-Data n° 2004-023616.
[8] Civ. 1, 4 juill. 1967, JCP G 1967,15234, note P. Chauveau.
[9] Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et du contrat D. 2005, n° 4469.
[10] Article L 322-3.
[11] C’est l’analyse faite par la Cour d’appel de Bastia et approuvée par la Cour de cassation dans une espèce où un avion de tourisme s’était écrasé au sol. Civ. 1, 27 févr. 2007, RCA mai 2007 étude n° 166 note A. Vignon-Barrault.
[12] Civ. 2, 6 févr. 1974 : RFD aérien 1974, p. 175. Civ 2, 5 févr. 1980 : RFD aérien 1980, p. 192 ; JCP G 1980, II, 19461, note P. Chauveau.
[13] A. Vignon-Barrault, resp. civ. et assur. oct. 2007 Ėtude n° 16.
[14] Civ. 1, 21 oct. 1997, Bull. civ. I, n° 288. D. 1998, jurispr. p. 271, note P. Brun. somm. p. 199, obs. P. Jourdain. Gaz. Pal. 23, 24 avr. 1999, jurispr. p. 5, note J. Mouly. JCP G 1998, II,10103, note V. Varet. D. 1999, somm. 85, note A. Lacabarats. La Cour d’appel de Montpellier, cour de renvoi après cassation, a relevé que l’accident avait eu lieu pendant la phase de vol, c’est-à-dire à un moment où l’intéressé était totalement passif, l’appareil étant contrôlé et dirigé par le seul moniteur, de sorte qu’à ce stade du vol, le passager était en droit de prétendre à une sécurité absolue. Montpellier, 1ère ch. 10 mai 1999, Brizzi Nabut c/ Charrue.
[15] Pourtant, en y regardant de plus près ne faut-il pas considérer que même s’il détient les commandes de l’appareil, le stagiaire novice est dans le même état de dépendance que le passager, par rapport à son instructeur, surtout, s’il survient un danger ? En ce sens A. Lacabarats, RJE sport n° 48, p. 55.
[16] Civ 1, 5 nov. 1996 ; Bull. civ. I, n° 380, D. 1998, somm. p. 37, obs. A. Lacabarats.
[17] J-P. Tosi, D. 2005 p. 719.
[18] Art L. 321-3 pour le transport de marchandises et L. 322-3 pour le transport de personnes.
[19] Crim. 5 mars 1997, Bull. Crim. n° 88. 20 mars 2001, Bull. crim. n°76. La position de la Haute juridiction peut aussi s’expliquer par l’incompétence du juge répressif pour condamner le transporteur aérien à réparation.
[20] Obligation de moyens renforcée lorsque l’élève est aux commandes et obligation de résultat dans le cas contraire. En ce sens J-P. Tosi, D. 2006 p. 421.